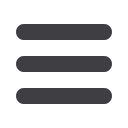

PREMJ.ERE ABDICATION.
~
AYRIL
'1814.
tH7
nement apres tout,
e~
n'étaicnt ni les étrangers
ni les Bourbons, bien que les étrangcrs pussent
etre son appui et les Bourbons sa fin, c'était la
réunion des hommcs les plus eonsidérables du
régime impérial, qui, au milieu de Paris déserté
par la femme et
l~s
frcrcs de Napoléon, déeou–
vert par une fausse manoouvre de sa part, et
cnvabi par l'ennemi, s'étaient conecrlés pour
sauver le pays, le réconcilier avec l'Europe: et
fairc cesser une lutte désastreusc et désormais
inutile. Tant que Napoléon avait rcprésenté le
sol et l'avait défendu , quclque coupable qu'il
put etre, on devait s'attacher opiniatrément
a
lui; mais maintenant qu'a la suite d'une fatale
eomplication de fautcs et de revers, il était
vaincu, et ne pouvait plus rico pour la France,
que la ruiner peut-etre par la prolongaLion
d'une gucrre calamiteuse, n'était-il pas légitime
de se séparer d'nn bomme en qui ne se pcrson–
nifiai t plus le salut du pays, bien qu'en lui se
personnifiat encore la gloire de nos armes , et de
se rallier autour d'un gouvernement qui, sans
partí pris d'imposer telles ou telles institutions,
telle ou lelle dynastie, faisait appel aux bons ci–
toyens pour qu'ils l'aidassent
a
tirer le pays
d'une crise épouvantable, sauf a voir ensuite
(son titre provisoire l'indiquait assez) sous quelles
lois, sous quelle famille souvcraine, on placerait
définitivement la France affrancbie et sauvée.
Des idées si sages devaicnt avoir aeces aupres
de tous les hommes sensés, et
a
plus forte raison
au pres d'hommes dégoutés, épuisés, soucieux
pour leurs intérets, comme l'étaient les chefs de
l'armée, ayant pour la plupart, outre les griefs
généraux, des griefs particuliers, car Napoléon
avait cu plus d'un de ses lieutenants
a
redresser,
notamment pendant la derniere campagne, et
il
l'avait fait avec la brusquerie d'un caracter e
impétueux et absolu. Pourtant, il faut dire
a
leur
honneur que devant l'ennemi aucun d'eux n'avait
fléchi, et que les plus fatigués, les plus mécon–
tents avaient été souvent les plus braves. Mais
il
~
terme
a
tout, meme au dévouement, surtout
quand on n'en voit plus la cause Iégitime, et
qu'on se eroit sacrifié aux passions d'un maitre
iosensé. Or, Napoléon ne devait plus paraitre
(
autre chose
a
des hommes qui étaient persuadés
qu'il ava it toujours pu faire la paix, et qu'il ne
l'avait jamais voulu. Il lui arrivait ce qui arrive
a
eeux qui ne disent pas constamment la vérité,
c'est qu'on ne les croit plus, alors meme qu'ils la
disent. Napoléon avait été coupable de ne pas
conclure la paix
a
Prague, imprudent de ne pas
la conclure
a
Francfort, nu
i
a
CLatillon
il
était
honorable á lui de ne l'avoir pas acceptée'
a
Fontainebleau il était héro'ique de vouloir pro–
longer la guerre pour tirer Paris des mains de
l'ennemi. Mais on ne croyait rien de tout cela,
et le chagrin, le noble chagrin de M. de Caulain-.
court était presque devenu pour Napoléon une
calomnie. Les regrels que M. de Caulaincourt
expr imait d'avoir vu la paix tant de fois repous–
sée, faisaient supposer que récemment encore,
notammen t
a
Chatillon, la paix avait été honora–
blcmen t possible, et follement refusée. On ne
voyait plus daos Napoléon qu'un fou furieux, des
mains duquel il fallait tout de suite et
a
tout prix
tirer la Franee et soi-meme.
Dans les rangs inférieurs de l'armée,
il
exis–
tait quelquefois le sentiment violent de la fatigue
physique, mais un jour de soleil, un 'bon repas,
une heure de repos, la vue de Napoléon, suffi–
saient pour le faire disparaitre. C'était parmi les
chefs que se manifestait la plus dangereuse des
fa tigues, la fatigue morale, et elle était propor–
tionnée au grade, e'est-a-dire
a
la prévoyance.
Grande chez les généraux, elle était extreme ehez
ies maréchaux.
Il y en avait un , entre tous, celui peut-etre
qu'on en aurait le moins soup<¡onné, que M. de
Talleyrand, avec son aptitude
a
démeler le coté
faible des coours, avait d'avance dásigné du doigt
comme l'homme qui céderait le plus tot aux
bonnes et aux mauvaises raisons qu'on pouvait em–
ployer pour détacher de Napoléon ses Iieutenants
les plus intimes, et celui-la n'était autre que le
maréchal l\farmont. Cet officier, que Napoléon
avait eréé maréchal et duc, par complaisance
d'ancien condisciple bien plus que par estime
pour ses talents, ne se croyait pas, sous le régime
impérial, apprécié
a
sa juste valeur, porté
a
sa
véritable place, ¡et
il
est vrai qu'en goútant sa per–
sonne, en estimant son brillant courage, Napoléon
ne faisait aueun cas de sa capacité. Cet esprit
présomptueux et incomplet,
a
demi ouvert,
a
demi appliqué, croyant approfondir ce qu'il péné–
trait
a
peine, voulant partout le premier rüle, et
tout au plus capable du second, n'ayant pas assez
de supériorité pour diriger, pas assez de modestie
pour obéir, était antipathique
a
Napoléon, qui
lui préférait de beaucoup !'esprit simple, solide,
meme un peu borné, mais ponctuel et énergique
dans l'obéissance, de plusieurs de ses maréchaux.
Aussi avait-il placé au-dessus de Marmont bien
des hommes au-dessus desquels Marmont croyait
ctre. Marmont, en outre, avait commis
a
Craonne
.
.
•
















