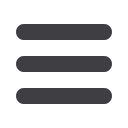

426
LIVRE
CINQUANTE-TROISIEl'fl'E.
apres avec Napoléon parce que celui-ci avait
transporté au prínce Eugene l'hérítagc da prínce
Primat, personnage de petite taille, de manieres
a
la foís allemandes et
fran~aises,
de physiono- -
míevíve, d'humeurr.emuante, d'opinionfranche–
rñent libérale, d'esprít remarquable et surtout
tres-fin, avait souvent exhalé son mécontente–
mcnt chez
l\f.
de Talleyrand, avec une liardiesse
qui avait attiré
a
sa jeune épouse une disgrace
de cour. Il en était irrité, et ne s'en cach ait
guere. L'abbé de Pradt, i·elégué dans son diocese
depuis sa fachease ambassade de Varsovie, aux
difficultés de laquclle il avait ajouté toas les dé–
fauts de son caractere, était revenu
a
París
depuis nos derniers revers, et joignait sa lan–
gue
a
celle du duc de Dalberg, de maniet'e
a
se
fairc entcndre de la police qui aurait cu l'orcille
la plus dure. Le baron Louis, jadis
a
demi en–
gagé dans les ordres, en étant sorti depuis,
exclusivement appliqué aux scienccs économi–
ques , doué d'un vrai génie fin ancier, esprit
a
In
fois véhément et fcrme, ami de la liberté dans
la mesure qu'autorise une sage politique, dé–
testait le régimc impérial par les motifs d'un
homme éclairé, et fréquentait volontiers un
ccrcle ou il trouvait avcc beau coup de lumiercs
toules les passions qui l'animaicnt.
Ces pcrsonnages et quelqucs autrcs se rcn–
contraient saos ccsse chez M. de Talleyrand, et
y échangeaient l'exprcssion de lcurs sentiment s.
Le pétulant abbé de Pradt y disai t avec Ja viva–
cité ordinaire de ses aliares qu'il fallait tout sim–
plement mettrc les Bourbons
a
la place des
Bonnpartc; le dnc de Dalberg le disait moins,
Je désirait tout autant., et était capable d'y tra–
vailler plus utilement. Le baron Louis deman–
dait qu'on mit fio
a
un despotisme qui, depuis
deux années, paraissait exlravagant.
l\L
de Tal–
leyrand , avec sa noncbalance ordinaire, écoutait
assez pour encourager ceux qui parlaient de la
sortf', pas assez pour Ctre personnellcment com–
promis. Quelquefois crpcndant il s'ouvrait avec
un de ces visiteurs, raremcnt avcc dcux, et
quand il le faisait, c'était avec Je duc de Dalberg
dont il connaissait Ja hardiesse, la dcxtérité, les
relations nombreuses, et duque! il pouvait al–
tendre un concours efficace.
11
considérait l'ahbé
de Pradt comme un étourdi, le baron Louis
comme un savant admínislratcur, tres-bon
a
cmployer dans l'occasion, mais ne leur confiait
rico, car dans le momcnt préscnt il n'avait pas
plus affaire de la légereté de
1'110
qu e du sérieux
de l'autre. Il les laissa it dire avcc un so urire
a
la
fois approbateur et évasif, puis apre.§_ les aroir
écoutés sortait de chez luí; allait rendre visitr. au
duc de Rovigo, sous prétcxte de demander dés
nouvelles, lui témoignait l'intéret le plus vif
pour les succes de l'armée fran<;aise, affectait de
déplorer l'inhabileté de la plupart des :igents de
Napoléon, disait qu'íl était bien malheureux
qu'un si grand homme fUt si mal serví, en quoi
il trouvait le duc de Rovigo tout
a
fait d'accord
avec lui, car ce ministre rnécontent de la plupart
de ses eollcgues, se plaigoant de n'etre plus
écouté de Napoléon , rcgreltan t qu'il se füt
séparé de l\L · de Talleyrand, était de ceux . aux–
quels on pouvait foire entcndre une critique
mesurée de l'état de ehoses, pourvu qu'elle par–
til du dévouement et non du désir de renverser.
M. de Talleyrand a:ffectait aupres du due de Ro–
vigo d'etre du nombre de ces censeurs qui
biament parce qu'ils aiment, ne trompait son
clairvoyant interlocuteur qu'a demi, mais le
trompait assez pour atlénuer l'effet des propos
qu'on tenait
a
l'hótel de la .rue Saint-Florentin.
Rentré ehcz luí,
l\'1.
de Talleyrand permettait de
nouveau les· conversations les plus hardies,
n'av~mait
qu'au duc de Dalberg son désir de se
soustraire
a
un joug insupportablc, en chcrchait
avec lui les moyens et ne les découvrait guere.
Tenter quelque eho:>e tant que les étrangers ar–
més étaient si loin de París, lui semblait irnpra–
t.ieable. Une idée qui frappait surtout le duc de
Dalberg et M. de Talleyrand, c'.est qu'cn t:iton–
nant entre la Seine et la Marne, et en négociant
a
Ch:itillon, les eoalisés ménageaient
a
Napoléon
les seulcs chances qu'il cut de se sauver. Rompre
toute négoeiation avec lui, le ¡wésenler des lors
a
Ja France comme l'u niquc obstaclc
i.i
la paix,
profiter de l'une de ses allées et venues pour
percer sur la capitale, était
a
Jeurs yeux l'unlque
maniere d'en finir. A peine les coalisés parai–
traient-ils aux portes de París, qu'on ferait une
Jcvée de boucliers, qu'on proclamerait Napoléon
déchu , et qu'on briserait ainsi'dans ses mains
l'épée qu'il était presque impossiblc de luí
arracher.
C'était la e que Mi\J. de Talleyrand et
e.leDal–
Lerg auraicnt voulu faire parvenir
a
l'orcille des
souverains coalisés; mais, preuvc singulicre du
peu de concert entre le dedans et le dehors, ils
n'avaient pu se procurer un intermédiaire pour
communiquer ces idées. Ainsi MM. de Polignac
ayant réussi
a
s'évader, n'avaient ríen em–
porlé ni de M. de Talleyrand ni du duc de Dal–
berg, les seuls hommes qui fussent en ce moment
















