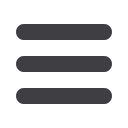
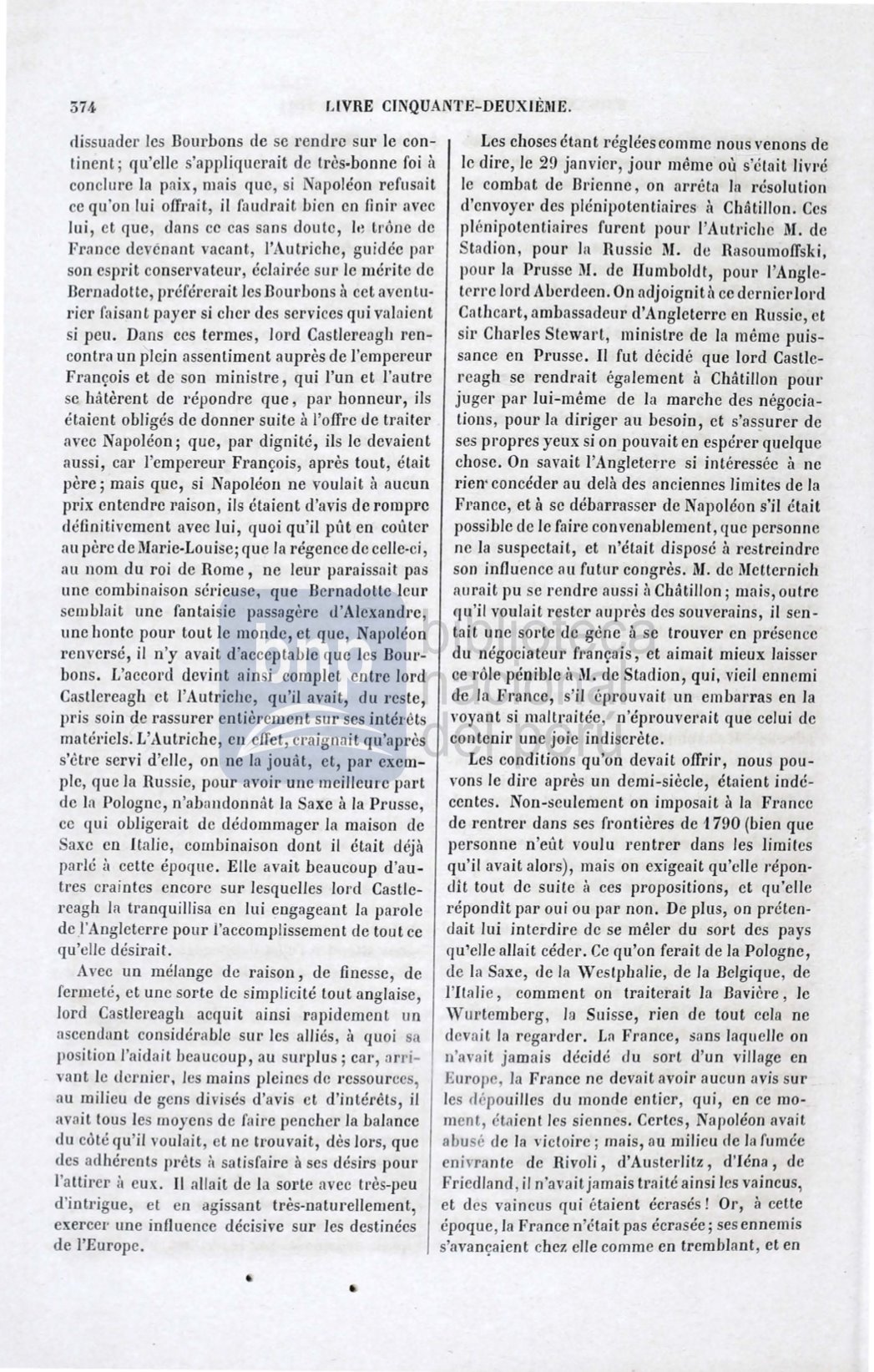
574
LlVRE
CJNQUANTE-DEUXIEl\IE.
rlissuader les Bourbons de se rendrc sur le con–
tinent ; qu'elle s'appliquerait de tres-bon ne foi
a
conclure la paix, mais que, si Napoléon refusait
ce qu'on lui offrait,
il
faudrait bien en finir avec
Jui, et que, daos cecas saos doutc, le tróne de
Frunce devénant vacant, l'Autrichc, guidéc par
son esprit conservateur, éclairée sur le mérite de
Bernadotte, préférerait les Bourbons a cet aven tu–
rier faisant payer si cher des services quivalaient
si peu. Daos ces termes, lord Castlereagh ren–
contra un
ple.inassentiment aupres
de
l'empereur
Fran~ois
et de son ministre, qui !'un et l'autre
se baterent de répondre que, par honneur, ils
étaient obligés de donner suite
a
l'offre de traiter
avec Napoléon; que, par dignité, ils Je devaient
aussi, car l'empereur
Fran~ois,
apres tout, était
pere; mais que, si Napoléon ne voulait a aucun
prix entendre raison, ils étaient d'avis de romprc
définitivement avec lui, quoi qu'il put en couter
au perc deMarie-Louise; que la régence de ceHe-ci,
au nom du roi de Rome, ne leur paraissait pas
une combinaison sérieuse, que Bernadottc lcur
sernblait une fantaisie passagere <l'Alexandrc,
une honte pour tout le monde, et que, Napoléon
renversé, il n'y avait d'acccptablc que les Bour–
bons. L'accord devint ainsi complet entre lord
Casllereagh et l'Autrichc, qu'il avait, du reste,
pris soin de rassurer entierement sur ses intérets
matériels. L'Autriche, eu eifet, craignait qu'apres
s'etre serví d'elle, on ne Ja jouat, et, par exem–
ple, que la Russie, pour avoir une meilleurc part
de
la
Polognc, n'abandonnat la Saxe a Ja Prusse,
ce qui obligerait de dédommager Ja maison de
Saxc en Italic, combinaison dont
il
était déja
parlé
á
cettc époque. Elle avait beaucoup d'au–
tres craintes encorc sur lesquelles lord Castle–
r eagh Ja tranquillisa en luí engageant
la
parole
dc .l'Angleterre pour I'accomplissement de tout ce
qu'elle désirait.
Avec
un mélange de raison,
de
finesse, de
fermeté, et une sorte de simplicité tout anglaise,
lord Castlereagh acquit ainsi rapidement un
ascendant considérable sur les alliés, a quoi sa
position J'aidait bea ucoup, au surplus; car , arri–
vant le dcrnier,
les
mains pleincs de rcssourccs,
au milieu de gens divi és d'avis et d'intérets,
i1
avait tous les moyens de faire pencher la balance
d u coté qu'il voulait, et ne trouvait, des lors, que
des ad hérents prets
a
satisfaire
a
ses désirs pour
l'a ttirer
~1
eux. II allait de la sorte avec tres-peu
d'intrigue, et en agissant tres-naturellement,
exercer une infl uence décisive sur les destinécs
de l'Europe.
Les choses étant régléescommc nous venons de
le dire, le 29 janvicr, jour meme ou s'était livré
le combat de Brienne , on arréta la résolution
d'cnvoyer des plénipotentiaires·
a
Chatillon. Ces
pl énipotentiaires furent pour l'Autriche M. de
Stadion, pour la Russic
:M.
de Rasomnoffski,
pour Ja Prusse
1\I.
de Humboldt, pour l'Angle–
terrc lord Al>crdeen. On adjoignita ce dernicrlord
Cathcart, ambassadeur d'Angleterre en Russic, et
sir Charles Stewart, ministre de la méme puis–
sance en Prusse.
11
fut décidé que lord Castle–
r eagh se rendrait également a Chatillon pour
juger par lui-meme de
la
marche des nég9cia–
Lions, pour Ja diriger au besoin, et
s'as~urer
de
ses propres yeux si on pouvait en espérer quelque
chose. On savait l'Angleteue si intéressée a ne
rien· concéder au dela des anciennes Ji mi tes
de
Ja
Francc, et
a
se débarrasser de Napoléon s'il était
possible de le faire convenablement, que personne
ne la suspectait,
et
n'était disposé a restreindre
son influ.ence au futur congres.
M.
de Metternich
a.urait pu se rendre aussi
a
Chatillon; mais, outre
qu'il voulait rester aupres des souverains,
il
sen–
tait une sorte de gene
a
se trouver en présence
du négociateur
fran~ais,
et aimait mieux laisser
ce
róle pénible a M. de Stadion, qui, vieil enncmi
de
Ja France, s'il éprouvait un embarras en Ja
voyant si rnaltraitée, n'éprouverait que celui de
contenir une joie indiscrete.
Les conditions qu'on devait offrir, nous pou–
vons le dire apres un demi-siecle, étaient indé–
centes. Non-sculement on imposait
a
la Francc
de rentrer dans ses frontieres de 1790 (bien que
personne n'eut voulu rentrer dans les limites
qu'il avait alors), mais on exigeait qu'clle répon–
dit tout de suite
a
ces
propositions, et qu'elle
répondit par oui ou par non. De plus, on préten–
dait luí interdire de
se
meler du sort des pays
qu'elle allait céder. Ce qu'on ferait de la PoJogne,
de Ja Saxe, de la W estpbalie, de la Bclgique, de
l'Italie, comment on traiterait
la
Bavicre, le
Wu rtemberg, Ja Suisse, ríen de tout cela ne
devait la regardcr. Ln France, sans laqueJJe on
n'avait jamais décidé du sort d' un village
en
Europe, la France ne devait avoir aucun avis sur
les dépo uilles du monde entier, qui, en ce mo–
ment, étaient les siennes. Certcs, Napoléon avait
abusé de Ja victoire ; mais, au milieu
de
la
fumée
enivrante de Rivoli, d'Austerlitz, d'Iéna, de
Friedland , il n'ava it jamais traité ainsi les vaincus,
et des vain cus qui étaient écrasés
!
Or,
a
cette
époque,
la
France n'était pas écrasée; ses ennemis
s'avarn;aient cbcz elle comme en tremblant, et en
















