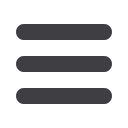

L'JNVASION. -
NOVEMBl\E
1815.
509
profonde dans les ports, r ésultant de la clóture
absolue des rners; sur le·s frontieres de terre
ouvertes naguere
a
notre industrie, des
millier~
de bafonnettes étrangeres ne laissant pas pnsser
un ballot de marchandises ; enfin une terreur
iodicible et universelle de l'invasion , tous ces
maux
a
la fois provenant d' une seule volonté
non contreditc, étaient une cruelle le<;on , qui
avait infirmé celle qu'on avait r e<;ue des malheurs
de la révolution, et qui, sans rendre la France
républicaine, la ramenait
a
désirer une monar–
chie libéralement constituée. Tous les partis,
Jongtemps oubliés, commen<¡aient
a
se montrer
de nouveau. Les révolutionnaires s'agitaient,
mais
a
la .vérité sans effet. Quelques-uns, en tres–
petit nombre, sa ratlachant
a
Napoléon par la
crainte des Bourbons qu'ils ha!ssaient, voulaient
bien le proclamer dietateur, a condition qu'il
aurait recours
a
des moyens extraordinaires, et
qu'il appellerait le peuple
a
un mouvement sem–
blable a celui de
1792.
Mais c'étaient des mania–
qucs revant un passé actuellement impossible.
Le mouvement de
1792
n'avait été qu'une ex–
plosion d'indignation de la part de Ja France
injuslement assaillie par l'Europe, et ce senti–
ment c'était aujourd'hui l'Europe qui l'éprouvait
a
son tour contre nous. Les royalistes, partisans
de Ja maison de Bourbon, r animés par l'espé–
rance, excités par les pretres bien plus nombreux,
bien plus hardis en ce moment que les révolu–
tionnaires, commen<¡aient
a
élever la voix et
a
se
faire écouter. La France avait presque oublié les
Bourbons, dont elle était séparée par des événe–
ments immenses qui tenaient dans les esprits la
place de plusieurs siecles, et ell e craignait d'a il–
Jeurs leur maniere de penser, Jeur entourage,
leurs ressentiments; mais épou vantée del'empire,
persistant
a
repousser Ja r épubliq ue, elle en ve–
nait
a
comprendre que les Bourbons, contenus
par de sages lois, pourraient offrir un moyen
d'échapper au despotisrue comme
a
l'anarchie.
II n'y avait, du reste, que les hommes les plus
éclairés qui portassent leurs vues aussi Join ; Ja
masse laissait parler des Bourbons pour rie plus
entendre parl er de la g uerre, qui dévorai t les
enfants, aggravait les impóts, et empechait tout
commeree.
Lorsqu'un gouvernement commence
a
etrc en
danger, on peut en apercevoir le signe certain
dans l'état d'esprit des fonclionnaires. En
1815
et
·J814
les fonclionnaires de l'Empir e étaient
tristes, découragés,
aball.us, et quoiqu'un certain
nombre afl'ectassent uu zele violent, la pl upart
sans le dire en voulaient
a
Napoléon aulan t que
ses plus gra nds ennemis, parce qu 'ils cntaient
qu'en se compromettant lui-meme il les avait
tous eompromis. Le péril nw1it rcodu quelque
indépeodance aux fonctionnaires d'un ordre
élevé. lis avaient déja dita Napoléon ,
a
la fin de
18 •12, et ils luí répétaient bien plus
a
la fi n de
·J
815, que saos la paix ils seraient tous perdus,
eux comme lui. Les militaires d u plus haut grade
qu'il avait comblés de biens, rnais sans les en
laisser jouir, se taisaicnt en mootrnot un sombre
mécontenternent, ou disaicnt duremen t qu'il ne
restait aucune ressource pour soutenir la guerre.
Les deux hommes les plus sensés, l'un de l'armée,
l'au tre du gouvernement, Berthier et Cambacé–
res, ne cachaient plus leur consternation. Ber–
thier était malade; Cambacéres était tombé daos
une dévotion qui, ne répondant
a
aucune de ses
dispositions antérieures, était la suite visi ble de
de son profood découragemeot. Se taisant avec
Napoléon comme on a coutume de faire avec les
incorrigibles, il avai t demandé
a
se retirer, pour
finir sa vie daos le repos et la piété. D'autres
personnages moins résignés avaient manifesté
plus ouvertement leur chagrin. Ney, disait-on,
avait laissé échappé des paroles violentes ; Mar–
mont avait profité d'une ancienne intimité pour
hasarder quelques avis; Macdonald, avec un mé–
lange de finesse et de simplicité un peu rude,
avait dit son sentiment; M. de Caulaincourt avait
réitéré l'expression du sien, avec son courage
ordinaire et une sorte de h auteur respectueuse.
Tous n'avaient que le mot de paix
a
la bouche.
Enfin l'impératrice, saos donner un avis , car elle
ne savait qui avait tort ou raison, s'était bornée
a
pleurer. Elle érai t épouvan tée pour elle, pour
son fils, meme pour Napoléon , qu'elleaimait alors
comme une jeune femme aime le seul homme
qu'elle ait connu.
Cette idée de la paix, qui le poursuivait commc
un reproche amer, importunait Napoléon, d'au–
tant plus qu'apres ne l'avoir point voulue quand
il dépendait de lui de l'obteuir,
il
sentait qu'au·
jourd'bui, meme en la voulant, il ne l'obtiendrait
pas, et que cette paix longtemps repoussée s'en–
fuirait
a
son tour quand il courrait apres elle:
siuguliere et fatale vcngeancc des choses de ce
monde! L'Europc certainemen t venait d'offrir
avec bonnc
foi
la reprise des négociations, mais
on pouvait douter de cette bonne
foi
quand on
n'était pas dans le secret de ses conseils, et il
était probable d'ailleurs qu'elle ne persisterait
pas daos une telle offre, des que notre faiblesse,
















