
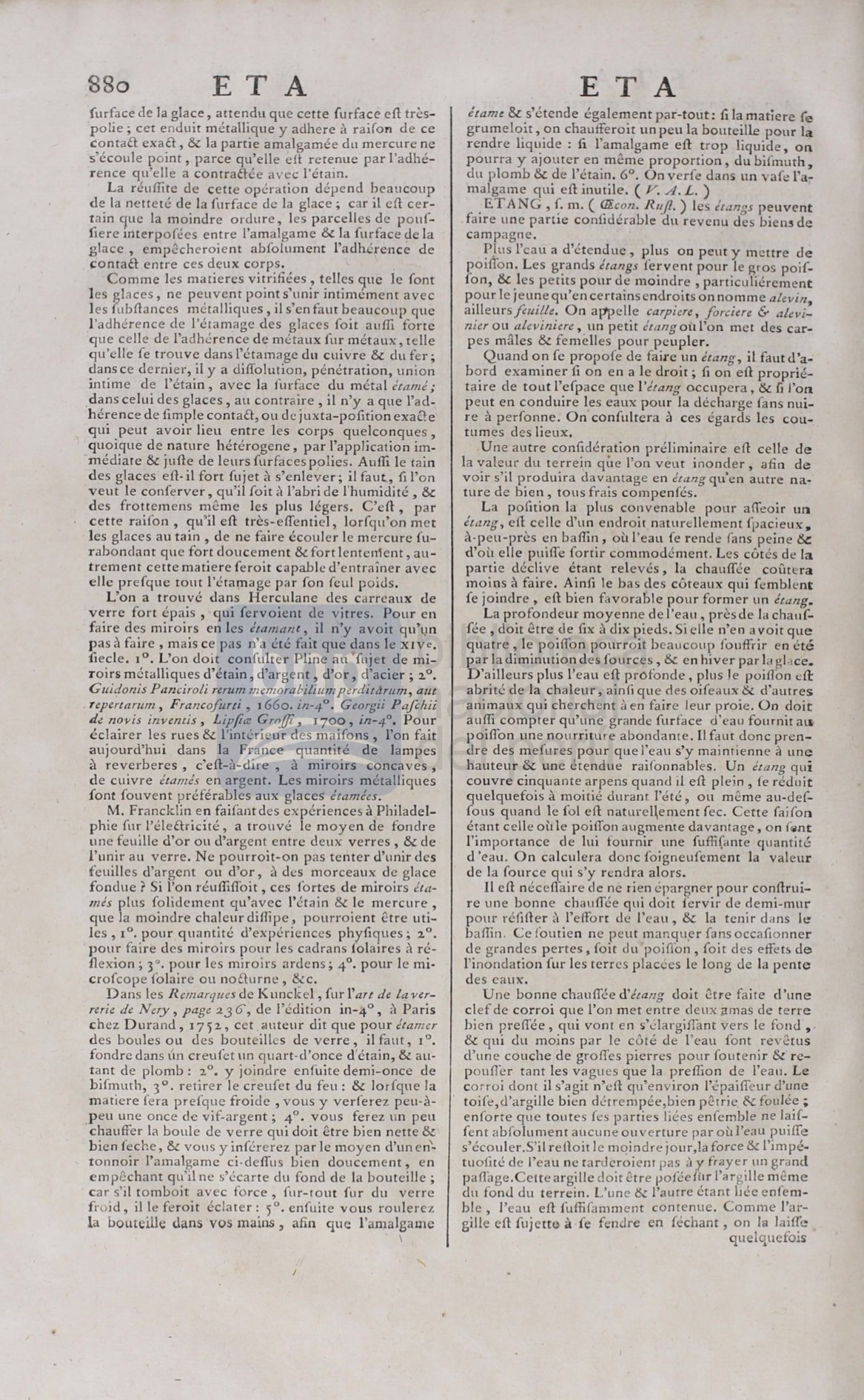
So
ETA
furface de la glace, attendu que cette furface efr tr' s–
polie; cet enduir métallique
y
adhere
a
raifon de ce
éontaét exaa,
&
la partie amalgamée du mercure ne
s
écoule point, paree qu'elle eH retenue par l'adhé–
rence qu'elle a contraétée avec l'étain.
La réuffite de cette opération dépend beaucoup
de la netteté de la furface de la glace; car il efi cer–
t ain que la moindre ordure, les parcelles de ponf–
fiere interpofées entre !'amalgame
&
la furface
~e
la
glace , empecheroient abfolument l'adhérence de
~ontaét
entre ces deux corps.
Comme les matieres vitrifiées, telles CJUe le font
les glaces, ne peuvent points'unir intimement avec
l es fubftances métalliques, il s'en faut beaucoup que
l'adhérence de l'éramage des glaces foit auffi forre
que eelle de l'adhérence de métaux fur métaux, telle
qu'elle fe trouve dans l'étamage du cuivre
&
du fer;
dans ce dernier, il y a diffolurion, pénétration, un ion
intime de l'étain, avec la furface du métal
étamé;
.dans celui des glaces, au contraire , il n'y a que l'ad–
hérence de fimple contaét, o u de juxta-pofition exaae
qui peut avoir lieu entre 1es corps quelconques,
quoique de nature hétérogene, par l'application im–
médiare & jufie de leurs furfaces polies. Auffi le tain
des glaces efi- il fort fu jet
a
s'enlever-; il faut' fi l'on
veut le conferver' qu'il {oit a l'abri de l'humidité
~
&
des frottemens rneme les plus légers. C'efi, par
cette raifon ,
qt~'il
eft tres-eífentiel, lorfqu'on rnet
les glaces au tain, de ne faire écouler le mercure fu–
rabondant que fort doucement
&
fort lenterñent, au–
trement cette matiere feroit capable d'entrainer ave e
elle prefque tout l'étamage par fon feul poids.
L'on a trouvé dans Herculane des carreaux de
verre fort épais , , qui fervoient de vitres. Pour en
faire des miroirs en les
étamant,
il
n~y
avoit qu'tJn
pasa faire ' mais ce pas n'a été fait que dans le
xrve.
:fiecle. 1°. L'on doít confulter Pline au ·flljet de mi–
roirs métalliques d'étain, d'argent, d'or, d'acier;
2
°.
Guú;ionis Panciroli rerum memorabiliumperditárum, aut
repertarum, Franco.furti,
166o.
in-4°. Georgii
P
afthii
de
no·vis inventis, Lipfice Gro.fli,
1700,
in-4°.
Pour
éclairer les rues
&
l'intérieur des maifons, l'on fait
aujourd'hui dans
la France quantité de
lampes
a
reverberes , c'efi-a-dire '
a
miroirs concaves'
de cuivre
étamés
en argent. Les miroirs métalliques
font fouvent préférables aux glaces
étamées.
M. Francklin en faifant des expériences a Philadel–
phie fur l'éleétricité, a trouvé le moyen de fondre
une feuille d'or ou d'argent entre deux verres,
&
de
l'unir au verre. Ne pourroit-on pas tenter d'unir des
feuiUes d'argent Oll d'or'
a
des rnorceaux de glace
fondue? Si l'on réuffiífoit, ces fortes de miroirs
éta–
més
plus folidement qu'avec l'étain
&
le mercure ,
que la moindre chaleur diffipe' pourroient etre uti–
les, 1°. pour quantité d'expériences phyfiques; 2°.
pour faire des miroirs pour les cadrans folaires aré–
flexion;
r~.
pour les miroirs ardens; 4°· pour le mi–
crofcope folaire ou noél:urne, &c.
Dans les
Remarques
de K unckel, fur
1'
art de lq,ver–
rerie de Nery, page 236,
de l'édition in-4°,
a
París
ehez Durand,
17 52,
cet auteur dit que pour
étamer
des boules ou des bouteilles de verre, il faut, 1°.
fondre dans Ún creufet un quart-d'once d'étain,
&
an–
tant de plomb:
2
°.
y
joindre enfuite demi-once de
bifmuth, 3°. retirer le creufet du fe u:
&
lorfque la
rnatiere fera prefgue froide , vous
y
verferez peu-a–
peu une once de vif-argent; 4°. vous ferez un peu
chauffer la boule de verre qui doit etre bien nette
&
bien feche,
&
vous
y
in{¡'rerez par le moyen d'un en"..
tonnoir !'amalgame ci-deífus bien doucement, en
empechant qu'ilne s'écarte du fond de la bouteille;
car s'il tomboit avec force , fur-rout fur du verre
froid, ille feroit éclater: 5°. enfuite vous roulerez
la
bouteille
dans
vos
rnains, afin que !'amalgame
\
1
ETA
étam~ & s'étende également par-tout:
1i
la matiere
{e
grumelo.it, _on chauf!eroit un peu la bout ille pour
la
rendre liqt~Ide
:
fi
1
amalgame efi t rop liquide, on
pourra
y
a¡outer en meme proportion' du bifmuth
du plomb
&
de l'étain. 6°. On verfe dans un "aft
1
a~
malgame qui eft inutile. (
V.
A. L.
)
. ETANG,
~·m.
(
<!fc,on. Rujl.)
l s
étan
0
s
peuvent
farre une parue conüderable du revenu des biens de
campagne .
~Jus
l'cau a d'éten?ue, plus oo peut
y
mettre de
pmífon. Les
g~ands
etangs
fervent pour le gros poi[ ..
fon,
&
les peuts pour de moindre , particuliérement
pour le jeunequ'en certains en-droits on no mme
alevin
ailleurs
fiuille.
On aJ!Pelle
carpiere, forciere
&
ale
vi~
nier
o u
aleviniere,
un petit
étang
ou l'on met des car–
pes males
&
femelles pour peupler.
Quand on fe propofe de fa ire un
étang,
il faut
<.1
'a–
bord examiner fi on en a le droit; fi on efi proprié–
taire de tout l'efpace que
l'étang
occupera,
&
íi
J'on
peut en conduire les eaux pour la décharge fans nui–
re
a
perfonne. On confultera
a
ces égards les cou–
tumes des lieux.
Une autre coníidération préliminaire e11 celle de
la valeur du terrein que l'on veut inoncler, afin de
voir s'il produira davantage en
étang
qu'en autre na–
ture de bien, tous frais compenfés.
La pofition la plus convenable pour aífeoir un
étang,
eíl: celle d'un endroir naturellement fpacíeux,
a-peu-pres en baffin, Ottl'eau fe rende fans peine
&
d'oi1 elle
pui~e
fortir commodément. Les cotés de la
partie déclive étant relevés' la chauífée cout ra
moios a faire. Ainfi le bas des coteaux qui femblent
{e
joindre, eft bien favorable pour former un
étang.
La profondeur moyenne de l'eau, pres de la chauf–
fée, doit etre de úx a dix pieds. Si elle n'en a voir que
quatre, le poiífon pourroit beaucoup fouffrir en été
par la diminution des fources,
&
en hiver par lét glace..
D'ailleurs plus l'eau efi profonde, plus Je poiífon
ft
abrité de la chaleur, ainú que des oifeaux
&
d'autres
animaux qui cherchent
a
en faíre leur proie. Oo doit
auffi compter qu'une grande furface d'eau fournit
a~
poiífon une no urritu re abondante. Il faut done pren–
dre des mefures pour que l'eau s'y mainrienne
a
une
hauteur
&
une étendue raifonnables. Un
étang
gui
couvre cinquante arpens quand il eft plein,
{e
réduit
quelquefois a rnoitié durant l'été,
Oll
meme au-def–
fous quand le fol efi naturel\ement fec. Cette faifoo
étant celle otile poiífon augmente davantage, on
{~nt
l'importance de lui fournir une fuffi(ante quantité
d 'eau. On calculera done foigneufement la valeur
de la fource qui s'y rendra alors.
n
efi néceífaire de ne rien épargner pour conflrui–
re une bonne chauífée qui doit fervir de demi-mur
pour réfifier
a
l'effort de l
'eau' &la tenir dans le
baffin. Ce (outien ne peut
manqu.erfans occafionner
de grandes pertes, foit du
poiífon,foit des effets de
Pinondation fur les terres placées le long de la pente
des eaux.
Une bonne chauífée
d'étang
doit "tre faite d 'une
clef de corroi que l'on met entre deux .amas de terre
bien preífée, qui vont en
s'~lat·giilant
vers le fond ,
&
qui du moins par le coté de l'eau font revetus
d'une couche de grofres pierres pour foutenir & · re–
pou!fer tant les vagues <que la preffion de l'eau. Le
corroí dont il s'agit n'eíl:
qu~environ
l'épaitieur d'une
toife,d'argille bien dérrempée,bien petrie
&
foulé~;
enforte que toutes fes parties liées enfemble ne
laif–
fent abfolument aucune ouverture par ou 1'eau puiífe
s'écouler.S'il refioit le moindre jour,la force
&
l'impé..
tuofité de l'eau ne rarderoienr pas
ay
frayer un grand
pafiage.Cette argille doit erre poféefl:tr l'argille meme
dn fond du terrein. L'une
&
l'aurre étant
li
'e enfem–
ble, l'eau eft fuffifamment contenue. Comme l'ar–
gille efi fujett<i>
a
fe fendre en féchant' on la laiífe
quelquefois
















