
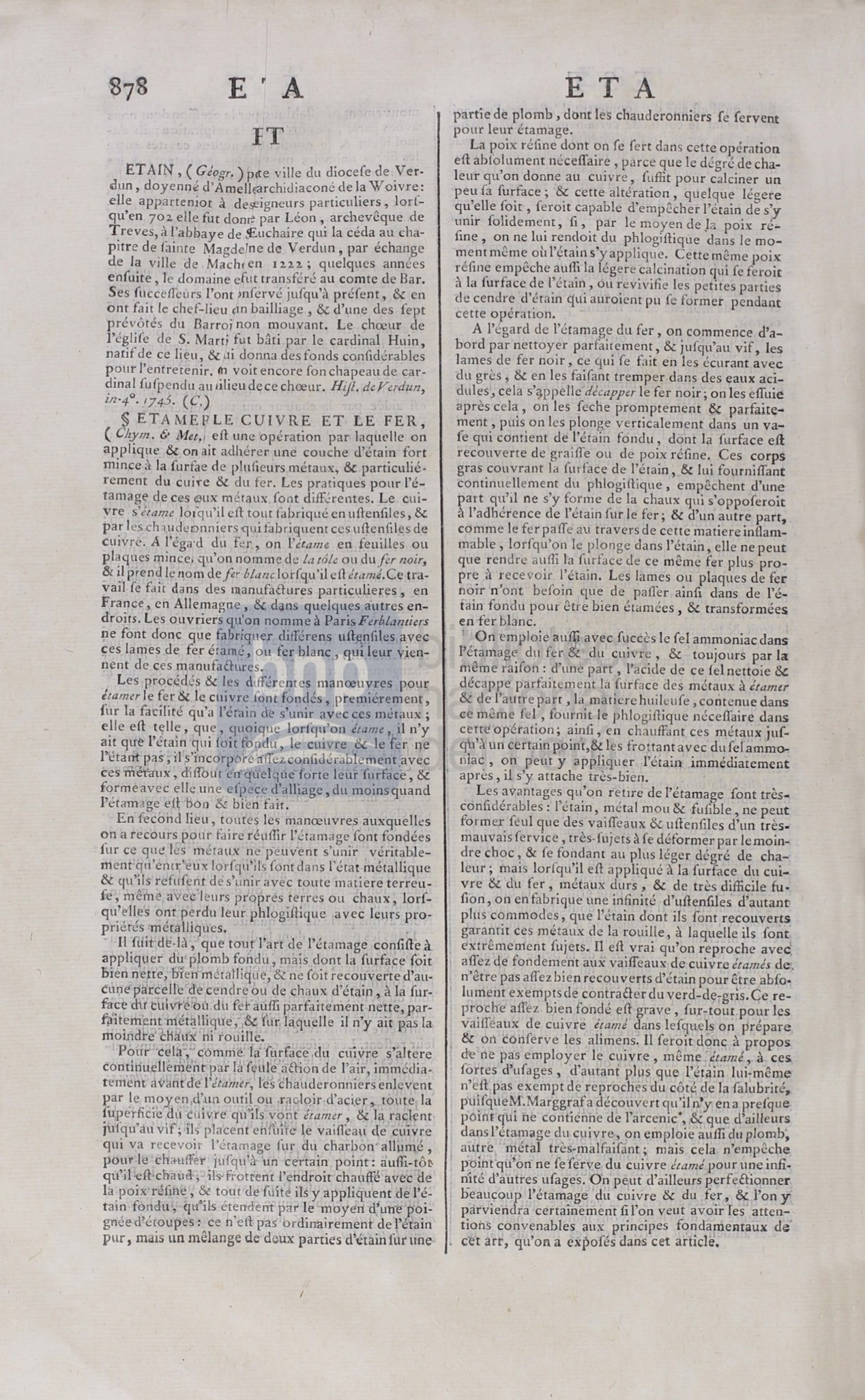
878
E'A
IT
ET
AIN, (
Gtogr.)
ptte ville du díocefe de
'Y
er–
dun, doyenné d'Amellfc!rchiuiaconé de l.a Wo1vre.:
elle apparreniot
a
de$!igneurs particulters' lorí–
qu'en
702
elle fut donlt par Léon, archeveque de
Treves,
a
l'abbaye de
~uchaire
quila céda au e
ha~
pitre de íainte MaO'de[ne de Verdun, par échange
de
la
ville de M:'ch(en
1222.;
quelques années
enfuite, le domaine efut rransfi'
r~
au comte de Bar.
Ses fucceifeurs l'ont pnfervé jufqu'a préfent,
&en
ont fait le chef-lieu 4tn bailliage.,
&
d'une
d.esfept
prévotés du Barroi non mou;vant. Le c
hreur de
l'églife de
S.
Marti fut bati par le cardinal
Hu
in,
natif de ce
li~u,
&
ni donna des fonds confidérables
pour l'entrerenir.
rt1
voit encore fon chapean de car–
dinal fufpendu auülieu de ce chreur.
Hijl. deVerdun,
i!Z•4°·
'71i· (C.)
§
ETAMEFLE CUIVRE ET r.E FER,
(
Chym.
&
Met, l
efi une opération par laquelle on
applique
&
on air adhérer une couche d'étain fort
mince
á
la furfae de pluíieurs métaux,
&
particulié–
rement du cuite
&
du fer. Les pratiques pour l'é–
tamage de ces <eux métaux font difft.! rentes. Le cui–
vre s'
étame
lo1qu'il eft tout fabriqué en ufteníiles,
&
par les .ch::)udeiDnníerS<fUÍ fabriquent ces ufrenfiles de
cuivre.
A
l'éga·d du fer, on
Pé&ame
en_feuilles ou
plaques qiince1 qu'on nomme de
La tóle
ou du.fer
noir,
&
il p[€nd
le
~om
de.fer
blanc
lorfqu'il efi
étamá.Cetra–
vail fe fair dans des tllanufaétures parti
culieres,en
France, en Allemagne ,
&
dans quelques
á
utres en–
d'roits. Les ouvriers
~u'on
nomme
a
ParisFerh.LaT?-tiers
ne font done que fabrique,r differens ufi:hníiles ¡¡vec
~es
lames de fer
é~amé,
o u fer blanc, gpi leur
y~en-
nent de ces manufaéhu:es.
-
Les procéd 's
&
les dtfférentes manreuvres pour
étamer
le fer
&
1~
cuivre font fond
1
s, premiérement,
fur la fatílité qu'a l'érain
cte
s'unir avec ces méraux;
elle efr
t~lle,
que, quoique lorfqu'on
étame,
il n'y
ait qtte l'étain qui foit f'o'!du, le cuivre
&
le fer ne
l'etá
rft
pas , il ¡5'incorp6fe 'aífez coníidérablement .avee
ees Rr?ea·ux, dHfot t érfqt1elque-forte léur furface,
&
forme ave e elle une efpece d'alliage, du moi,ns quand
l'étamage eit boo
&
bíbri fa ir.
En fecóhd lieu, toutes
le~
manreuvres auxquelles
on a recours pone faire réuffir l'étamage font fondées
fur ce que
Ié's
métaux ne peuv"enr s'unir véritable–
ment:c(n'emr.''eltx
lorfqu'il~
fontdans l'état-métallique
&
qu''ils reflffent dé s'unir ave e toute matiere terreu–
fe, memé aVeG 'Jeurs propres terres
Oll
chaux, lorf–
qu'e'Iles ont perdu leur phlogifrique .avee
le~trs
pro-
priérés ·métalliques.
,
. Il
fditd~-la'
que tout l'art de l'étamage
co~fifre
a
appliquer
dL~
p1omb fondu, mais dont la furfaFe
Coit
Bien nett'e, b:ren métallique,
&
ne foit recouverte
d'au~
étmépa'r':~l1~e ~cfe
cenclte ou de
c;ha~x
d'étaip'
a
la
fur~
fa
ce
cht
tutvt'e:Oü
du
fer
aufú parfaitement nette, par–
(a1tertÚ!nt
t~nét%lHgne,:,&
ftir laquelle il n'y áit p,as la
moina e!1:11aux ni rouil1e.
'
Potfr'
é<illa~;
comrrie fa·
furfa~e
,du cmvre
S
altere
contlpuellement par
1~ f!fül~ ~ilion
de l'air',
i~m
1
di
a~
tetnent.
av~ntde
l'étamer,
le~
chabderonniers enlevent
par le moyen
d'up.
outil ~ou
.rac.lqir d'aci,er _,_ toute la
fUJJetficie Ciu éuivre qu'íls vont
étamer '
&
la radent
jufqu'at1 vif;
n~
p1acent
-ehi~lÍ~e
le vaiífeau 'de cu1vre
qui va recevoir l'étamage fm·
au
charbon' allbmé'
pour le cha·uffe r jufqu'a un certain point:
auffi-to~
qu'il -efl:·chauel ;.i ils-frotrent l'endroit chauffé ave-e de
la
poix réfine,
&
tout de fui te ils
y
appliqttent de
l'é~
tain f0ndu ', qtt"ils étendent pa le moyert d
1
ulf'é:P."oi–
gnéed'éto\.tpes: ce n'eft pas brdinai rement de1'etain
pt.lr' mais un melange de
d~ux
parties
d~~tain
fur
une
ETA
partíe de plomb, dont les chauderonniers fe fervent
pour leur étamage.
La poix réíine dont on fe fert dans cette opération
eíl: ábfolument néceífaire , paree que le d 'gré de cha–
lenr qu'on donne au cuivre, fuffit pour c;Jlciner un
peu fa furface;
&
cette altération, quelque légere
qu'elle foit, feroit capable d'empékher l'étain de s'y
unir folidement, íi, par le moyen de .la poix ré–
íine , on ne lui rendoit du phlogiftique <lans le mo–
mentmeme
ottl'~tains'yapplique.
Cettememe poix
réúne empeche auffi la légere calcination qui fe feroit
a
la furface de l'é ain' óu revivifie les petites parties
de cendre d'étain qui auroient pu fe formet pendant
cette opération.
A
l'égard de l'étamage du fer, on commence d'a–
bord par nettoyer parfairement,
&
jufqu'au vif, les
lames de fer noir, ce qui fe fait en les écurant avec
du gres,
&
en les faifant tremper dans des
~aux
aci–
dules, ceta s'Clppelle
décapper
le fer noir; on les eífuie
apres cela, on les feche promptement
l$l:
parfait~ment , puis on les plonge verticalement dans un va–
fe qui contient de l'étain fondu, dont la furface eft
recouverte de graiífe ou ele poix réfine. Ces corps
gras couvrant la furface de l'étain,
&
lui fourniífant
continuellement du phlogifi:ique, ernpechent d'une
part qu'il ne s'y forme de la chaux qui s'oppoferoit
a l'adhérence de l'étain fur le fer;
&
d'un autre part, .
comme le fer paífe au travers de cette matiereinflam- ·
mable, lorfqu'on le plonge dans l'étain, elle ne peut
que rendre auffi la furface de ce meme fer plus pro–
pre
a
rece voir l'étain. Les lames ou plaques de fer
hoir n'ont befoin que de paíler ainíi dans de l'é–
fain fondu pour etre bien éramées'
&
transformées
en fer blanc.
' On emploie auro, ave e Cueces le fel ammoniac dans
l'étamage du fer
&
du cuivre,
&
toujours par
la
meme raifon: d'une part' l'acide de ce fel nettoie
&
décappe p·arfaitement la furface des métaux
a
étamer
&
de l'antre part 'la matierehuil ufe' contenue dans
<!e meme fel 'fournit le phlogifiique
néc-eíf~ire
dans
certe opération ; ainíi, en chauffant ces
métau~
juf–
qh'a un certain point,& les frortantavec du fer
amm~
nlac, on peut y appliquer l'étai.q immédiatement
' apres, il s'y attache tres-bien.
.
Les avantages qu'qn retire de l'étamage font tres-
confidérables: l'étain, métal mou
&
fufible, ne peut
forme,r feul que des vaiífeaux
&
ufienfiles d'un tres–
mauvais fervice 'tres-fujets
a
fe déformerpar lemoin–
dre choc,
&
fe fondant au plus léger dégré de cha–
leur; mais lorfqu'il eíl: appliqué
a
la furface dn cui–
vre
&
du fer,
méta.uxdurs,
&
de tres difficile
fu.
flon, on en fabr
ique uneinfinité d'uíl:enúles d'autant
pln~
commodes , que 1' 'tain dont ils font recouverts
garantit ces métaux de la rouille'
a
laquelle ils font
extremement fujets. I1 efi vrai qu'on reproche avec.
aífez c\e fondement aux vaiífeaux de cuivre
étamés
de,
n'etre pas aífezbie.n
r~couverts
d'étain pour etre abfo–
lument exemptsde contraéterdu
verd-d~
7
gds.Gere–
proche aífez bien fondé efi grave, fu.r-t
out pourles
vaiíféaux de cuivre
étamé
daos lefqu.els ori prépare
&
Or'l
COhferve les alimens.
11
feroit dQnC a propos
de
tie
pas ernployer le cuivre' meme ,
4tamé'
3-
ces.
forres d'ufages, d'autant plus que l'étitin lui-meme
n'eft pas exempt de reproclies du
cot~
de la falubrité,
p tifqueM.Marggrafa découvert qu'il
r:y
en a prefque
póinÉ
cflli
ne confíénn·e de l'arcenic·,
,&
que d'ailleurs
dans l'éta.mage du cuivre, 9n ernploie auffi du
plornb~
autre ' métal tres-malfaifánt; mais cela n'empeche
p~oihéqi/oñ
ne fe ferve dLt cuivre
étamé
pour
U!Je
infi·
n'ité d'autres ufages. On peuf d'ailleurs perfeétionner
b-eaucoup l'étamage 'du cuivre
&
du fer,
&
l'on
y
párviendra certainement íil'on veut avoir fes atten–
tioils convenables aux príncipes fondarnentaux de'
. cet arr, qu'on a expofés dans cet arl:icle.
,
















