
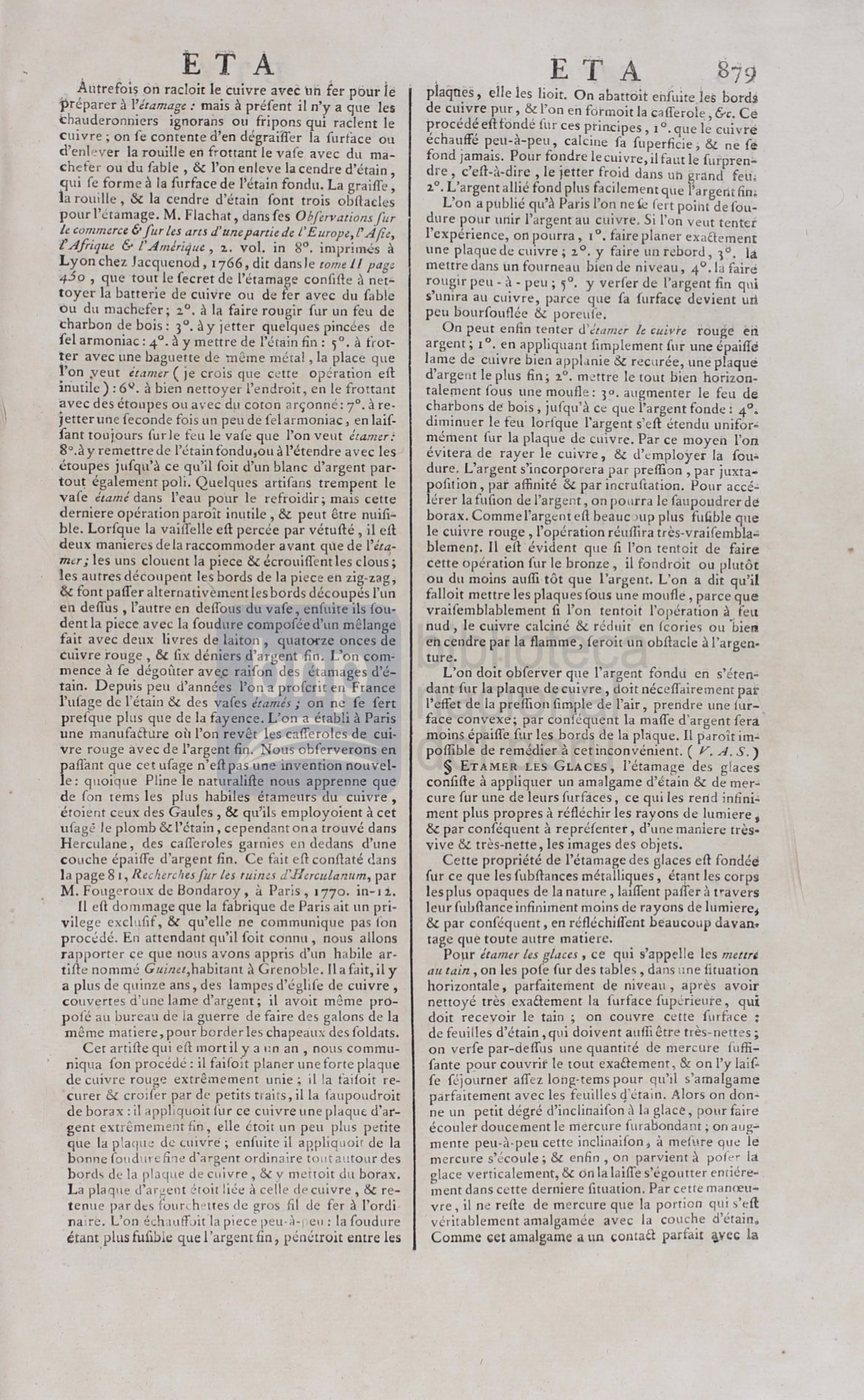
ETA
Autrefois ón racloir
le
cuivre avec
uñ
fer póur fe
j>réparer
a
1'
étamage :
mais
a
préfent il n'y a que les
t hauderonniers
ignorans ou fripons qui raclent le
c ui
vre ; on fe contente d'en dégrai1fer la furtace ou
d'en l~ver
la rouille en frottant le vafe avec du ma–
chefe r o u du fable,
&
l'on e_nleve la cendre d'étain,
q ui fe forme
a
la furface de l'étain fondu. La graiife ,
1a rouille ,
&
la cendre d'étain font trois obíl:ad€s
pour l'étamage.
M.
Flachat, dans fes
O~fervations
fur
í e commerce
&
fur Les arts d'unepartie de
L'E
urop~,
l'
A
ji
e,
t
A/rique
&
tAmérique,
2.
vol. in
8ó.
imprimés
a
Lyon chez Jacqueno.d, rj66, dit dansJe
tome
11
page
4.50
'
que tout le fecret de l'étarnage confifie
a
ner–
toyer la batterie de cuivre ou de fer avec du fable
ou dn rnachefer;
2
o.
a
la faire rougir fur un feu de
tharbon de bois:
J
0
•
ay
jetter quelques pincées de
fel armoniac:
4
o.
ay
mettre de l'étain fin: )
0
•
a
fi·ot–
~er
avec une baguette de tneme métal , la place q ue
l'on yeut
étamer
(
je cro is que cette o pérarion eíl:
in'utile): 6Q.
a
bien nettoyer l'e ndroit , en le fro ttant
avec des étoupes o
u
a vec du coton a n;onné :
7°.
a
re–
jetterune fe conde foi s
un
peu de fel armoniac, en laif–
fant touj,ours fur le
t
u
le vafe que l'on veut
étamer:
8°.a y
remettre de l'étain fondu,ou
a
l'étendre avec les
étoupes jufqu'a ce qu'il foir d'un blanc d'argent par–
tou~
également poli. Quelques artifans trempent le
vafe
étamé
dans l'eau pour le refroidir; mais cetre
derniere opération paroit inutile'
&
peut etre nuifi–
ble. Lorfque la vaiffelle efr percée par vétuíl:é,
il
eíl:
deux manieres
de
la raccommoder avant que de
1'
éta–
mer;
les uns clouent la piece
&
écrouiifent les clous;
les autres découpent les bords de la piece en zig-zag,
&
font paífer alternativementlesbords découpés l'un
eh deífus , l'autre en deífous du vafe, enfuire ils fou–
dent la piece ayec la foudure compofée d'un melangé
fait avec deux livres de laiton, quatorze onces de
éUIVre rouge'
&
fix déniers d'argent fin. L'on com–
mence
a
fe dégottter
o:ve,c
raifon des étamages d'é–
tain. Depuis peu d'années l'on a proferir en France
rufage de l'étain
&
des vafes
étamés ;
on ne fe fert
prefque plus que de la fayence. L'on a établi
a
Paris
une manufatture
Otl
l'on revet les caíferoles de
CUÍ–
vre rouge ávec de l'argent fin. Nous obferverons en
paífant que ce t ufage n'eíl: pas une invention nouvel–
l e : q noiq ue Pline le naturaliíl:e nous apprenne que
de fo n tems les pl us habiles étameurs du cuivre,
étoien t ceux des Gaules,
&
qu'ils employoient
a
cet
ufagé Je plomb &l'étain, cependantona trouvé dans
H erculane, des caiferoles garnies en dedans d'une
couche épaiífe d'argent fin. Ce fa it efi co nfiaré dans
l a page
8
1,
R echerches f ur les ruines
d'Herculanum,
par
M.
Fougeroux de Bondaroy,
a
Paris,
1770 .
in-1
i.
H
efi dommage que la fabrique de París ait un pri–
vilege exclufif,
&
qu'elle ne communiqu e pas fon
procédé. En attendant qu'il foit connu , nous allons
rapporte r ce que nons av ons appris d'un h abile ar–
tiíl:e nommé Guinet,habitant
a
Grenoble .
11
a fait, il
y
a
plus
de
quinze ans, des lampes d'églife de cuivre,
couv~rtes
d'une lame d'argent;
il
avoit meme pro–
p ofé au bureau d e la guerre de faire des galons de la
m
eme matiere ' po ur bo r er les chapeaux des foldats.
C et artiíle qui efi mortil
y
a
nn an, nous commu–
niqua fon procédé : il fai(o it p laner un e forte plaque
de cuivre rouge ex tremement unie;
il
la faifoi t re–
curer
&
croifer par de petits rr ai ts, illa (aupoudroit
de borax:
il
appliquoit fur ce cuiv re un e pl aqu e d'ar–
gent extremement fi.n
~
elle
ét~i t t~n
peu .plus. p erite
que
la
p tac¡u
de cmv re; enfmte
1l
a r.pliq oH de la
b onne fondnt
fi'1
d'a rgenr ordinaire
tOLlt
auto ur des
b ord de la plaque de cuivre ,
&
y mettoit du borax .
L a plaqne d'argen t éroit liée
a
celle de cuivr e ,
&
r e–
tenue pa r des fo ur h nes de gros
fil
de fer
a
l'ordi
naire . L'on éch auff<
it
la
pie
ce peu-a- 1eu: la foud ure
é tant_p lus fufible que l'argen din, p énétroit entre les
E
T
A
879
plaqnes, elle Íes lioit. On aba ttóit enfuite 1es
oord~A
de cuivre pur,
&
l'o n en fo rmoit la caíferole
&c.
Ce
procédé eíl:fo ndé fur ces príncipes
1°.
a ue
1~
cuivre
écha ~ffé p_en-~-peu,
calcine fa
fu'perfi~i e,
&
ne
f~
fond 1ama1s. Pour fondre le cui vre, il faut le fnfpren–
d re, c'efi-a-dire , le jetter fro id dans uh grand feno
2.
0
•
~'argental~i,é
fond plt=S f:cilementque Pa rgeritfino
L on a pübhe qu'a Pans
1
o n ne
(e
fert poiht de fou–
dure pour unir l'argent au cuivre .
Si
l'on veut tenter
l'expérience, on pourra,
r
0
•
fair.e planer exaB:ement
une plaque de cuivre;
2
°.
y faire
un
r ebord ,
1°.
lá
rnetrre dans un fournea u bien de niveau,
4
°
.la fairé
rougir peu-
a .
peu; ;
0 •
y
verfer de l'argent fin q ui
s'unira au cuivre, paree que fa furface devient url
peu bourfouflée
&
poreufe.
On peut enfin t ente r
d'étamer le
cuivre
rouge
éri
argent;
1°.
en appliquant fimplement fur une épaiffe
lame
de cuivre bien a pplunie
&
recurée, une plaqué
d'argent le plus fin;
2
°.
mettre le touc bien horizon–
talernent fous une moufle :
3
o.
augmenter le fe u de
c~a~bons ~e
bois, jufqu'a ce que l'argent fonde
1
1-
9
o
d1m1nuer le fe u lorfque l'argent s'eíl: étendu unifor.,
mérhent fur la plaque de cuiv re. Par ce moyen l'on
évitera de rayer le cuivre,
&
d'
mploy er la fou..
dure . L'argent s'incorpore ra par preffion, par juxta–
pofitioh, paf affitiité
&
p ar incruftation. Ponr accé.;
lérer la fuúon de l'argent, on po ltrra le fa upoudrer de
borax. Comme l'argent efi beauc ::mp plus fu!ible que
le cuivre rouge, l'opération réuilira tres-vraifembla–
blement.
Il
efi ·évident que fi l'on tent oít de faire
cetre opération fur le bronze, il fo ndroit ou plutot
ou du moins auffi·tot que l'argenr. L'on a dit qu'il
falloit mettre les plaques fous une moufle, paree que
vraifemblablement
fi
l'on tentoit l'opération
a
fell
nud, le cuivre calciné
&
réduit en fcoriec; ou ..biea
en cendre par la flamme' feroit un obfiacle
a
l'argen·
ture.
L'oli doit obferver que l'argent fondu eri s'éten..
dant fur la plaque de cuiv re, doit néceifairement par
l'effet de la preffion fimpl e de l'air, prendre une íur–
face convexe; par conféquent la maífe
~'arge nt
ferá
moins épaiife fur les bords de
hi
plaque.
U
paro
ir im–
poffible de remédier
a
cetinconvénient. (
V. A . S . )
§
ETAMER .LES GLACES, l'étamage des glaces
coníifie
a
appliquer un amalgame d'etain
&
de mer..
cure fur une de leurs furfáces, ce qui les rend
i n fi ni~
rnent plus propres
a
réfléchir les raydns de lumiere'
&
par conféquent
a
repréfertrer' d'une maniere tres·
vive
&
tres-nette, les images des objets.
Cette propriété de l'étamage des glaces efi fondée
fur ce que les fubíl:ances métalliques, ét¿¡nt les corps
les plus opaques de la nature' laiífent paífer
a
t tavers
leur fubíl:ance infiniment moins de rayons de lumiere;
&
par conféq uent, en r éfléchiífent beaucoup davan ...
tage que toute autre matie re.
Pour
Üamer Les
glaces,
ce qui s'appelle les
mettrt
au
tain,
on les pofe fur des tables , dans 1ne íit uation
horizontale; parfaiterhent de ni-vea
u,
apres avoir
nettoyé tres exaétement
la
furface fup ' rieute , q"1i
doit recevoir
le
tain ; on couvre ce tte furfa ce :
d.e feuilles d'étain 'qui doivent aufii etre t res- nettes;
on verfe par-deífus une quantité de mer ure fu ffi–
fante p_our couvrit le tout
exaétemen~,
&,
on l'y
lai{~
fe féj o urnet' aífez lóng-te_ms
po,~r
9u
1l s amalgame
parfaitemeot avec les femlles
e!
etam. Alors on don–
ne un petit dégré d'inclinaifo n
a
la
glace' po ur faire
écouler doucement le mercure furáhondant; on aug–
mente peu -a- peu cette jnclínaifon
~
a
mefure que
le
mercure s'écoule;
&
enfin ' on parvient
a
pofer
lá
glace v er ticalement,
&
d n la laiífe s'égo utter entiére–
ment dans cette derniere fituation . Par cette manreu–
vre ,
il
ne refie de me rcure que
la
portion
qt~~ '~ ft
véritabl ement amalgamé e av ec la couche
d
etam.,
Comme
~et
amalgame a
un
<;ontaét: parfait
~ve c
la
















