
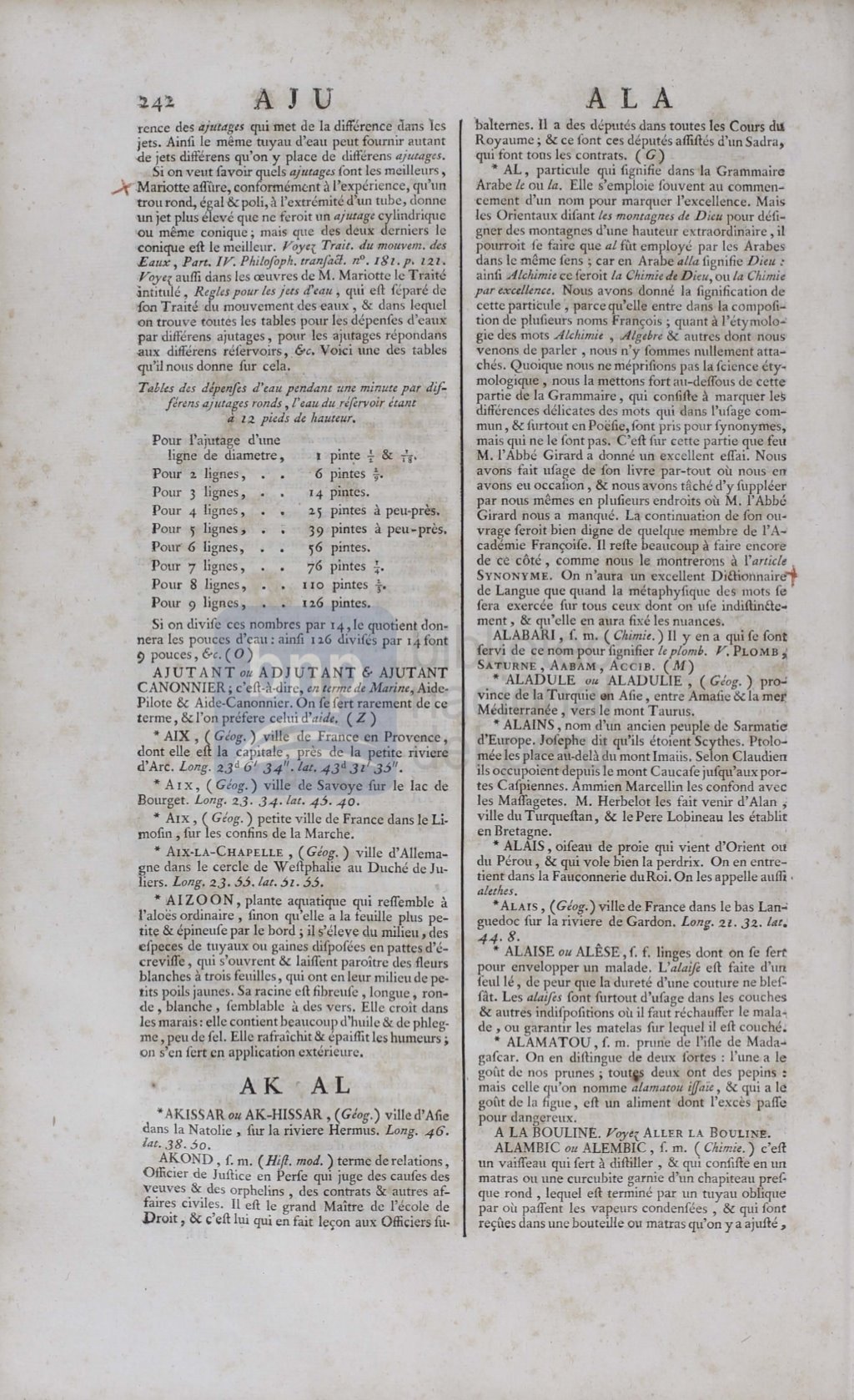
AJU
rence des
IIjutages
qui met ae la diftérence dans 1es
jets. Ainfi le meme tuyau d'eau peut fournir autant
-de jets di/férens qu'on y place de difrérens
a/uuges.
Si on veut favoir quels
ajlltages
{ont les meilleurs,
....ir
Mariotte aífflre, conformément
a
l'expérience, qu'ull
ttou rond., égal
&
poli,
a
l'extrémité.d'un
nlb~, d~llne
un jet plus élevé que Ile feroit un
aJutage
cylm?nque
ou meme conique; mais que des .deux dermers le
conique eíl: le meilleur.
Voye{ Tralt. du nzOllYSJn.
des
Eaux Pare.
IV.
PhiloJoplz. tranfa.c? nO. I8z.p.
Z2l.
Voye/auili
dans les reuvres de M. Mariotte le Traité
~ntitulé,
Regles pour les jces d'eau,
qui eíl: féparé de
{on
Traité du mouvement des eaux ,
&
dans lequel
on trouve toutes les tables pour les dépenfes d'eaux
par di/férens ajutages, pour les ajutages répondans
aux di/férens réfervoirs,
&c.
Voici une des tables
~u'ilnous
donne fur cela.
Tables des dépenfis d'eau pendaTZt une minute plIr
di¡..
¡¿rellS ajlltages ronds
,
l'
eau
du.ré(ervoir étaTZt
a
12
pieds de Izauteur.
Pour f!ajutage d'une
ligne de diamette,
Pour
'2.
lignes,
Pour 3 lignes,
Pour 4 lignes,
POU!
~
lignes,
Pou!'
6
lignes.,
Pour 7 lignes,
Pour 8 lignes,
Pour 9 lignes,
t
pint.e
+
&
fa.
6 pintes
t.
14
pintes.
2
~
pintes a pen·pre's.
39 pintes a pen-pres.
~6
pintes.
76
pintes
~.
110
pintes
t.
126
pintes.
Si 'on divife ces nombres par
14,
le quotient don–
nera les pouces d'eall; ainfi
126
divifés par
14
font
9
pouces,
&c.
(
O)
AJUTANT
ou
ADJUT ANT
&
AJUTANT
CANONNIER; c'eíl:-a-dire,
en terme de Marine,
Aide–
Pilote
&
Aide-Canonnier. On fe fert rarement de ce
terme,
&
l'on préfere celui d'
aide.
(Z)
*
A1X , (
Giog.)
ville de France en Provence,
dont elle eft la capitale, pres de la petite riviere
d'Arc.
Long.
23
d
6'
34".lat.
43
d
3l' 3.5".
*
A
1
X,
(Giog.)
ville de Savoye fur le lac de
Bourget.
Long.
23. 3+
lato
4.5·
40.
*
AIX, (
Giog.
)
petite ville de France dans le Li–
mofin , fur les confins de la Marche.
*
AIX-LA-CHAPELLE ,
(Giog.
)
ville d'AlIema–
gne dans le cercle de \Veíl:phalie au Duché de Ju–
liers.
Long.
23 .
.5.5.lat.
SI .
.5.5.
*
AIZOON, plante aquatique qui re/femble a
l'aloes ordinaire, finon qu'elle a la feuille plus pe–
tite
&
épineufe par le bord; il s'éleve du milieu, des
efpeces de ntyaux on gaines difpofées en pattes d'é–
crevilfe,
qui
s'ouvrent
&
laiKent paroltre des fleurs
blanches
a
trois feuilles,
qui
ont en lelLr milieu de pe–
tits poils jaunes. Sa racine eíl: fibreufe , longue. ron–
de, blanche, femblable
a
des verso Elle crolt dans
les marais; elle contientbeancoup d'huile
&
de phleg–
me, peu de fel. Elle rafralchit
&
épaiffit les humeurs ;
on s'en fert en application extérieure.
AK
AL
"AKISSAR
ou
AK-HISSAR ,
(Giog.)
ville d'Afie
oans la Natolie, fur la riviere Hermus.
Long.
46.
lato
38.
.50.
A~OND,
f. m.
CHifl.
modo
)
termc derelations,
OHicler de Jufiice en Perfe qui juge des caufes des
v~uves
.&.
des orphelíns , des contrats
&
autres af–
farres cIViles.
Il
efi le grand Maitre de I'école de
DIOit,
&
c'cíl: luí 'lui en fait
le~on
allX Officiers fu-
ALA
balternes.
11
a des députés dans toutes les Cours dI!
Royaume;
&
ce font ces députés ailiíl:és d'un Sadra,
'luí font toas les contrats.
(G)
" AL, particule qui fignifie dans la Grammaire
Arabe
le oula.
Elle s'emploie fouvent au commen–
cement d'un 110m pour marquer I'excellence. Mais
les Orientaux difant
les montagnes de Dult
pour défi–
gner des montagnes d'une hauteur extraordinaire , il
pourroit fe faire que
al
fut employé par les Arabes
dans le m&me fens ; car en Arabe
alta
íigniJie
Dieu :
ainfi
Alclzimie
ce feroit
la Chimie de Dieu,
ou
la Clzimie
par e:r;celLence.
Nous avons donné la fignification de
cette particule , parce qu'elle entre dans la compofi–
tion de plufieurs noms
Fran~ois;
quant
a
l'étymolo–
gie des mots
Alclumie
,
Algebre
&
atltres dont nous
venons de parler , nous n'y fommes nullement atta–
chés. Quoique nous ne méprifions pas la fcience éty–
mologíque , no
liS
la mettons fort au-de/fous de cette
partie de la Grammaire, <fui confiíl:e a marquer les
di/férences délícates des mots quí dans I'ufage com–
mun,
&
fi.lrtout en Poefie, font pris pour fynonymes,
mais qui ne le font paso C'eíl: ftLr certe partie que feu
M. l'Abbé Gírard a donné un excellent e/fai. Nous
avons fait ufage de fon lívre par-tout Oll nous en
avons eu occaJion ,
&
nous avons
t~ché
d'y fuppléer
par nons
m~mes
en plufieurs endroits on M. l'Abbé
Girard nous a manqué. La conrinuation de fon ou–
vrage feroit bien digne de quelque membre de l'A–
cadémie
Fran~ífe.
Il
reíl:e beaucoup a faire encore
de
ce
coté, comme nous le montrerolls
a
l'
articl~.J.
SYNONYME. On n'ama un exceHent Diaiol'lnaire ,.
de Langue que quand la métaphyfique des mots fe
fera exercée fur tous ceux dont on ufe indiffinéte–
ment,
&
qu'elle en ama fixé les nuances.
ALABARI,
f.
m. (
Chimie.
)
II
Y
en a qui fe font
fervi de ce nom pour íignifier
le plomb. V.
PLOMB
~
SATURNE, AABAM, ACCIB.
CM)
.. ALADULE
ou
ALADULIE,
(Giog.)
pro";
vince de la TurCJLlie 6n Afie, entre Amafie
&
la mer
Méditerranée, vers le mont Taurus.
*
ALAINS , nom d'tm ancien peuple de Sarmatie
d'Europe. Jofephe dit CJLt'ils étoient Scythes. Ptolo–
mée les place au-dela du mont Imaiis. Selon Claudien
ils occupoient depuis le mont Caucafe jufCJLt'aux por–
tes Cafpiennes. Ammien Marcellin les confond avec
les Ma/fagetes. M. Herbelot les fait venir d'Alan ;
ville du Tmqueíl:an,
&
lePere Lobineau les établit
en Bretagne.
.. ALAIS , oifeau de proie qui vient d'Oriertt Ol!
du Pérou,
&
qui vole bien la perdrix. On en entre–
tient dans la Fauconnerie duRoi. On les appelle auffi .
tllet/tes.
..ALAIS ,
(Glog.)
ville de France dans le bas Lan";
guedoc fur la riviere de Gardon.
Lonc.
2l.
32.
Itu.
44·8.
*
ALAISE
ou
ALESE , f. f. linges dont on fe fert
pom envelopper un malade.
L'alalfe
eíl: faite d'un
fell.llé, de pem CJLte la dureté d'une courure ne blef–
fato Les
alaifis
font furtout d'ufage dans les couches
&
autres indifpofitions ou il faut réchau/fer le
mala~
de , on garantir les matelas fur leCJLlel il eíl:
couché~
.. ALAMATOU, f. m. prune de ['iíle de Mada..
gafcar. On en diffingue de deux fortes : l'une a le
, goíh de nos pmnes ;
tout~S
deux ont des pepins :
mais ceHe qu'on nomme
alamatou iffa'ie,
&
CJLLÍ a le
gOflt de la figue, eíl: un aliment dont
l'exd~s
pa/fe
pom dangereux.
A LA BOULINE.
Voye{
ALLER LA BOULINE.
ALAMBrC
ou
ALEMBIC, f. m.
(Clzimie.)
c'eíl:
un vaiífeau qui fert
a
diftiller ,
&
qui confiíl'e en lm
matraS
OH
une curcllbite garnie d'un chapiteau pref.
que rond , lequel eíl: terminé par un nlyau oblique
par oa paífent les vapeurs condenfées ,
&
CJLIÍ fone
re~f¡es
dans une bouteille
0\1
matrasqu'on
y
a ajllíl:é,
















