
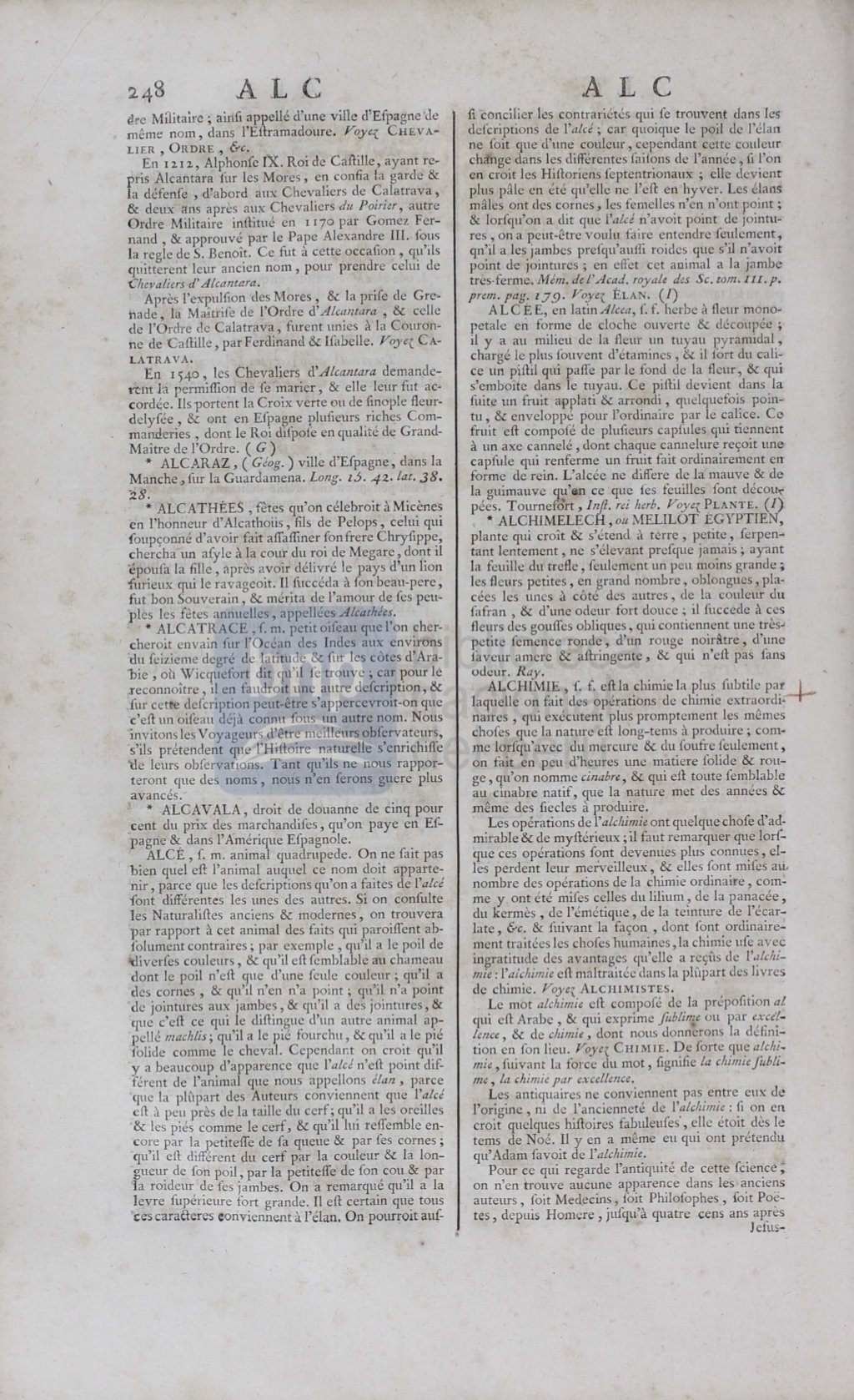
ALe
tlre Militaire; airtú appellé d'une ville d'Efpagne'cle
meme nom, dans l'Efuamadoure.
Voyez
CREVA–
LIER , ORDRE ,
{"c.
En
12. 12.,
Alphonfe I')l:. Roi de Caítille, ayant re–
pris Alcantara fur les Mores, en confia la garde
&
la défenfe , d'abord aux Chevaliers de Calatrava,
&
deux
:tns
apres aux Chevaliers
<fu Poirier,
autre
Ordre Militail'e iní!:itué en
1 170
par Gomez Fer–
nand ,
&
approuvé par le Pape Alexandre II!. fous
la
regle de S. Benoit. Ce fut
a
cette occaúon , qu'ils
quitterent lem ancien nom , pOlU' prendre celui de
Clzevaliers d'Aleantara.
Apres l'expulúon des Mores,
&
la prife de Gre–
hade, la Maitrife de l'Ordre
d'Alea1¡tara
,
&
celle
de l'Ordre de Calatrava, fment unies
a
la Comon–
ne de Callille, parFerdinancl
&
Ifabelle.
Voye"
CA–
LATRAVA.
En
1
540, les Chevaliers
d'Aleantara
demande–
rtnt la permiffion de fe marier,
&
elle leUT fut ac–
cord~e.
lis vortent la Croix verte ou de finople fleur–
delyfée ,
&
ont en Efpagne plufieurs rich",s Com–
mand:eries , dont le Roi dilpofe en qualité de Grand–
Maitre de l'Ordre. (
G)
*
ALCARAZ, (
G¿o.g.
)
ville d'Efpagne, dans la
Manche., fur la Guardamena.
Long.
d.
42.lat.
38.
'28.
*
ALCATHÉES, fetes qu'on célebroit
a
Micenes
en l'honneur d'Alcathoiis , fils de Pelops, celui qui
{oup<;onné d'avoir fait aíI'aíf¡ner fonfrere Chryíippe,
chercha un afyle
a
la COUT du roi de Megare, dont il
'epóufa la filie, apres avoir délivré le pays d'un Iion
furieux qui le ravageoit. Il fuccéda
a
fon beau-pere,
fut bon Souverain,
&
mérita de l'amour de fes peu–
pIes les fetes annuellcs , appellées
Alcathées.
*
ALCATRACE , f. m. petit oifean que l'on cher–
cheroit envain fur l'Océan des Indes aux environs
"du feizieme degré de latitude
&
fUf les cotes d'Ara–
bie , oh \Vicquefort dit qll'il fe trouve ; car pOlU
le
reconnoitre,
jI
en faudroit une autre defcription,
&
fur cette defcription peut-etre s'appercevroit-on que
c'eí!: un oifeau déja connu fous un atttre nomo Nous
invitons les Voyageurs d'etre meilleurs obfervateurs,
's'ils prétendent que I'Hilloire natttrelle s'enrichifle
'tic leurs obferva!:Íons. Tant qu'ils ne nous rappor–
teront que des noms, nous n'en ferons guere plus
avancés.
*
ALGAVALA, droit de douanJ1e de cinq ponr
cent du prix des marchandifes, qu'on paye en Et:'
pagne
&
dans l'Amérique E(pagnole.
ALCÉ, f. m. animal c¡uadrupede. On ne fait pas
bien quel efl: l'animal auque! ce nom doit apparte–
nir, paree que les de(criptions qu'on a faites de
l'al""
{ont dilférentes les unes des autres. Si on confuIte
les Naturaliíl:es anciens
&
modernes, on trouvera
l)ar rapport
a
cet animal des faits qui paroiíI'ent abo
folument contraires; par exemple , qu'il a le poil de
-ruver(es couleurs,
&
qu'il eíl: (emblable au chameau
dont le poil n'eí!: que d'une (eule couleur; qu'il a
des comes,
&
qu'il n'en n'a point; qu'il n'a point
de jointures aux jambes ,
&
qu'il a des jointnres,
&
que c'eí!: ce qui le dillingue d'un autre animal ap–
pellé
mac/zlis;
qu'il a le pié fourchu,
&
qu'il a le pié
folide comme le cheval. Cependant on croit qu'il
y
a beaucoup d'apparence que
l'alcé
n'eíl: point dif–
férent de l'animal que nous appellons
¿lan,
parce
que la pltlpart des Auteurs conviennent que
l'alcé
eí!: a peu pres de la taille du cerf; qu'il a les oreilles
&
les piés comme le cerf,
&
'lu'illui reíI'emble en–
core par la petiteíI'e de {a queue
&
par (es comes;
qu'il eíl: différent du cerf par la couleur
&
la lon–
gueur de fon poil, par la petiteíI'e de (on cou
&
par
1a roideur de fes jambes. On a remarqué qu'il a la
levre (upérieure fort grande. Il eíl: certain que tous
tes caraUeres eonviennent
a
l'élan,
On poun'oit
al1e-
ALe
fi
concilier les contrariétés qui (e trol1vent dans les
de(criptions de
l'alcé;
car quoique le poil dc l'élan
ne (oit que d'une couleur, cependant cette couleur
change dans les dilférentes (ailons de l'année, fi 1'0n
en
croit les Hií!:oriens (eptentrionaux ; elle devient
plus pate en été qu'elle ne l'eíl: en hyver. Les élans
males ont des comes, les femelles n'en n'ont point;
&
lorfc¡u'on a dit que
l'alcé
n'avoit point de joinnl–
res, on a peut-etre voulu faire entendre (eulement,
qn'il a les jambes pre(qu'auffi roides que s'il n'avoit
point de jointmcs ; en efFet cet aoimal a la jambe
tres-ferme.
M¿m. del'Acad. royale des Se. tomo
I LI.
p.
prem. pago
l79'
Voye{
ÉLAN.
(1)
AL C É E, en latín
Alcea,
f.
f.
herbe
a
fleur mono-–
petale en forme de eloche ouverte
&
découpée ;
il
Y
a au milieu de la fleur un tuyan pyramidal,
chargé le plus (ouvent d'étamines ,
&
il iOrt du cali–
ce un piful qtú pa{[e par le fond de la fleur,
&
qui
s'emboite dans le nlyau. Ce pillil devient dans la
fiJita un fmit applati
&
arrondi, quelquefois poin–
nt,
&
enveJoppé pour I'ordinaire par le calice. Ca
fnút eí!: compo(é de plufieurs cap{üles qtÚ tiennent
a un axe cannelé , dont chaque cannelure rec;oit une
cap(ule 'luí renferme un fnüt fait ordinairement cn
forme de reino L'alcée ne differe dc la mauve
&
de
la gttimauve qu'sn ce que (es feuilJes (ont
déco~
pées. Tournefort,
Infl. rei
h.rb. Voye{
~LANTE.
(1)
*
ALCHIMELECH,
ou
MELILOT EGYPTIEN,
plante qui croit
&
s'étend aterre, petite, (erpen–
tant lentement , ne s'élevant pre(que jamais; ayant
la feuille du tceHe, feuIemcnt un peu moins grande;
les flenrs petites , en grand nombre, oblongues , pla–
cées les unes
a
coté des autt'es, de la couleur du
(afran )
&
d'une odeur fort douce ; il fuccede
a
ces
fleurs des gouíI'es obliques, 'lui contiennent une tres–
petite (emen<re ronde, d'un rouge
noir~tre,
d'une
úlvenr amere
&
afuingente,
&
qui n'eíl: pas (ans
odeur.
Ray.
ALCHIMIE ;
f.
f.
eilla chimie la plus fttbwe pat I
laquelle on fait des opérations de chimie extraordi.-t–
naires, c¡ui exécutent plus promptement les memes
cho(es que la nattu'c eí!: long-tems
a
produire; com-
me lor(qll'avec du mercttre
&
du (oufre (euJement,
on ú¡jt en peu d'heures une matiere (olide
&
rOll-
ge, qu'on nomme
cinabre,
&
qui eH toute femblable
au cinabre natif, que la nature met des années
&
meme des fieeles
a
produire.
Les opérations de l'
alc/timie
ont qllelquechofe el'ad·
mirable
&
de myíl:érieux; il faut remarquer que Jori–
que ces opérations [ont devenues plus connues, el–
les perdent leur merveilleux,
&
elles (ont mifes a\i.
nombre des opérations de la chimie ordinaire, com–
me y ont été mires celles dulilium, de
la
panacée ,
du kermes, de l'émétique , de la teinttrre de J'écar–
late,
&e.
&
(uivant la fac;on , dont (ont ordinaire–
ment traitées les chofes hUll1aines, la chimie u(e avec
ingratitt,de des avantages qu'elle a re<;fls de
I'.zlch¡–
tllie:
l'
alchimie
eíl: maltraitée dans la plúpart des Evres
de crumie.
Voye"
ALCHIMISTES.
Le mot
alehimie
eíl: compo(é de la prépofition
al
qui eí!: Arabe ,
&
c¡ui exprime
fublime
ou par
exce'l–
Lenee,
&
de
c/lÍmÍt,
dont nous donnerons la défini–
tíon en (on lieu.
Voye"
CHIM1E. De forte que
alclli–
mi.
,
ftúvant la force du mot, fignifie
la
clzimiefubli–
me, la chimie par exeellence.
Les antiquaires ne conviennent pas entre eux de
l'origine, ni de l'ancienneté de
l'alcl,imie:
Ú
on en
croit quelques hiíl:oires fabuleu{es', elle étoit des le
tems de Noé. II y en a meme en qui ont prétendu
<jll'Adam {avoit de
l'alclzimie.
POllr ce c¡ui regarde l'antiquité de cette (cience;
on n'en trollve aucune apparence dans les anciens
auteltrS, {oit Medecins, foit Prulo(ophes, foit Poe–
tes, depuis Homere, jll{qu'a quatre cens ans apres
Je(lI -
















