
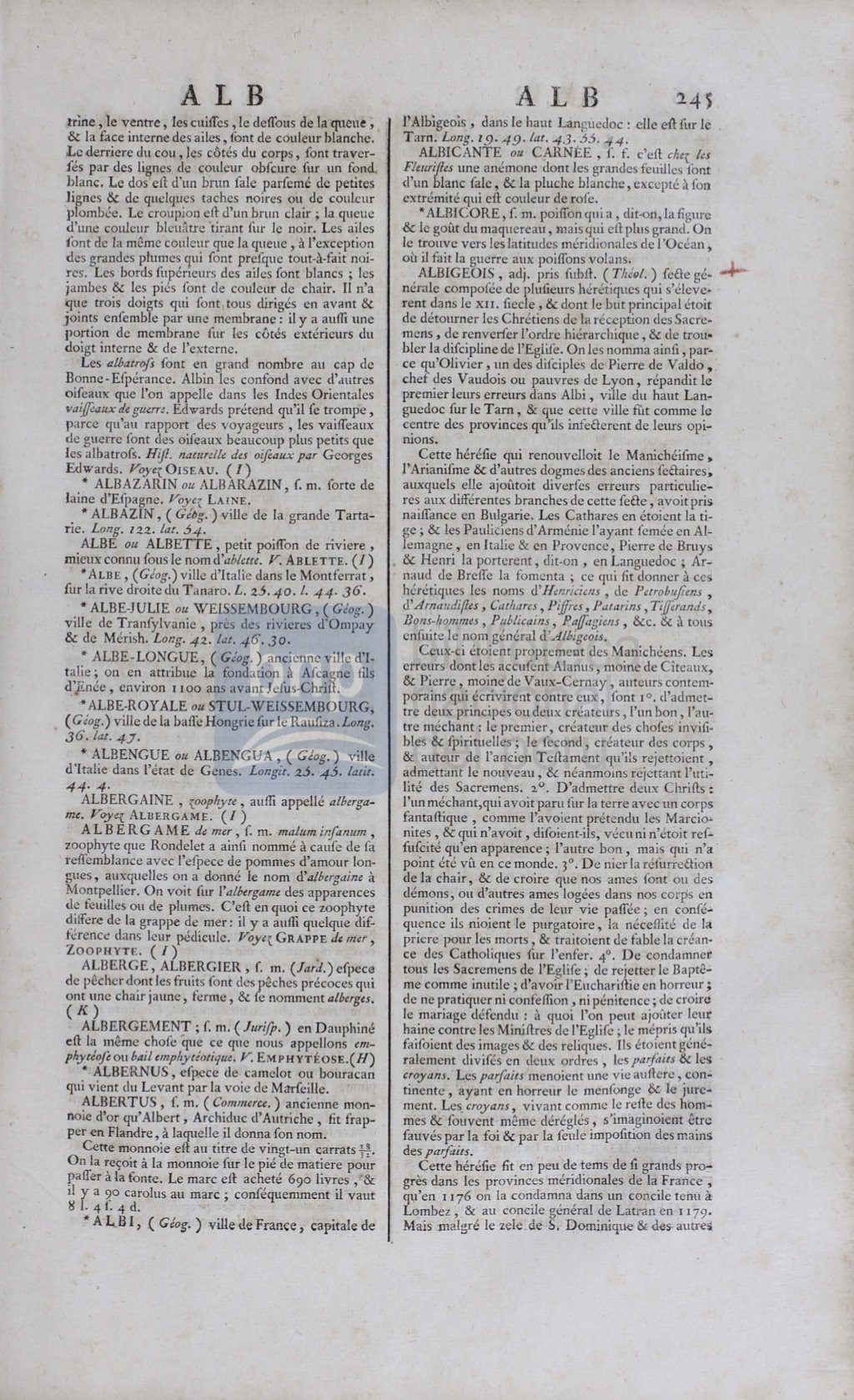
ALB
trine, le ventre, les euilfes , le delfous de la quene ,
&
la faee interne des ailes, (ont de eouleur hlanche.
Le
derriere du cou , les catés du eorps, font traver–
fés par des liqnes de couleur obfcure ftu un fond
blanc. Le dos ell: d'un bnm fale parfemé de petites
lipnes
&
de quelques taches noires ou de eouLeur
Plombée. Le croupion efr d'un brun elair ; la queue
a'une couleur bleuatre -tirant ftu le noir. Les ailes
10nt de la meme couleur que la queue ,
a
I'exception
aes grandes plumes qui font prefque toud.-fait nai–
res. Les bords fupérieurs des aiJes font blancs ; les
jambes
&
les piés font de couienr de chair.
11
n'a
<¡ue trois doigts qui (ont,tous dirigés en avant &
joints enfemble par lme membrane: il y a auffi une
portion de membrane fur les cotés extérieurs du
doigt interne
&
de l'eJ..'terne.
Les
alhamys
font en grana nombre au cap de
Bonne-Efpérance. Albin les confond avee d'autres
oifeaux c¡ue l'on appeJle dans les lndes Orientales
vaiffiaux de guerreo
Edwards prétend c¡u'il fe trompe,
paree c¡u'au rapport des voyageurs , les vaiiTeaux
de guerre font des oifeaux beaucoup plus petits que
les albatrofs.
Hiji. namrelle des oiftaux par
Georges
Edwards.
Voye\.
OISEAU.
(1)
*
ALBAZARIN
OIl
ALBARAZIN, f. m. forte de
laine d'Efpagne.
Voyez
LAINE.
*
ALBAZIN , (
Gél>g.
)
viUe de la grande Tarta–
rie.
Long.
Z22.
lato
's4-
ALBE
OIl
ALBETTE, petit poiiTon de riviere ,
mieux corrnu fous le nom
d'ablette. V.
ABLETTE.
(1)
*
ALBE ,
(Glog.)
ville d'Italie dans le Montferrat,
fur la rive dl'Oitedu T anaro.
L.
2.5.40.
l.
44- 36.
*
ALBE-JULIE
OIl
WEISSEMBOURG , (
Giog. )
ville de Tranfylvanie , pres des rivieres d'Ompay
&
de Mérish.
Long.
42.
lato
46.
30.
*
ALBE-LONGUE, (
Géog.)
ancienne vüle d'I–
talie ; on en attribue
la
fondation
a
Afeagne fils
d'.Enée, environ 1100 ans avant
J
efus-Chrifr.
*
ALBE-ROYALE
OIl
STUL-\VEISSEMBOURG,
(Géog.)
vüle de la baile Hongrie [ur le Rauíiza.
Long.
36.
lat·4.7·
*
ALBENGUE
OIl
ALBENGUA, (
Géog.)
ville
d'Italie dans I'érat de Genes.
Longit.
2's.
4.5.
latit.
44- 4-
ALBERGATNE ,
{oophyte,
auffi appellé
alberga–
me. Voye{
ALDERGAME.
(1)
ALBERGAME
tÚ
mer,
r.
m.
maluminJanum,
zoophyte que Ronde1et a ainíi nommé
a
caufe de fa
l'eiTemblance avec I'efpece de pommes d'amour Ion–
gues, auxquelles on a donné le nom
d'atbergaine
a
Montpellier. On voit fur
I'albtrgame
des apparences
d~
feuiUes ou de plllmes. C'efr en quoi ce zoophyte
~lffere
de
la
grappe de mer: il ya aufli quelc¡ue dif–
tJrenc~
dans Icur pédicule.
Voye\.
GRAPPE
de
mer,
ZOOPRYTE.
(1)
ALBERGE, ALBERGIER,
r.
m.
(Jard.)
efpece
de p&eher dont les fruits font des p&ches précoces 'Iui
ont une ehair jaune, ferme,
&
fe nomment
albuges.
(K)
ALBERGEMENT ;
f.
m. (
Jurifp.)
en Dauphiné
efr la meme chofe que ce que nous appellons
em–
phytéofl
ou
bail tmp/L)'téotiqlU.
V.
EMPHYTÉOSE.(
H)
*
ALBERNUS , efpece de camelot ou bouracan
qlli vient du Levant par la voie de Mar(eüle.
ALBERTUS, f. m.
(Comlllerce. )
ancierrne mon–
noie d'or qu'Albert, Archiduc d'Autriche, lit fra p–
per en Flandre,
a
laquelle ü donna fon nomo
Cette monnoie eíl: au titre de vingt-Lm carrats
H.
On la re<;oit
a
la monnoie fm le pié de matiere pour
patfer
a
la fonte. Le marc efr aeheté 690 livres ,
&
iI
Y
a 90 carolus au mare ; conféquemment il vaut
¡¡
1.
4f. 4 d.
-*
A L..B 1,
(Giog. )
vílle de France, capitale de
ALB
l'Albigeois, dans le llam Languedoc: elle eíl:fm le .
Tarn.
Long.
19'
49·
lato
43·
's.5. 44.
ALBICANTE
ou
CARNÉE, f. f. c'eíl:
che\. üs
FLeurijies
une anémone dont les grandes feuilles font
d'un blanc fale, & la pluche blanche, exeepté
a
fon
extrémité 'luí eíl: couleur de rofe.
..ALBICORE, [. m. poiiTon qui a, dit-on, la ligare
&
le gout du maqllereau, maisqui eíl: pllls grand. On
le trouve vers les latitudes méridionales de l'Océan,
Ol! il fait
la
guerre aux poiiTons volaos.
ALBIGEOIS,
adj.
pris filbfr.
(Thélill.
)
feae gé.
~~
nérale compo(ée de pluiieurs hérétic¡ues qui s'éleve·
rent dans le
XII.
fieele, & dont le but principal étoit
de détourner les Chrétiens de la réception des Sacre–
mens, de renverfer l'orru'e hiérarchic¡ue,
&
de trouo
bler la difeipline de l'Eglife. On les nomma ainfi, par-
ee qu'Olivier, un des difciples de Pierre de Valdo,
chef des Valldois ou pauvres de Lyon, répandit le
premier leurs erreürs dans Albi , ville du haut Lan–
guedoc fur le Tarn,
&
que cette ville fíh comme le
centre des provinces qll'i1S infeélerent de leurs opi–
ruons.
Cette héréíie qui renouvelloit le Maruchéifme
~
l'ArianiGne
&
d'autres dogmes des anciens
feélaires~
auxc¡uels elle ajoiitoit diverfes erreurs particulie–
res aux différentes branches de cette feae, avoit pris
naiíTance en BlIlgarie. Les Cathares en étoient la ti–
ge;
&
les Pallücíens d'Arménie l'ayant femée en AI–
lemagne , en Italie
&
en Provence, Pierre de Bmys
&
Henri la porterent, dit-on , en Languedoe ; Ar–
naud de BreiTe la fomenta; ce qui lit donner
a
ces
hérétiqlles les noms d'
Hmriciells
,
de
Petrobujiens ,
d'Amaudi(les, Cathares , Piffres, Patarins, Tiffirands,
Bons-/lOmmes, Publicains, Paj{agiens ,
&c.
&
a
tOllS
enfuite le nom général
d'Albigeois.
Ceux-ci étoient propremeot des Manichéens. Les
erreurs dont les accufent Alanus, moine de Citeaux,
&
Pierre, moine de Vaux-Cernay, auteurs contem–
porains c¡ui écrivirent contre ellX, font
l°.
d'admet–
tre dellx principes ou deux eréateurs, l'tm bon, l'au–
tre méchant : le premier, eréateur des chofes inviíi–
bIes
&
fpirituelles; lé ü!cond, créateur des corps ,
&
auteur de l'ancien Teframent c¡u'ils rejettoient ,
admettant le nouveall,
&
néanmoins rejettant I'uti–
lité des Sacremens.
2.°.
D'admettre deux Chrifrs :
l'tmméchant,quí avoit paru fur la terre avec un corps
fantafric¡ue , comme l'avoient prétendu les Marcio·
nites ,
&
'luí n'avoit , difoient-ils, vécu ni n'étoit re("
[ufeité ,¡u'en apparence; l'autre bon, mais qui n'a '
point été
Vll
en ce monde. 3°. De nier la réturreaion
de la chair,
&
de croire que nos ames font ou des
démons, Ol! d'autres ames logées dans nos corps en
punirion des erimes de leur vie paiTée; en confé–
c¡uence ils niojent le purgatoire, la nécefiité de la
priere pour les morts ,
&
traitoient de fable la créan–
ce des Catholi'lues fur I'enfer.
4°.
De condamner
tOllS les Saeremens de l'Eglife; de rejetter le Bapte–
me comme inutile ; d'avoir l'Eucharifrie en horreur ;
de ne pratiquer ni eonfeffion, ni pénitence; de croire
le mariage défendu :
a
quoi I'on peut ajoí'tter leur
haine contre lesMinifrres de l'Eglife ; le mépris qll'ils
faifoient des images
&
des re!iques. lis étoie?t géné–
ralement divifés en deux ordres , les
parfaus
&
les
croyans.
Les
parJaits
menoíent une vie au/l:ere ,.con"
tinente, ayant en horreur le menfonge
&
le Jure–
mento Les.
croyans,
vivant
eo~me ,~e re~e ~es
h?m–
mes & fouvent meme dérégles, s Imaglll0lent etre
fauvés par la foi
&
par la fenle impoíition des mains
des
parfoils.
Cette héréfie ht en peu de tems de íi grands pro:–
gres dans les provinces méridionales de la France ,
c¡u'en
1
176 on la eondamna -dans un concile tenu
a
Lombez,
&
au concile général de Lat:ran en 1179.
Mais malgré le zele de S, Dorninique
&
des autl·C&
















