
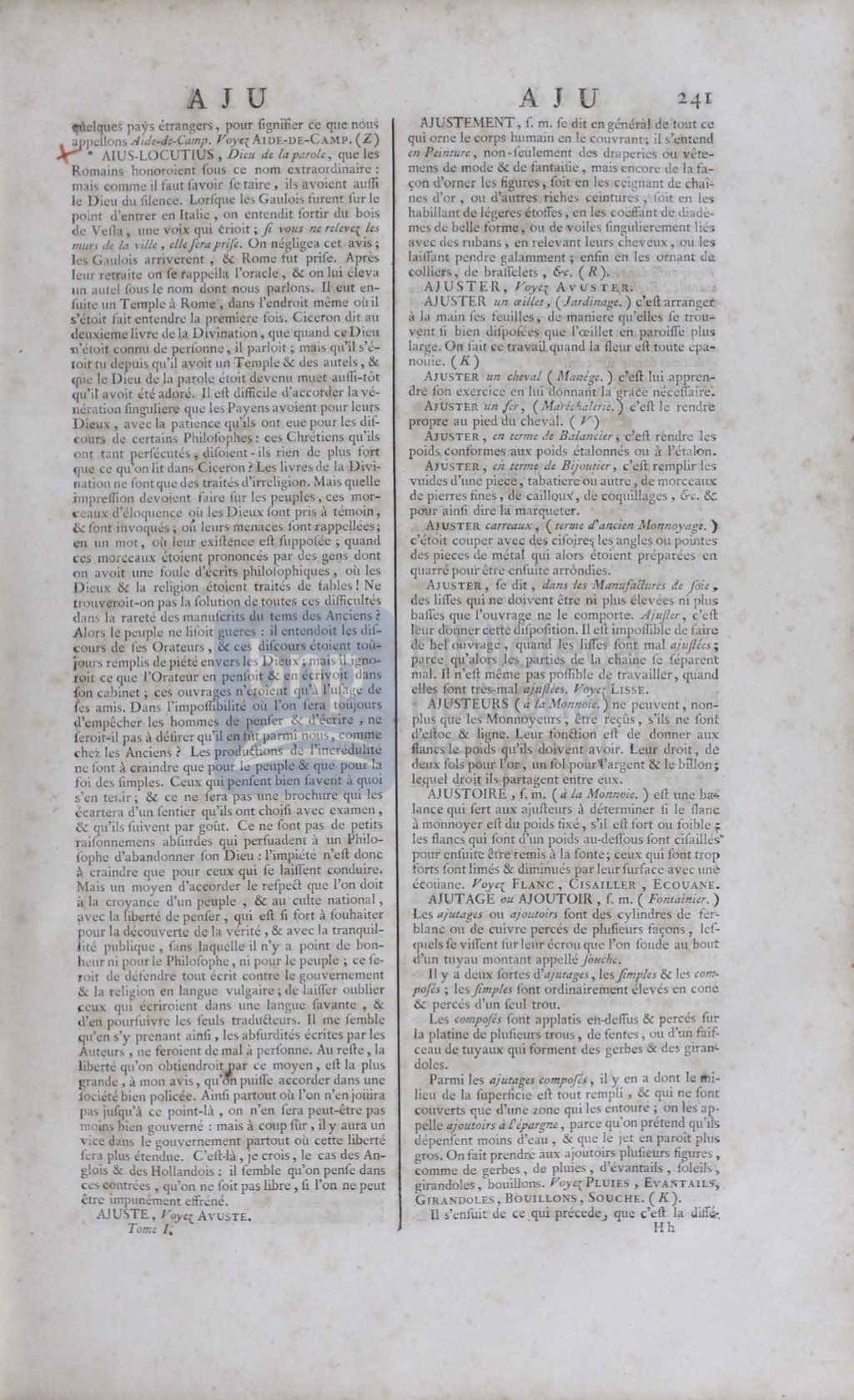
f¡1.\elques pays étraogers, pOlLr figniner
ce
que nous
3jJpcllons
Aide-d¿-Camp.
VoyetAIDE-DE-CAMP.
(Z)
.. ArUS-LOCUTIUS,
Ditll d. la paroto,
que les
Romains honoroient {ous ce nom extraordinaire:
mais comme il faut {avoir {e taire,
ils
avoiem auffi
le Dieu du filence. Lor[qlle les Gaulois furent {ur le
poínt d'entrer en Italie , on cmendit {ortir du bois
de Vena, une voix qui trioir;
ji vous ne releve{ les
mur.¡
d. la
vi/le, elle
flra prift.
On négligea cer avis;
les Gaulois arriverent,
&
Rome nlt prife. Apres
leur retraite on {e rappella I'oraclc,
&
on llli éleva
un autel {OU5 le nom dont nous lJarlons. TI cut en–
fuite un Temple
¡\
Rome, dans l'endroit
m~me
ollil
s'éroit fait enrendre la premiere fois. Ciceron dit atl
dcuxieme livrc
del~Divination,
que quand ceDieu
n'éroit connu de ver{onne, il parloit; mais qll'il s'é–
toit tu depuis c¡u'il ayoit un Temple
&
des autels,
&
(fllC le Dieu de la paroic étoit devenu muet aulli-tot
qu'il avoit été adoré,
Il
ell: difficile d'accordcl' la vé–
nération fillguliere
(IUC
les Payens avoient pom leurs
DicllX, avec la patience qu'tls ont eue pom les di{–
cour de certains Philolophes: ces Chrétiens <fll'ils
ont tünt pcrfécutés, difoient -ils rien de plus f9rt
<ltle ce qu'on lit dans Cieeron
?
Les livres de la Divi–
natiol1ne {ont que des traités d'ineligion. Mais <fllclle
jmpreffion devoient fau'e {m les peuples, ces mor–
ceaux d'éloquence Olt les Dieux {ont pris
a
témoin,
&
tonl invoqués; ofi lellrs menaces [ont rappellées;
en un mot, 011 leur exill:ence ell: fuppofée ; quand
ces morceaux étoient prononcés par des gells dont
on avoit une foule d'ccrits philolophiques, oa les
Diellx
&
la religion étoient traites de fabIes
!
Ne
trouveroit-on pa la {olution de tontes ces diffienltés
dans la rarete des mann(crits dll tems des Anciens
?
Alors le peuple ne li{oit gueres : il entandoit les dif–
conrs de {es Oratelll's,
&
ces di{cours étoient toí't–
jours l'emplis de piété envers les Dieux ; mais il igno–
r0it ce que l'Ol'ateur en pen{oit
&
en éerjvoit dans
ron cabinet; ces ouvrages n'éroient qll'a l'n{age de
fes amis. Dans I'impoílibilité 011 ron ¡era tOlljours
d'empeeher les hommes de pen(er
&
d'ecrire , ne
{eroit-il pas a delirer qu'il en
fi.ltpamu nous, eomme
chc2. les Anciens? Les produfrions de l'incrédlllité
De font
a
cl'ainelre que pour le petlple
&
que pour la
foi des ftmples. Ceux <flli penfent bien {avent
a
<flloi
s'cn
tel.ir;
&
ce ne {era pas une brochure qui les
écartera d'un fentier <fll'ils ont choifi aveG examen,
&
cfll'ils {uivent par gollt. Ce ne font pas ele petits
rai(onnemens abrllrdes qui perfuadent
a
un Phi10-
íophe d'abandonner ron Dieu : l'impiété n'ell: done
¡\
craindrc que pour eeux 'luí fe lailfcnt eondllire.
Mais un moyen d'aecorder
le
refpeé!: que ron doit
¡I la croyance d'un peuple ,
&
au culte national ,
avec la liberté de penfcr, 911i efr fi fort
a
{ouhaiter
ponr la découverte de la verité,
&
avec la tranquil–
Jité publique, fans laquelle iln'y a point de bon–
hcur ni pOllf le Philo{ophe, ni pour le peuple ; ce {e–
roit ele détendre tont écrit conrre le gouvernement
&
la rc1igion en langue v111gaire; de laiífer oublier
ceux qui écriroient dans une langue {avante,
&
el'en pourlilivre les {euIs traduél:eurs.
Il
me femble
qll'en 'y prenant ainfi, lcs ab{urdités éerites par les
AutelLrS , ne feroient de mal
a
perfonne. Au rene, la
liberté <fll'on obtiendroit¡ar ce moyen, efr la plus
grande,
a
mon avis, <fll'on pui1Te accorder dans une
:lociete bien policée. Ainfi partout Otl I'on n'en joiüra
pas jlúqu'a ce point-la , on n'en {era peut-etre pas
1ll0Íll bien gouverné : mais a coup ílIr ,
il
Y aura un
vice dans 1 gouvernement partout 011 eerte lilierté
:I<:ra plus étendue. C'eí1:-l;\, je erois, le cas des An–
b
lois
&
des Hollandois: il {emble <fll'on penfe dans
C(!S
eontrécs <fll'on ne {oit pas lilire , fi l'on ne peut
tr impunement ¡frené.
AJ
TE,
rOJt{
Ay STE.
Tom l .
AJU
AJUSTEMENT, f,
~.
fe dit en générál de tout ce
ql11
orne le corps h.Il1l1alll en le couvrant; il s'entend
en
Púnnlr~,
non-leulement des draperics Ol!
v~te
mens de mode
&
de fantailie, mais encore de la fa–
s:on d'orner les figl1l'es, {oit en les ceignant de chal–
nes d'or, ou d'autres riehes ceÍlltw'es, (oit en les
habillant de légeres étoJFes, en les eoeffiint de diadi:–
mes de belle forme, on de voiles fmguliercment liés
avec des rubans, en relevant leurs eheveux, on les
laiífant pendre galamment; enfin en les ornant de.
colliers, de braífclets ,
&c.
(R),
AlUSTER,
VoyC{
AVUSTF,R,
AJUSTER
un
aillet,
(Jardinage.)
c'ell:arranget
a
la main (es fcuilles, de maniere qu'elles fe trou"
V~1lt
fi bien di[pofées <flle l'reillet en paroi1le plus
large. On fait r.:e travailquand la flelLr ell: toute épa–
noiiie,
(K)
AJUSTER
un cheval
(
Ma¡zlge.
)
e'ell: lui appren–
dre ron exercice en lui dónnant la grace néce!faire_
ArusTE:R
Ttn
fir, (Maré,J¡aleri•. )
c'ell: le rendre
pl'opre au pied du cheval. (
V)
AJUSTER,
en
t.fllle
d~
BalancÍer,
e'ell: rendre les
poids conformes
'lIUX
poids étalonnés ou
a
l'étalon_
, AJUSTER,
en
tmm,
de Bijolt(ier,
e'ell: remplü-les
vnides d\me piece, tabatiere ou autre , de moreeal1X
de pielTes fines, ele caillQlD<, de coquillages,
&c.
&
pour ainfi dire la mal'queter.
AruSTER
carreallX, (terUle d'an.,cim },[onnoyaO'e.
)
e'étoit couper avec <les
ci{o~re~
les angles ou
pO~1tes
des pieees de métal <flIÍ alors étoient prépar 'es en
quarré POuT
~tl'e
enfuite arrondies,
AJ USTER, {e dit,
dans les Mamifaallres
de
flie,
des li!fes quine doivent etre ni plus élevées ni plus
ba!fes que l'ouyrage ne le comporte.
Ajujler,
c'eíl:
lel11' donner eetté llifpofition.
Il
eil: impoffible de faire
ele bel ouvrage, <flland les
Ii!fes
font mal
ajujlées;
paree qu'alors ,li¡!s parties de la ehalne {e féparent
mal.
Il
n'ell:
m~me
pas poffible de travailler, quand
'dles {ont tres-mal
ajujlées. Voye{
LlSSE.
Al
USTEURS
(ti
la Monnoie.
)
ne pen'veht, non–
plus que les Monnoyeurs,
~tre
res:us, s'ils ne {ont
¡i'ell:oc
&
ligne. LelLr fonfrion ell: de donner aux
flan(Zs le poids <fll'ils doivent avoir. Leur droit, de
deux {ols pour I'or, un {ol pom'l'argem
&
le billon;
le,<fl{el droit ils partagent entre eux,
AJ USTOIRE ,
f.
m.
(a
la Monnoi.,
)
efl: une ba';
lance qui {ert aux ajuneurs
a
déterminer fi le flanc
a
monnoyer efr dll poids fixé, s'il efl: fort on foible
¡–
les flanes qui {ont el'un poids au-deff'ous {ont ci{aillés·
¡mur enCuite gfre cernis
a
la fonte; ceux qui (ont trop
forts (ont limés
&
diminllés par lenrfmface avee une
écoiiane.
Yoye{
VLANC, CISAILLER, ECOUANE_
AHJTAGE
Oll
AJOUTOIR,
f.
m.
(Fontainier,)
Les
ajutages
ou
ajo/lloirs
{ont des cylindres de fer–
blane ou de ctúvre pereés de plufiems fas:ons, le{–
quels fe vilfem fin lem écrou (jue 1'011 {oude au bout
el'un tuyau montant appcllé
ji)l!ch,.
Il
ya deux tortes
d'ajutages, lesjimples
&
les
conr–
pcifJs
;
les
jimples
{om ordinairement élevés en cone
&
percés d'un {enl trOIl.
Les
compofls
{ont applatis eh-de!fus
&
pereés {¡Ir
la platine de plufiems trous, de fentes , on d'un fuif–
eeal! de, tuyaux qlli forment des gerbes
&
des giran–
doles,
Panni les
ajutages compf!fés,
il Yen a dont le mi–
¡¡en de la filperhcie ell: tour remplí ,
&
quí ne {ont
couverts que d'une zone
qui
les entoure; on les
a~pelle
ajoutoirs
a
l'épargne,
paree qu'on prétend qu'ÍJs
dépenfent moins d'eau ,
&.
que !e jet en paroit plus
gros. On fait prendre aux a¡OutOlrs phúiems figures ,
comme de gerbes, de pluies, d'évantails, (oleil ,
girandoles, bouillons,
J70yq
PLUIES , EVANTAILS",
GrRANDoLES, BOUILLONS, SOUCHE.
(K),
Il
s'enfuír de ee ,quiprécede,) que e'eíl: la
diJfét,
Hh
















