
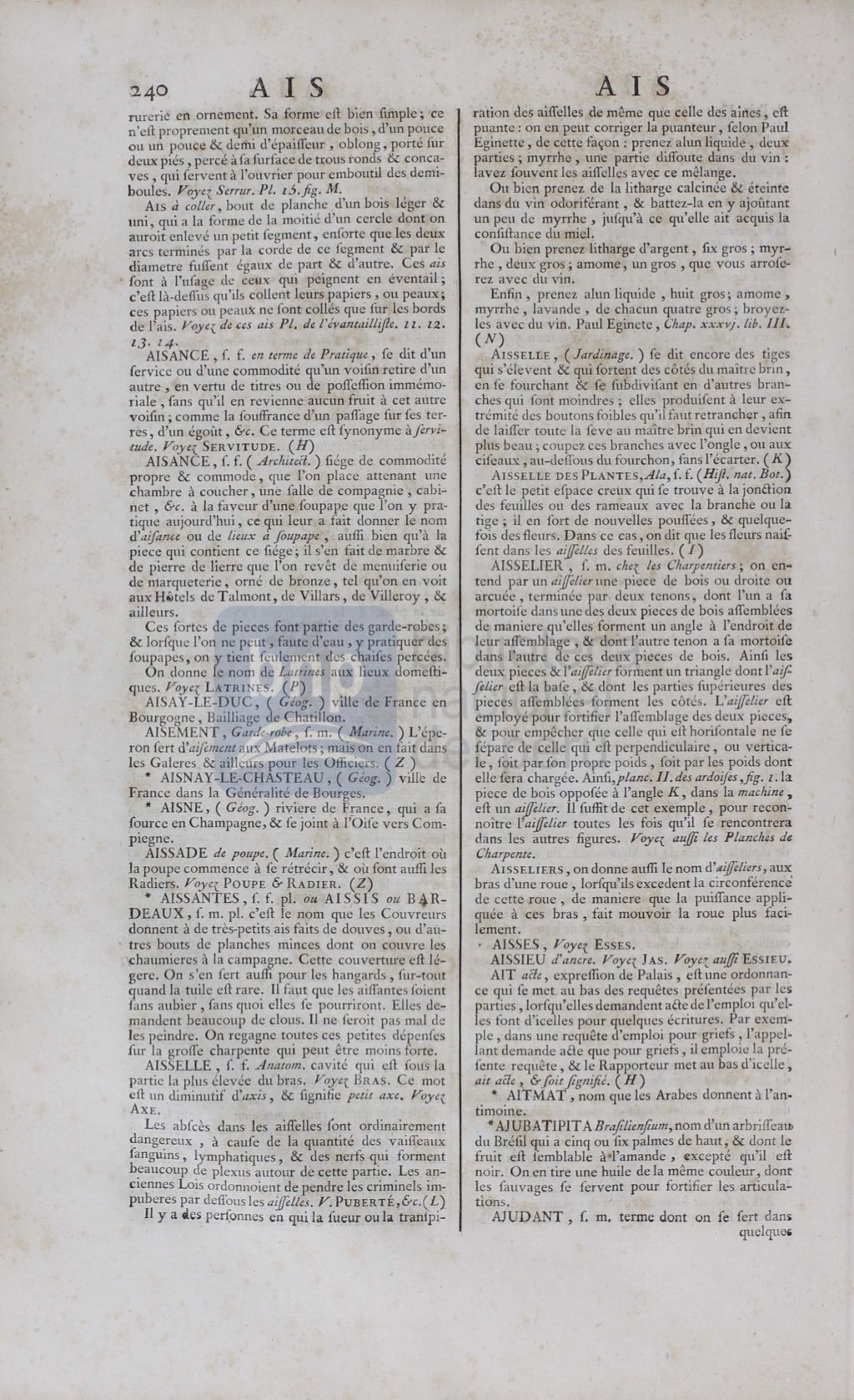
A 1 S
rurerie en ornement. Sa forme eíl: bien wllple; ce
n'cíl: proprement qu'un morcean de bois , d\m pouce
ou un pouce
&
demi d'épaiífeur , oblong, porté [ur
deux piés ,percé Ha furface de ttouS rond.s &
conc~ves, 'lui fervent
a
l'ouvrier pour emboutil des deml-
boules.
Voye{ Serrur. Pi. d.jig. M.,
.•
AIS
ti
coLLer,
bout de planche d un bOlS leger
&
uni, qui a la forme de la moitié d'un cerc1e dont on
auroit enlevé un petit fegment, enforte que les deux
ares terminés par la corde de ce fegment
&
par le
diametre fuífent égaux de part
&
d'autre. Ces
aís
font
a
l'ufage de ceux quí peignent en éventail;
c'eíl: la-deífus qu'ils collent leurs papiers, ou peaux;
ces papiers ou peaux ne font collés que fur les bords
de l'ais.
VOyl{ de ces ais PI. de t'évantaiLLifle.
z
lo
Z2.
zJ.
l4·
AISANCE ,
f.
f.
en terme de Pratique,
fe dit d'un
[ervice ou d'une commodité qu'un voifm retire d'un
'<tutre , en vertu de titres ou de poIreffion immémo–
riale , fans qu'il en revienne aucun fmit a cet autre
voifin ; comme la [oufFrance d'un paífage fUf fes ter–
res, d'un égout,
&c.
Ce terme eíl: fynonyrne
afervi–
tude. Voye{
SERVITUDE.
eH)
AISANCE, f. f. e
Architeél.
)
fiége de commodité
propre
&
commode, que I'on place attenant lme
chambre a coucher, une falle de compagnie , cabi–
net ,
&c.
a
la faveur d'une [oupape 'fue l'on y pra–
tique aujourd'hui, ce
~LÚ
leur a fait donner le nom
d'aifanee
ou de
liel= a foupape,
auffi bien qu'a la
piece qui contient ce fiége; il s'en fait de marbre &
de pierre de lierre que l'on revet de menuiferie ou
de n1arqueterie, omé de bronze, tel qu'on en voit
aux Hi>tels de Talmont, de Villars , de Villeroy ,
&
ailleurs.
Ces fortes de pieces font partie des garde-robes;
&
lorfque l'on ne peut, faute d'eau, y pratiquer des
[oupapes,on y tient [eulement des chaifes percées.
On donne le nom de
Latrims
aux lieux domeili–
queso
Voye{
LA:TRTNES. e
P)
AISAY-LE-DUC, e
Géog.
)
ville de France en
Bourgogne, Bailliage de Chatillon.
AISEMENT,
Garde-robe,
f.
m. e
Marine.
)
L'épe–
ron fert d'
aifement
aux Matelots; mais on en fait dans
les Galeres
&
aillems pour les Olñciers. e
z )
.. AISNAY-LE-CHASTEAU, e
Géog.
)
vilH: de
France dans la Généralité de Bomges.
*
AISNE, e
Géog.
)
riviere de France, qui a [a
fource en Champagne,
&
fe joint a rOife vers Com–
piegne.
AISSADE
de poupe.
(
Manne.
)
c'eíl: l'endroit
Oll
la poupe commence a fe rétrécir,
&
Ol! font auffi les
Radiers.
roye{
POUPE & RADIER. eZ)
*
AISSANTES,
f.
f. pI.
ou
AISSIS
Olt
B4R–
DEAUX,
f.
m. pI. c'eíl: le nom que les Couvreurs
donnent
a
de tres-petits ais faits de douves, ou d'au–
tres bouts de planches minces dom on couvre les
chaumieres a la campagne. Cette couvertme eíl: lé–
gere. On s'en [ert auffi pom les hangards , fUT-tout
quand la tuile eíl: rareo Il fallt que les aiífames foient
f.-ms aubier , fans c¡uoi elles fe pourriront. Elles de–
,mandent beaucoup de c1ous. Il ne feroit pas mal de
les peindre. On regagne toutes ces petites dépenfes
fm la groífe charpente 'fui peut etre moins forte.
AISSELLE , f. f.
Anatom.
cavité 'fui eíl: {ous la
partie la plus élevée du bras.
.voye{
BRAS. Ce mot
eíl: un diminutif d'
axis,
&
fignifie
petÚ axe. Voye{
AxE.
Les abfces dans les aiífelles (ont ordinairement
dang~reux
, a caufe de la 'fuantité des vaiífeaux
fangums, Iymphatiques,
&
des nerfs qui forment
b.eaucoup
~e
plexus autour de cette partie. Les an–
Clennes LOIS ordonnoient de pendre les criminels im–
puberes par deífous les
aiffilLes.
Y.
PUBERTÉ,&C.e
L)
11 ya_es per(onnes en qui la fueur ou la tranfili-
A 1 S
ration des aiífelles de meme que celle des aines , eft
puante ; on en peut corriger la puanteur , {elon Paul
Eginette , de cette fac¡:on ; prenez alun liquide, deux
pm"tÍes ; myrrhe, une partie diífoute dans du vin :
lavez {ouvent les ailfelles avec ce melange.
Ou bien prenez de la litbarge calcinée
&
éteinte
dans di! vin odoriféram ,
&
battez-la en yajoutant
un peu de myrrhe, jufqu'a ce qu'elle ait a<:quis la
confiíl:ance du miel.
Ou bien prenez lithatge d'argent, {IX gros; myr–
rhe , deux gros; amome, un gros, que vous arrofe–
rez avec clu vino
Enfin, prene1. alun liquide, hlút gros; amome ,
myrrhe , lavande, de chacun quatre gros; broyez–
les avec'du vino Paul Eginete ,
Chapo xxxv}. lib.
JII.
eN)
AISSELLE, e
Jardinage.
)
{e dit encore des tiges
qui s'élevent
&
qui {ortent des cotés du ma'itre brin,
en fe fourchant
&
fe fubdivifant en d'autres
bran~
ches qui (ont moindres; elles procluifent a leur ex–
trémité des boutons foibles qu'il faut rctrancher , afin
de laiIrer toute la feve au maltre brin qui en devient
plus beau ; coupe1. ces branches avec l'ongle, ou aux
cifeaux, au-ueífolls du fourchon, fans l'écarter.
(K)
AISSELLE DES PLANTES,Aia,
f.
f. e
Hifl. nato Bot.)
c'eíl: le petit efpace creux qLÚ {e trouve a la jonélion
des feuilles ou des rameaLIX avec la branche ou la
rige; il en {ort de nouvelles pouífées,
&
quelque–
fois des fleurs. Dans ce cas, on dit que les fleurs naif
(em dans'les
aiffilles
des feuilles. e
1)
AISSELIER, {. m.
ch"{ les Clzarpentiers;
on en·
tend par un
aiffilier
une piece de bois ou droite ou
arcuée , terminée par deux tenons, dont l'un a fa
mortoife dans une des delIX pieces de bois aífemblées
de maniere CfLI'elles formem un angle
a
l'endroit de
leur aífemblage ,
&
dont l'autre tenon a (a mortoife
dans l'autre de ces deux pieces de bois. Ainfi les
deLIX pieces
&
l'
aiffilier
forment un triangle dont l'
ai)–
felier
eíl: la bafe,
&
dont les parties {upérieures des
pieces aífemblées forment les cotés.
L'aiffilier
eíl:
employé pour fOl"tÍfier l'aífemblage des deux pieces,
&
pour empccher CfLle celle CfLli eíl: horifontale ne fe
fépare de celle CfLIÍ eíl: perpendiculaire, ou vertica–
le, {oit parJon propre poids, foit par les poids dont
elle fera chargée.
AinE,l'lanc.l1. des ardoifes ,jig.
z. Ia
piece de bois oppofée a l'angle
K,
dans la
maclzine •
eíl: un
aiffilier.
II (ulñt de cet exemple, pour recon–
nOltre l'
aiffiLier
toutes les fois CfLl'il fe rencontrera
dans les autres figures.
.v~e{
auiflles Planches de
Charpente.
AISSELIERS, on donne auffi le nom d'
lIliffilius,
aux
bras d'une roue , lorfqu'ils excedent la circonférence
de cette roue, de maniere que la puiIrance appli–
CfLlée a ces bras, fait mouvoir la roue plus faci–
lement.
• AISSES,
roye{
ESSES.
AISSIEU
d'ancre. Voye{
JAS.
roye,~
auifl
ESSIEU.
AIT
aat,
expreffion de Palais, eíl: Lme ordonnan–
ce CfL,i fe met au \:las des reCfLletes pré{entées par les
parties , 10rfqll'elles demandent aéle de I'emploi qu'el–
les fom d'icelles pour CfLlelques écritures. Par exerri–
pIe, dans une reqllete d'emploi pour griefs , l'appel–
lam demande aéle 'fue pour griefs , il emploie la pré–
fente requete,
&
le Rapporteur met au bas d'icelle,
ait aae
&
foit Jignifié.
eH)
... AITMAT, nom que les Arabes donnent a I'an–
timoine.
*
AJUBATIPITA
BraJilie,y;um,
nom d'un arbriífealh
du Bréfil qui a cin'f ou fIX palmes de haut,
&
dont le
fnút eíl: iemblable a'l'amande, excepté qu'il eíl:
noir. On en tire une huile de la meme couleur, donr
les {auvages {e {ervent pour fortifier les articula–
tions.
AJUDANT ,
f.
m, terme dont on fe {ert daos
quelCfLl65
















