
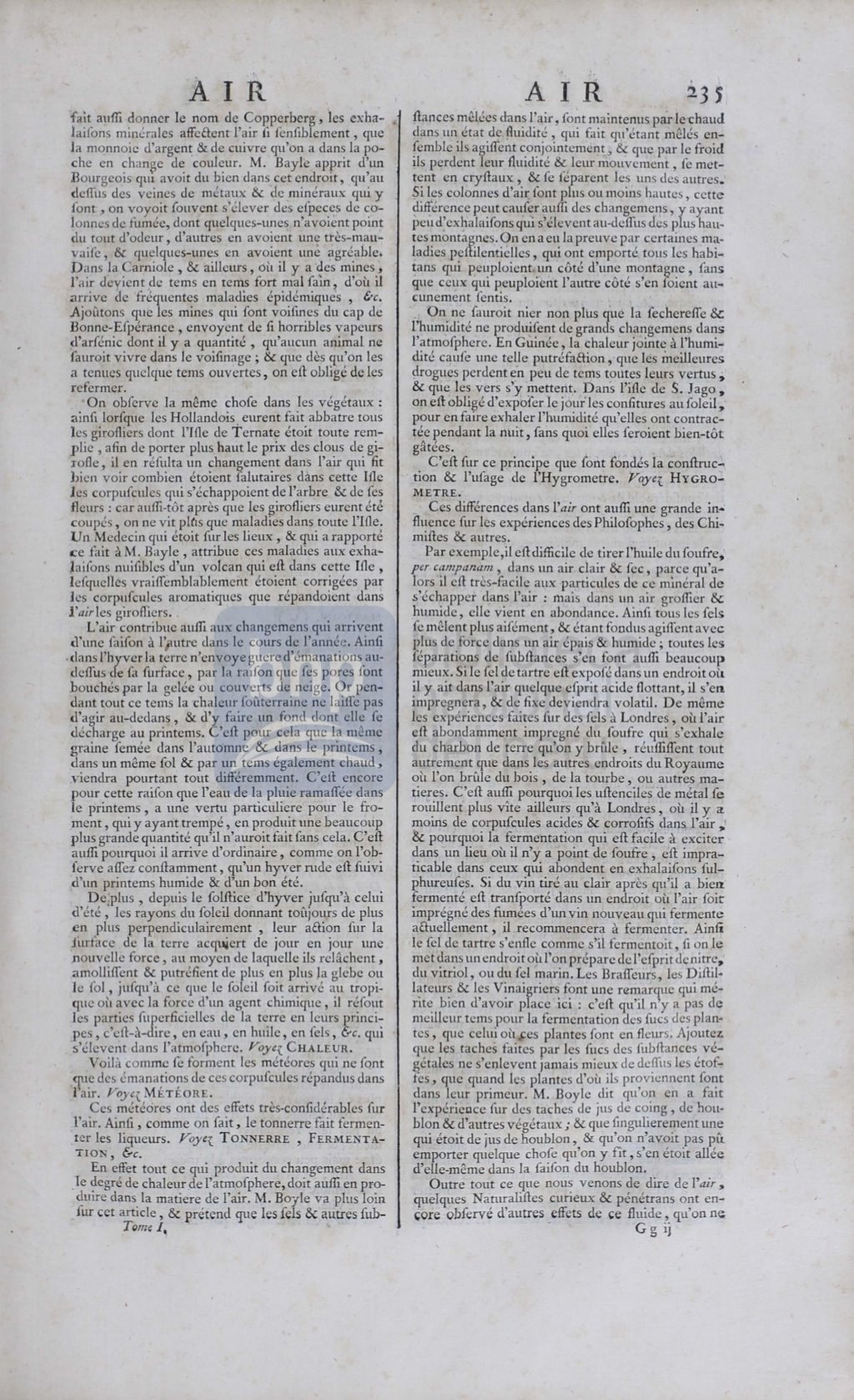
AIR
fait auffi donner le nom de Copperberg, les exha–
laifons minérales affeél:ent l'air
{j
fenftblement, que
la monnoie d'argent
&
de cuivre qu'on a dans la po–
che en
chan~e
de couleur. M. Bayle apprit d'un
Bourgeois
'1111
avoit du bien dans cer endroit, qu'au
deífus des veines de métaux
&
de minéraux qui y
font ,on voyoit fouvent s' 'lever des efpeces de co–
Ionnes de fumée, dont quelqlles-lU1es n'avoient point
du tout d'odeur, d'alltres en avoient tlne tres-mau–
vaire,
&
quelques-unes en avoient une agréabIe.
Dans la Carruole ,
&
ailleurs , éll il
Y
a des mines,
l'air deyient de tems en tems fort mal fam, d'oll il
arrive de fréquentes maladies épidémiques ,
l/c.
Ajoí"ttons que les mines qui font voifU1es du cap de
Bonne-Ef¡Jérance, envoyent de
íi
horribles vapeurs
d'arfénic dont iI y a quantité, qu'aucun animal ne
fauroit vivre dans le vojíinage ;
&
que des qu'on les
a tenues quclque telns ouvertes, on eíl: obligé de les
refermer.
'On ob(erve la
m~me
chofe dans les végétaux :
ainíi lor(que les Hollandois.ement fait abbatre tous
les girofliers dont l'Ifie de Ternate
étoit
toute rem–
plie , afin de porter plus haut le prix des clous de gi–
J'ofle, il en réfulta un changement dans l'air qui fit
bien voir combien étoient falutaires dáns cette IIle
les corpufcules qui s'échappoient de l'arbre
&
de (es
tleurs : car auffi-tot apres que les girofliers ement éte
coupés, on ne vit pllls que maladies dans toute l'lOe.
Un Medecin qui étoit fur les lieux,
&
qui a rapporte
ce fait a M. Bayle , attribue ces maladies allX exha–
laifons nuiíibles d'un volean qlÚ ell dans cette lile,
lerquellcs vrai{[emblablement étoient corrigées par
les corpufcules aromatiques que répandoient dans
l'
air
les girofllers. ,
L'air contribue auffi aux changemens qui arrivent
c:l'tme faifon a ['¡¡utre dans le cours de ['année. Ainíi
.dansl'hyver la terre n'envoye guere d'émanations au–
deílus de fa furface, par la raifon que fes pores font
bouchés par la uelée ou couverts de neige. Or pen–
dant tout ce te';s la cnaleur (oLlterraine ne lai1I'e pas
d'agir au-dedans,
&
d'y
faire un fond dont elle fe
décharge au printems. C'eíl: pour cela que la
m~me
graine femée dans I'autdmne
&
dans le printems,
dans un
m~me
fol
&
par un tems également chaud,
viendra pOllrtant tout différernment. C'eíl encore
pom cette raifon qne l'ean de la pllúe ramaifée dans
le printems, a une vertu particllliere pour le fro–
ment, qui y ayant trempé , en produit une beaucoup
plus grande quantité qu'il n'auroit faitfans cela. C'eíl:
auffi pourquoi il arrive d'ordinaire, comme on l'ob–
ferve aifez coníl:amment, qu'un hyver mde eíl fuivi
d'un printerns hurnide
&
d'tm bon été.
De,plus , depuis le folftice d'hyver jufqu'a celui
d'été , les rayons du foleil donnant tOlljours de plus
en plus perpendiculairement , leur aél:ion fur la
li.u-face de la terre acquiert de jom en jour une
Jlouvelle force, au moyen de laquelle ils reHkhent,
amoUi1I'ent
&
putré/ient de plus en plus Ja glebe ou
le fol , ju(qll'a ce que le
foleil
(oit arrivé au tropi–
que 011avec la force d'tlO agent chimique,
il
ré(out
les parties fuperficielles de la terre en leurs princi–
pes, c'eft-a-dire, en eau, en huile, en fels,
&c.
qui
s'élevent dans l'atmo(phere.
Voye{
CHALEUR.
Voila comme (e forment les météores qui ne (ont
que des émanations de ces corpufcules répandus dans
l'air.
Voye{
MÉTÉORE.
Ces métécires ont des effets tres-coníidérables [ur
l'air. Ain/i, comme on (ait, le tonnerre fait fermen–
ter les liqueurs.
Yoye{
TONNERRE , FERII1ENTA–
TIO
,&c.
En effet tout ce qui produit du changement dans
le ?egré de chaleur de l'atmo(phere, doit auffi en pro–
dUlre dan
la
matiere de l'air. M. Boyle va plus loin
fur cet anide ,
&
prétend que les fels
&
autres fub--
Tr;lI/l,l,
AIR
!lances mHées dansl'air, font maintenus par le-chaud
dans un état de,tluidité , qui fait qu'étant
m~lés
en–
(emble ils agi1I'em
conjointement~
&
que par le froid
ils perdent leur fluidité
&
leur mouvement , (e met–
tent en cryílaux:,
&
(e (éparent les uns des autres.
Si les colonnes d'air (ont plus ou moins hautes, cette
dilférence peut cau(er auffi des changemens , yayant
peud'exhaJai(ons qÜi s'éleventau-de{[usdes plus hau–
tes montagnes. On ena eu la preuve par certaines ma–
ladies pefrilentielles, 'fui ont emporté tousles habi–
tans
qui
peuploient.
tul
coté d'une montagne, fans
gue ceux qui peuploient ['autre coté s'en (oient au–
cunement (entis.
. On ne (auroit nier non plus que la fechere{[e
&
l'humidité ne produifent de grands changemens dans
I'atmo(phere. En Guinée, la chalelu- jointe
a
l'hutni~
dité caufe une telle plltréfaél:ion , que les meilleures
~ogues
perdent e'n peu de tems toutes leurs vertus
~
&
que les vers s'y mettent. Dans l'ifie de S. lago.
on efi obligé d'expofer le jouiles eonfinues au (oleil,
pour en faire exhaler l'humidité qu'elles ont contrac–
té,e fendant la nuit, (ans quoi eUes feroient bien-tot
gatees.
C'eíl: (ur ce principe que tont fondés la confuuc–
tion
&
l'ufage de I'Hygrometre.
Yqye{
HYGRO–
METRE.
_ Ces différeDces dans
l'
air
ont auffi une grande in"
flllenee fur les expériences des Philo(ophes , des Chi–
milles
&
autres.
Par exemple,il eftdiffieile de tirer l'huile du (oufre.
per campanam,
dans lm air clair
&
fec, paree qu'a-
10rs il eíl
trcs~facile
aux particules de ce
m~néral
de
s'éehapper dans I'air : mais dans un air groffier
&
humide , elle vient en abondance. Ain/i tous les (els
(e melent plus aj[ément,
&
étant foodus agiífent avec
plus de force dans un air épais
&
humide ; routesles
(éparations de (ubftances s'en font auffi beaucoup
mieux. Si le (el de tartre eíl expo(é dans un endroit Ol!.
il
Y
ait dans['air quelque e(prit acide flottant, il s'en
impregnera,
&
de fixe deviendra volatil. De meme
les expériences faites fur des fels a Londres, OlI I'air
eíl abondamment impregné du (oufre qui s'exhale
du charbon de terre qu'on
y
brllle, réuíIi{[ent tout
autrement que dans les autres endroits du Royaume
oh I'on brwe du bois , de la tourbe, ou autres ma–
tieres. C'eft auffi pourquoiles uftenciles de métal (e
rouillent plus vlte ailleurs qu'a Londres, Oll il
Y
a
moins de corpu(cules acides
&
corrofrts dans l'air
,¡
Be
pourquoi la fermentation qui en facile
a
exciter
dans un lieu Oll il n'y a point de (ouiTe, eíl: impra–
ticable daos ceux qui abondent en exhalaifons (ul–
phlueu(es. Si du vin tiré au clair apres 'fu'il a bien
fermenté eíl: tran(porté dans un endroit
OÜ
l'air (oir
imprégné des fumees d'un vin nouveau qui fermente
aél:ueUement, il recornmencera
a
fermenter. Ainíi
le fel de tartre s'enfle comme s'il fermentoit,
íi
on le
metdans un endroitolll'on prépare de I'efpritdenitre,.
du vitriol, ou du (el marino Les Braífeurs, les Dillil.
latellIs
&
les Vinaigriers font lme remarque
qui
mé–
rite bien d'avoir place ici : c'eft qu'il n'y a pas de
meilleur tems pour la fermentation des fucs des pIan–
tes ,
'fue celui Oll ,¡;es plantes (ont en fleurs. Ajoutez.
que les taches faites par les fucs des fu.bftanees vé–
gétales ne
5'
enlevent janlais mieux de de{[us les étof–
fes, que quand les plantes d'oll ils proviennent font
dans leur primenr. M. Boyle dit qu'on en a fait
l'expériecce (m des taches de jus de coing , de hou–
blon
&
d'autres végétaux;
&
que /inguJierement une
qui
étoit de jus de houblon,
&
qu'on n'avoit pas pu.
emporter quelque chofe qu'on y fit, s'en étoit allée
d'elle-m~me
dans la faifon du houblon.
Outre tout ce 'fue nous venons de dire de
l'air
>
quelques Naturalilles curieux
&
pénétrans ont en–
I;ore obfervé d'autres effets de ce fluide, qu'on ne
-
Gg
ij
















