
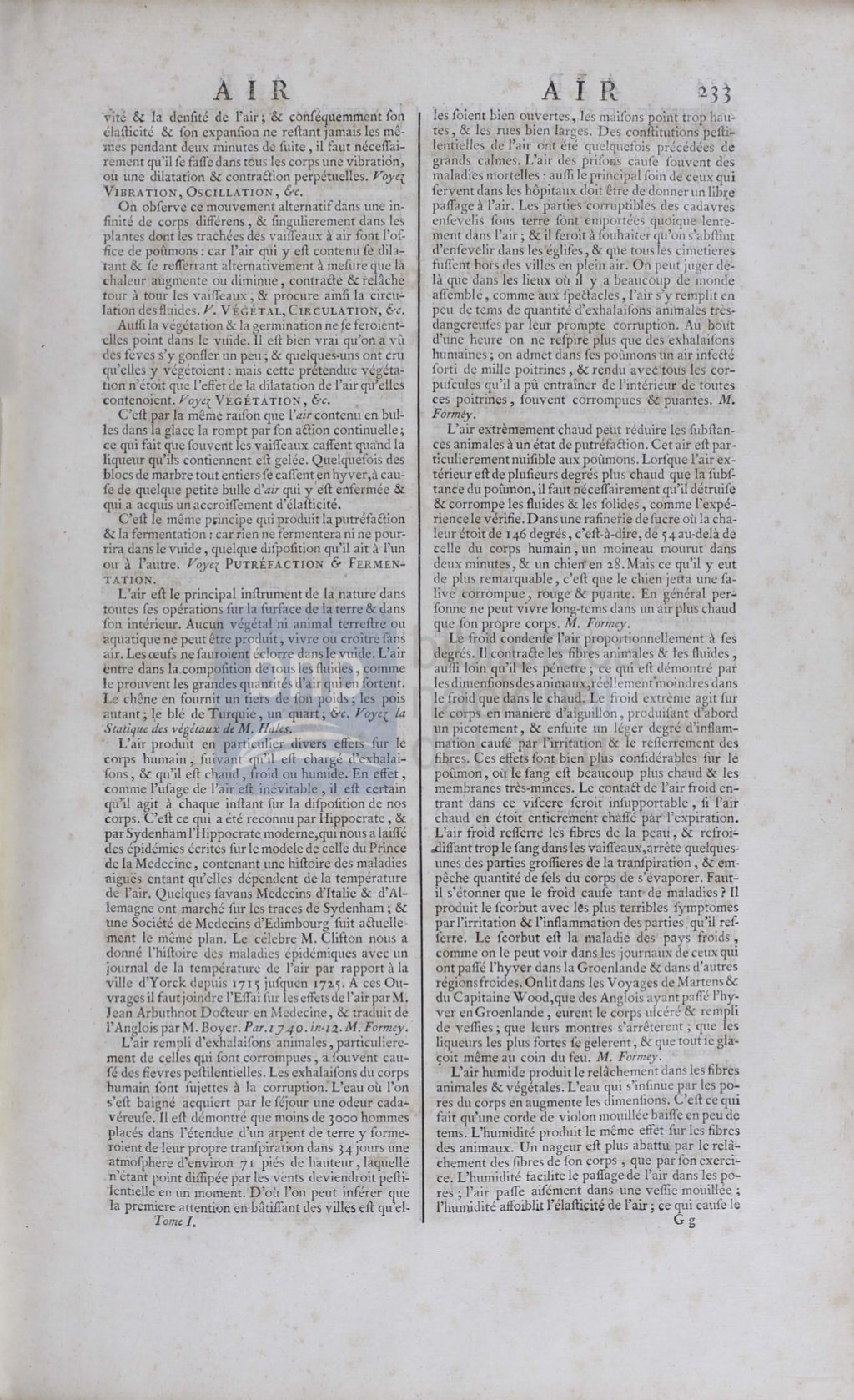
AIR
v-ité
&
la denúté de l'air;
&
cbn[équernment 1011
élafucité
&
[on expanúon ne rellant ¡amais les me–
mes pendant delL'( minutes de fuite , il faut nécelfai–
rement qu'il (e fafie dans tous les corps une vibratian,
ou une dilatation
&
contraél:ion perpétuelles.
Voye{
VIBRATION, OSCILLATION,
&c.
On obferve ce mouvemént alternatifdans uné in–
finité de corps di/férens,
&
íingulierement dans les
plantes dont
les
trachées des vailfeaux a air font l'of–
nce de pot'tmons : car l'air qui y ell contenu
(e
dila–
tant
&
[e relÍerrant alternativemcnt a mefure que la
chaleur augmente ou dimÍflue , contraél:e
&
reHiche
tour
a
tour les vaiífeaux,
&
procure ainú la circu–
lation desflllides.
V.
VÉGÉTAL, CIRCULATI'ON,
&c.
Au1li la végétation
&
la germination ne (e feroiént–
elles point dans le vuide.
Il
ell bien vrai qu'on a Vll
des feves s'y gonfler un peu;
&
quel~ues-uns
ont cm
qu'elles y végétoient: mais cette pretendue végéta–
rion n'étoit que I'e/fet de la dilatation de l'air qu'elles
contenoient.
J7oye{
VÉGÉTATION,
&c.
C'ell par la meme rai[on que
l'air
contenu en bul–
les dans la glace la rompt par (on aél:ion continuelle;
ce qüi fait que fouvent les vailfeaux calfent qua'nd la
liquenr qu'ils contiennent efr gelée. Quelquefóis des
blocs de marbre tout entiers (e calfent en hyver,a cau–
[e de quelque petite bulle d'
air
qui y 'ell enfermée
&
qui a acquis un accroilfement d'élallicité.
C'ell le meme púncipe c[ltÍ produit la putréfaétion
&
la fermentation: car rien ne fermentera ni ne pour–
rira dans le vuide, c¡uelque di(poíition 'lu'il ait
it
I'un
ou
a
l'autre.
Voye{
PUTRÉFACTION
&
FERMEN–
TATION.
L'air eíl le principal infuument de la nature dahs
toutes fes opérations
(tu
la furface de la terre
&
dans
[on intérieur. Aucun végétal ni animal terrefue ou
3c[llatique ne peut etre produit, vivre ou croltre (ans
air. Les <Eufs ne (auroient écIorre dans le vuide. L'air
entre dans la.compotition de tous les fluides , comme
le prouvent les grandes quantités d'air qui en fortent_
Le chene en fournit un tiers de (on poids; les pois
autant;
~e
blé de Turquie , un quart;
&c. Voye{ la
Statique des végétaux de M. Hales.
L'air produit en particulier divers eftets fur le
corps humain, (uivant qu'il ell chargé el'exhalai–
fons,
&
'lu'il ell chaud, froid ou humide. En e/fet ,
comme 1'1lfage de l'air ell inévitable, il ell certain
qú'il agit
11
cha'lue inll:ant (ur la di(poíition de nos
corps. C'eíl: ce qui a été reconnu par Hippocrate,
&
parSydenhaml'Hippocrate moderne,qui nous a lailfé
des épidémies écrites fur le modele de cclle du Ptince
de la Mcdecine, contenant une hlfroire des maladies
aigues entant <JI,'eIles elépendent de la température
de l'air. Quelques /ilvans Medecins d'Italie
&
d'Al–
lemagne ont marché (m les traces de Sydenham ;
&
ime Société de Medecins d'Edimbourg (uit aél:ueIle–
ment le
m~me
plan. Le célebre M. Clifton nous a
donné l'hifroire des maladies épidémi'lues avec un
journal de la température de I'air par rapport
a
la
ville dOYorck depuis 17
1
í
jufquen 172
í.
A ces Ou–
vrages il faut joindre l'Elfai Cur les e/fetsde I'alr par M.
Jean Arbuthnot Doél:eur en Medecine,
&
Iraduit de
I'AngloisparM.
Boyer. Par. Z:J40.
in-l2.M.
Formey.
L'air rempli d'exhalaiCons animales, particuliere–
ment de celles qpi (ont corrompues, a (ouvent cau–
fé des fievres pellilentielles. Les exhalaifons du corps
humain (ont fujettes
a
la corruption. L'eau oll I'on
s'ell baigné acquiert par le féjom une odeur
cada~
véreufe.
Il
ell démontré 'lue moins de 3000 hommes
placés dans l'étendue d'un arpent de terre
y
forme–
Toient de leur propre tranfpiration dans 34 jours une
atmoCphere d'environ 71 piés de hauteltr, la<JIlelIe
n'ét?nt point di1lipée par les vents deviendroit pefri–
lentlelle en un momento D 'oll 1'0n peut ¡nférer que
la preIlÚere attention en batiJfant des villes ell qu'el-
Tome!.
AlR
'les [oient bien oU,vertes, les maifons point trop hau–
tes,
&
les mes bICn larges. Des confututions pefu–
lentielIes de I'air ont été c[llelqucfois précédées de
grands calmes. L'air des pritons cauCe (ouvcnt des
maladies mortelles : au1li le principal foin de ceux qui
fervent dans les h6pitaux eloit etre de donnerun lib¡;e
palfage
a
I'air. Les parties 'corruptibles des cadavres
elúevelis fous terre font emportées quoi<JIle lente–
ment dans l'air ;
&
il feroit
a
fouhaiter 'lu'on s'abíl:int
d'enfevelir dans les églifes,
&
que tous les cimetieres
fulfent hors des villes en plein airoOn peut juger de–
la <JIle dans les lieux Oll il Y a beaucollp de monde
affemblé, comme allX fpeél:acles , l'air s'y remplit en
peu de tems de <JIlantité d'exhalaifons animales tres–
dangereufes par leur prompte cornlprion. Au bout
d'une heme on ne refpire plus 'lue des exhalaifons
humaines; on admet dans (es pofunons un air infeél:é
forti de mille poitrines ,
&
rendu aveé tous les cor–
puCcules 'lu'il a pu
entraln~r
de l'inté,iem de toutes
ces poitrines, fouvent corTompues
&
puantes.
M.
Form¿y.
L'air extremement challd peüt réduire les (ubllan–
ces animales a un état de putréfaél:ion. Cet air ell par–
ticulierement ntüíible aux poftmons. Lor(<JIle l'air ex–
tériem ell de plufieurs degres plus chaud 'lue la fubf–
tance du pOlunon, il faut nécelfairement qu'il elétrui(e
&
corrompe les fluides
&
les folides , comme l'expé–
rience le vérme. Dansune rafinerÍe defucre ollla cha–
leur étoit de 146 degrés, c'ell-a-dire, de 54 au-delil de
celle du corps humain, un moineau momut dans
deux minutes,
&
lUl chien' en 28.Mais ce <JIl'il y eut
de plus remarquable, c'efr que le chien jetta une (a–
live corrompue , rouge
&
puante, En
~énéral per~
fonne ne peut vivre long-tems dans lm alT plus chaud
<JIle fon propre corps.
M. Formey.
Le froid condenCe l'ail' proporrionneilement a (es
degrés. II contraél:e les fib'es animales
&
les fluides ,
au1li loin 'lu'il les pénetre; ce 'lui ell démontré par
lesdimennons desanimaux,reellement"moindres dans
le froid que dans le chaud. Le fi'oid extreme agit (ur
le corps en maniere d'aiguillon, produi(ant d'abord
un picotement,
&
enfuite un léger degré d'inflam–
mation cau(é pár l'irritation
&
le relferrement des
fibres. Ces e/fets (ont bien plu coníidérables (nr le
poftmon, Oll le (ang ell beaucoup plus chaud
&
les
membranes
tn~s-minces.
Le contaél: de l'air froid en–
trant dans ce vifcere feroit infupportable ,
(1
l'ait
chaud en étoit entierement chalfé par I'expiration.
L'air froid relferre les fibres de la peau,
&
refroi"–
.diffant trop le (ang dans les vailfealL'(,arrete quelques-
unes des parties gro1lieres de la tranfpiration ,
&
em–
peche 'luantité de fels du corps de s'évaporer. Faut–
il s'étonner <JIle le froid calúe tant de maladies?
Il
produit le (corbut avec les plus terribles fympromes
parI'irritation
&
l'inflammation des parries ql1'il ref–
terreo Le fcorbut ell la maladie des pays froids ,
comme on le pellt voir dans les journaux de ceux <JIu
ont palfé I'hyver elans la Groenlande
&
dans d'autres
régionsfroides. Onlitdans les Voyages de Martens
&
elll Capitaine
\V
ood,que des Anglois ayant palfé I'hy–
ver en Groenlande , eurent le corps ulcéré
&
rempli
ele ve1lies; <JIle leurs montres s'arr&terent ; <JIle les
liqueurs les plus fortes (e gelerent,
&
<JIle tout le gla'–
c;oit
m~me
au coin du feu.
M. Formey.
L'air humide rrOdllit le relachement dans les fibres
animales
&
végetales. L'eau qui s'in(lllue par les 1'0-
res du corps en augmente les
dim.en,íions: C'efr ce qui
fait qn'une carde de vioJon momlJee ba¡lfe en peu de
tems. L'humidité produit le meme e/fet (ur les libres
des animaux. Un nagem efr plns abattu par le rela–
chement des fibres de ron corps , que par (on exerci–
ce. L'humidité facilite le paífage de I'air elans les ro–
res' I'air paffe aifément dans une ve1lie mouillee ;
l'hn~dité
a/foiblit l'élalli,ité de l'air ; ce
(;u~
can(e le
















