
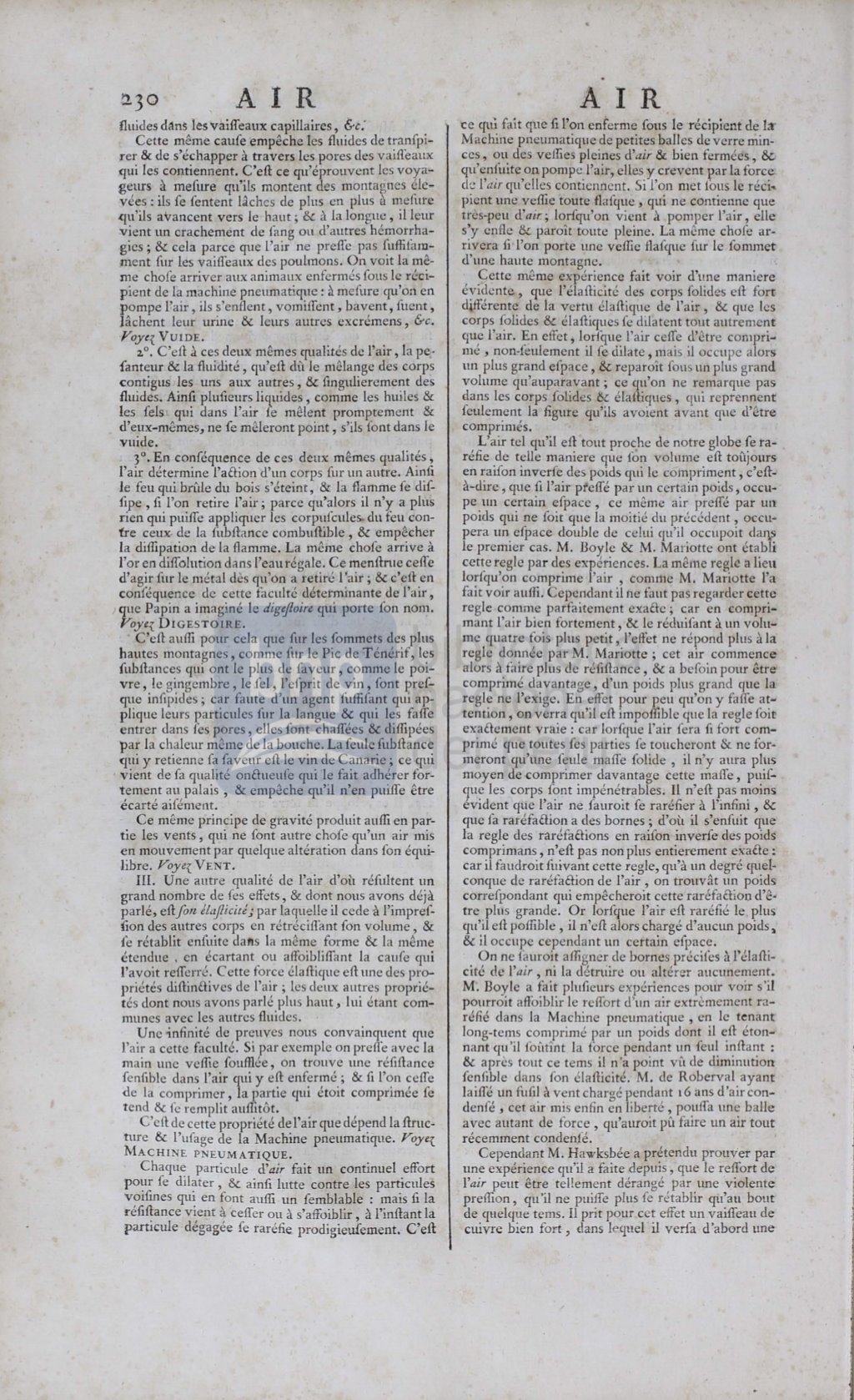
AIR
fluides dánS les v·iliífeaux capillaires,
c-c:
Cette meme caufe empeche les f1uides de tranCpi–
rer
&
de s'échapper
a
travers les pores des vaiíreaux
qui les contiennent. C'efr ce qu'éprouvent les voya–
geurs
a
mefure qu'ils montent des montagnes éle–
vées ; ils fe fentent lachcs de plus en plus
a
rneíllre
.qu'ils avancent vers le hallt;
&
a la longuc, illeur
vient un crachement de fang ou d'autres hémorrha–
gies ;
&
cela parce que l'air ne preíre pas fuffifam–
ment fur les vaiífeaux des poulmons. On voit la me–
me chofe arriver aux animaux enfermés fous le ré'ci–
pient de la machine pneumatique;
a
mefure qu'on en
pompe l'aír , ils s'enflent, vomiífent, bavent, fuent,
Jachent leur unne
&
leurs autres excrémens,
&c.
royt{
VUIDE.
2,0 .
C'efr a ces deux memes qualités de l'air, la pe:·
{anteur
&
la fluidité , qu'efr dlile melange des corps
<:ontigus les uns aux autres,
&
fmgulierement des
f1uides. Ainfi plufieurs liquides, comme les huiles
&
les fels qlli dans l'air fe melent promptement
&
d'eux-memes, ne fe meleront point , s'ils font dansle
vuide.
3°. En conféquence de ces deux memes cfUalités,
l'air détermine I'ailion d'un corps fur un autre. Ainfi
le
feu quibrúle du bois s'éteint,
&
la flamme fe dif–
fipe , fi I'on retire I'air; parce qu'alors il n'y a plus
rien qu.i puiífe appliquer les corpufcules. du feu con–
tre ceux- de la fubfrance combufuble ,
&
empecher
la diffipation de la flamme. La meme chofe arrive
a
I'or en diífolution dans l'eaurégale. Ce menfrrue ceífe
d'agir fur le métal des qu'on a retiré l'air;
&
c'efr en
conféquence de cette faculté détetrnlnante de l'air,
)que Papin a imaginé le
digifloire
qui porte fon nomo
Voye{
DIGESTOIRE.
C'efr auffi pour cela que fm les fommets des plus
halltes montagnes, comme fUr le Pic de Ténérif, les
fubfrances qui ont le plus de faveur , cornme le poi–
vre, le gingembre, le fe! , l'efprit de vin, font pref–
que infipides; car fatlte d'un agent fuffifant qui ap–
plique leurs particules fur la langue
&
qui les faífe
entrer dans fes pores, elles font chaífées
&
diffipées
par la chaleur meme de la bouche. La feule fubfrance
(lui y retienne fa faveur efr le vin de Canarie ; ce qui
vient de fa qualité onétueufe cfUi le fait adhérer for–
tement au palais ,
&
empeche qu'il n'en puiífe etre
écarté aj{ément.
Ce meme principe de gravité produit auffi en par–
tie les vents, qui ne font autre chofe qu'un air
mis
en mouvement par c¡uelque a1tération dans fon éqtú–
libre.
roye{
V
ENT.
IIl. Une atltre c¡ualité de I'air d'ol! réfultent un
grand nombre de [es effets,
&
dont nous avons déja
parlé,
efrjo/t élajlicité;
par laguelle il cede
a
l'impref–
fion des autres corps en rétrécimmt fon volume,
&
fe rétablit enfuite dans la meme forme
&
la meme
étendlle , en écartant ou affoibliífant la caufe qui
l'avoit reífen·é. Cette force élafrique efrune des pro–
priétés difrinétives de I'air ; les deux autres proprié–
tés dont nous avons parlé plus haut, lui étant com–
munes avec les autres fluides.
Une l.nfinité de preuves nous convainquent que
l'air a cette faculté. Si par exemple on pre([e
avec
la
main une vefIie foufflée, on trouve une réfifrance
fenfible dans l'aír qtú y efr enfermé;
&
fi I'on ceífe
<le la comprimer, la partie qui étoit comprimée fe
tend
&
fe remplit auffitot.
C'
cfr de cette propriété de l'air quedépend la fuuc–
ntre
&
I'ufage de la Machine pneumatiqtle.
roye{
MACHINE PNEUMATIQUF..
Chaque panicule d'
air
fait un continue! effort
po~r
fe
dil~ter,
&
ainú lutte contre -les particules
vOlúnes qtll en font auffi un femblable ; mais ú la
réfifrance vient
a
ceífer ou a s'affoiblir
a
I'infrant la
particule dégagée fe raréfie prodigieu[ement. C'efr
AIR
'Ce qtl; faít qtle fi l'on enferme fous le récipient de
hr
Machine pneumatiqlle de petites balles deverre min–
¡;Cs, ou des veffies pleines d'
air
&
bien fermées,
&
qa'enfuite on pompe I'air, elles.y crevent par la force
de
I'air
qtl'elles contienncnt. Si l'on met ious le
réci~
pient une veffie toute fla(que , qui ne contienne que
tres-peu
d'aü:;
lorfqtl'on vient a pomper l'air, elle
s'y cnfle
&
parolt toute pleine. La meme cbofe ar–
rivera fi l'on porte une veffie flafque fur le fommet
d'une haute montagne.
Cette meme expérience fajt voir d'une maniere
évidente, qtle l'élailicité des corps folides efr fort
djfférente de la vertu élafriqtle de I'air,
&
que les
corps [olides
&
élafriCfues fe dilatent mut autrement
que I'air. En effet, lorique l'air ce([e d'etre compri–
mé, non,.feulement il fe dilate, mais il occupe alors
un plus grand e[pace,
&
reparo!t fous un plus grand
volume qu'aupatavant; ce c¡u'on ne remarque pas
dans les corps folides
&
élafriques, 'lui reptennent
feulement la figure qu'ils avoient avant qtle d'&tre
comprimés.
L'air tel qu'il efr tout procbe de notFe globe fe ra–
réfie de telle maniere que ron volume efr toujoms
en rallon inverfe des poids qtlÍ le colnpriment, c'efr–
a-dire, que fi l'air pteífé par un certain poids, occu–
pe un certain efpace, ce merne air preífé par
UI1
poids qui ne foit clue la moitié du précédent , occu–
pera un efpace double de celui (lU'il occupoit d<lI\s
le premier caso M. Doyle
&
M. Mariotte ont établi
cetteregle par des expériences. La me1l1e regle
a
lien
Ionqu'on comprime I'air , comme M. Mariotte I'a
fait volr auffi. Cependant il he faut pas regarder cette
regle comme parfaitement exaéte; car en compri–
mant I'air bien forten1ent ,
&
le réduifant
a
un volu–
me quatre fois plus petit, l'effet ne répond plus
~¡ja
regle donnée par M. Mariotte ; cet aír commence
alors
a
faire plus de réfifrance,
&
a befoin pour etre
comprimé elavantage , d'un poids plus granel que la
regle ne l'exige. En effet pOttl' peu qtl'on y faífe at–
tention, on vena qu'il efr impoffible qtle la regle foir
exaétement vraie ; car Ior[c¡ue l'air fera fi fort com–
primé qtle toutes [es parties fe tollcheront
&
ne for–
meront qu'tme fellle maífe folide , il n'y aura plus
moyen de comprimer davantage cette maífe, puif-
9ue les corps font impénétrables.
Il
n'efr pas moins
evident que I'air ne famoit fe raréfier
a
l'infini ,
&
que fa raréfaaion a des bornes; d'ol! il s'enfuit qtle
la regle des raréfaétions en raifon inverfe des poids
comprimans, n'eíl: pas non plus entierement exaéte :
car il faudroit fuivant cette regle, qtl'a un degré Cfuel–
conque de raréfaaion de l'air , on trollvat un poids
conefpondant qlÚ empecheroit cette raréfailioo d'e–
tre plus grande. Or lorfc/ue l'air eíl: raréfié le plus
qtl'il efr poffible , iI n'efr alors chargé d'aUCtill poids.
&
il occupe cependant un certain efpace.
On ne íauroit affigner ele bornes précifes
a
l'élafri–
cité ele
I'air
,
ni la détniire ou altérer aucunement.
M. Boyle a fait plufiellrs expériences pour vojr
s'U
pourroit affoiblir le reífort d'un air extremement ra–
réfié elans la Macrune pneumatiqtle , en le tenant
long-tems comprimé par un poids dont
il
efr éton–
nant qu 'il fOllunt la force pendant un feul infrant ;
&
apres tout ce tems il n'a point vú de diminution
feníible dans fon élafricité. M. de Roberval ayant
laiífé un nlÍil
a
vent chargé pendant
16
ans d 'air con–
denfé , cet air mis enfin en liberté , potúfa une baile
avec autant ele force, qu'attroit plt faire
un
air tout
récemment condenfé.
Cependant M. Hawksbée a prétendu prouv'er par
une expérience c¡u'il a faite depuis , que le reífort de
l'air
pem etre tel!ement dérangé par tille violente
preffion, qu'il ne plLiífe plus fe rétablir qu'all bout
de c¡ue!c¡ue tems. Il pric pour cet effet
1m
vaiífeau de
cuivre bien fort, dans lf'quel il vena d'ab0rd une
















