
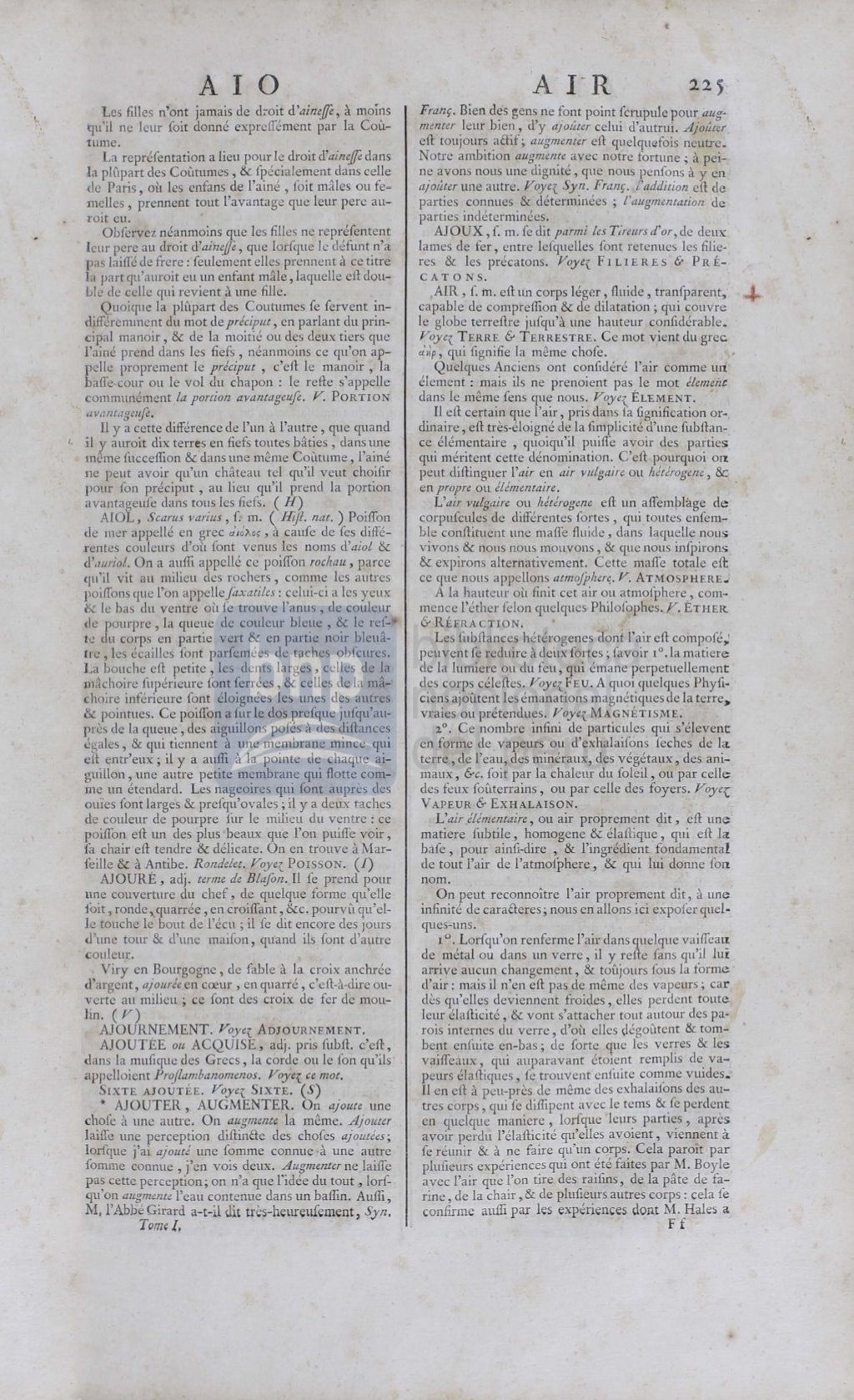
AIO
Les filies n'ont jamais de dmit
d'ainej{e,
a
moíns
tJu'il ne lcm (oit donné expreífément par la COlL-
1ull1e.
La repré(entation a lieu pour le droit
d'ainej{e
dans
la plflpart des COllmmes ,
&
{pécialement dans celle
(.[e Paris,
O~I
les enfans de l'ainé , Coit males ou fe–
melles, prennent tout l'avantage que leur pere au–
roit eu.
Ob{ervez néannlOins
Tle
les filIes ne repré(entent
leur pere au droit
d'ain~Ue,
que 10rCque le défunt.n'a
pas laiífé de frere: {eulement elles prennent 11 ce utre
la
part qu'auroit eu un enfant male, laqueHe eíl: dou–
Lle de celle c¡ui revient a une filIe.
Quoique la p[úpart des Coutumes (e fervent in–
dilférenunent du mot de
précipllt ,
en parlant du prin–
cipal manoir,
&
de la moitié ou des deu.x tiers que
l'ainé prend dans les tiefs , néanmoins ce c¡u'on ap–
pelle proprement le
préciput
,
c'eil: le manoir , la
baíTe·cour ou le vol du chapon : le reRe s'appelIe
c01l11l1unéll1ent
la portion avantogeufe.
V.
PORTION
dvnntageufe.
Il
y a cette différence de I'un
a
l'autre , que quand
/.
ill auroit dix terres en tiefs toutes baties , dans une
mell1e (ucceffion
&
dans une meme Coutume , l'ainé
ne peut avoir qu'un chateau tel qu'il veut choifir
pour (on préciput , au lieu qu'il prend la portion
avantageufe dans touS les tiefs.
(H)
ArOL,
Scarus varius,
f.
m. (
Hijl. nato
)
PoiíTon
de mer appellé en grec
d/~AO<;
,
~
caufe de {es diffé–
rentes couleurs d'oll {ont venus les noms
d'aiol
&
d'auriol.
On a auffi appellé ce poiífon
rocluru,
parce
<Iu'il vit au milieu des rochers, comme les aun'es
poiífolls'lue ['on appelleJaxatiles : celui-ci a les yeux
& le bas du ventl'e 011 fe trouve I'anus , de couleur
de pompre, la queue de couleur bleue ,
&
le re(–
te
du corps en partie vert
&
en partie noir bleua–
tre , les écailIes (ont par(emées de taches obfcnres.
La bouche eíl: petite, les dents larges , celles de la
machoire fupérieure font ferrées ,
&
celles de la ma–
choire inférieure font éloignées les unes des autres
&
pointues. Ce poiífon a (ur le dos prefque jufqu'au–
prcs de la 'lueue, des aiguillons pofés
a
des diíl:ances
¿gales ,
&
qui tiennent 11 une membrane mince qui
eh
entr'eux ;
il Y
a auffi a la pointe de chaque ai–
guillon , une autre perite membrane qui flotte com–
me un étendard. Les nageoires qui font aupres des
oUles {ont larges
&
pref'lu'ovales ; il
Y
a dellx taches
de couleur de pourpre fur le milieu du ventre : ce
poiíTon eil: un des plus beaux que 1'011 puiíTe voir ,
{a chair eíl: tendre
&
délicate. On en trouve
a
Mar–
íeille
&
a
Antibe.
RondeLet. Voye{
POISSON.
(I)
AlOURÉ, adj.
tenue de BLafoll.
Il
fe prend pour
une couverture du chef, de quelque forme qu'elle
{oit, ronde"quarrée, en crourant, &c. pourvllqu'el–
le touche le bout de l'écu ; il (e dit encore des jours
d'une tour
&
el'une maifon, 'luand ils font d'autre
coule\ll:.
Viry en Bourgogne , de fable
a
la croix anchrée
<l'argcnt,
ajollnIe
en creur , en quarré , c'eíl:-a-dire ou–
erte au milieu ; ce font des croix de fer de mou–
lino
(V)
AJOURNE 1ENT.
Voye{
ADJOURNEMENT.
AJOUTÉE
011
ACQUISE, adj. pris fubíl:.
e'dl:,
dans la mufique des Grecs , la corde 0\1 le fon qu'ils
appelloient
Projlombanomenos. Voye{
ce
moto
SIXTE AJOUTÉE.
Voye{
SIXTE.
(S)
" AJOUTER, AUGMENTER. On
ajoule
une
chofe
a
nne aun·e. On
augmeme
la meme.
Ajouter
lai!re une verception dill:inéte des chofes
ajoutées ;
lorfque j'ai
ajout'
une fomme connue
a
une autre
fomme connne ,j'en vois deux.
Augmenter
ne laiíTe
pas cette perception; on n'a que ridée du tout , lon–
qu'on
allgme/lte
l'eau contenue dans un baffin. Auffi,
M,l'AbbéGiral'd a-t-il
dit
tr' s-heureufement,
Syn.
Tome(.
Fra/l9·
Bien
d~s
gens ne
~ont
point (cmpule pour
aug–
menter
leur bien, d'y
ajoIÍter
cehti d'autrui.
AjolÍter
ell:
toujour~
.¡¡fuf;
allgmenter
eil: quelq1\(lfois
neutr~_
Notre ambltlOn
augmeme
avec notre fortune .
a
pei–
ne avons nous une dignité , que nous pen{ons'
a
y en
ajoúter
une autre.
Voye{ Syn. Franf. taddition
ell: de
parries connues
&
déterminées ;
l'augmentation
de
parties indéterminées.
AJOUX,
f.
m. fe dit
parmi les T¡,.eurs d'or,
de deux
lames de fer, enu'e lefc¡uelles {ont retenues les filie–
res
&
les précatons.
Yoye{
F
1
L
1
ERES
&
PR É–
CATONS.
AIR>
f.
m. eil: un corps léger , fluide , tranfparent,
capable de compreffion
&
de dilatation ; qui couvre
le globe terrefire jufqu'a une hauteur confidérable.
Voye{
TERRE
&
T ERRESTRE. Ce mot vient du grec
d,1p ,
qui fignme la meme chofe.
Quelques Anciens ont confidéré I'air comme un:
élement : mais ils ne prenoient pas le mot
élemellt'–
dans le meme fens que nous.
Voye{
ÉLEMENT.
Il
ell: certain que l'air , pris dans
fil
Ggnification 01'.
dinaire, eíl: tres·éloigné de la {¡mplicité d'une fubil:an–
ce élémentaire , C[uoiqu'il puiíTe avoir des parties
qui méritent cette dénomination. C'eil: pourquoi on
peut difringuer
I'air
en
air vulgaire
on
Iu!tJrogene ,
&
en
propre
ou
élémentaire.
.
Vai,. vulgaire
ou
hétérogene
ell: un
affembl~ge
de
cor¡Jiúcules de différentes fortes, qui toutes enfem–
ble coníl:ituent une maíTe fluide , dans laquelle nous
vivons
&
nous nous mouvons,
&
que nous infpirons
&
expirons alternativement. Cette maffe totale eít
ce que nous appelIons
atmoJP!ter~.
V.
ATMOSPHERE ...
A la hallteur 011 linit cet air ou atmo{phere , com–
mence l'éther feIon quelques Philofophes.
Y.
ÉTHER.
&
RÉFRACTION.
Les {ubil:ances hétérogenes dont l'air eíl: compofé,.!
peuvent fe reduire
a
dellx fortes; favoir ¡O. la mariere
de la lumÍel'e ou du feu, qui émane perpemellement
des corps célell:es.
Voye{
FEu.
A quoi c¡uelques Phyü.
ciens ajoutent lesémanations magnétiquesde la terre..
vraies ou prétendues.
Yoye{
MAGNÉTIS,ME.
2
0
•
Ce nombre infini de particules qui s'élevent
en forme de vapeurs ou d'exhalaifons {eches de la
terre, de I'eau, des minéraux, des végétaux, des ani–
maux,
&c.
foit par la chaleur du foleil, ou par celle
des feux fOltterrains, ou par celle des foyers.
Voye{
VAl'EUR
&
EXHALAISON.
L'
air élémemaire ,
ou air proprement dit, eil: une
matiere fubrile, homogene
&
élafrique, c¡ui eft la
ba(e, pour ainü-dire ,
&
l'ingrédient fondamental
de tout I'air de I'atrnofphere,
&
qui lui donne fon
nomo
On peut reconnoitre l'air proprement dit, a une
infinité de caraéteres; nous en allons ici expofer quel–
c¡ues-uns.
¡
O.
Lorfqu'on renferme I'air dans 'luelque vaiffealt
de métal ou dans un verre , il
Y
rell:e fans qu'il lui:
arrive aucun changement,
&
tofljours fous la forme
d'air: mais il n'en ell: pas de meme des vapeurs; car
des Cf11'eUes deviennent froides, elles perdent toute
leur élafricité ,
&
vont s'attacher tout autour des pa–
rois intemes du verre, d'oh elles <légolltent
&
tom–
bent enfuite en-bas; de forte que les verres
&
les
vaiíTeaux, qui auparavant étoient remplis de. va–
peurs élafriCf1les, fe trouvent enCuite
co~me
vlUdes_
Il en eft
a
peu-pres de meme des exhalaifons des au–
tres corps , Cf1li fe diffipenr avec le tems
&,re
perde~t
en quelCf11e maniere, lorfque leurs parnes, apres
avoir perdu I'élail:icité qn'eHes avoient, viennent
a
fe rétmir
&
a
ne faire qu'un corps. Cela parolt par
pluíieurs expériences Cf1IÍ ont été faites par M. Boyle
avec I'alr que l'on tire des raifins, de la pate de fa–
rine de la chair,
&
de plufieul's autres corps: cela fe
confirme alLffi par les expériences dont M. Hales a
Ff
















