
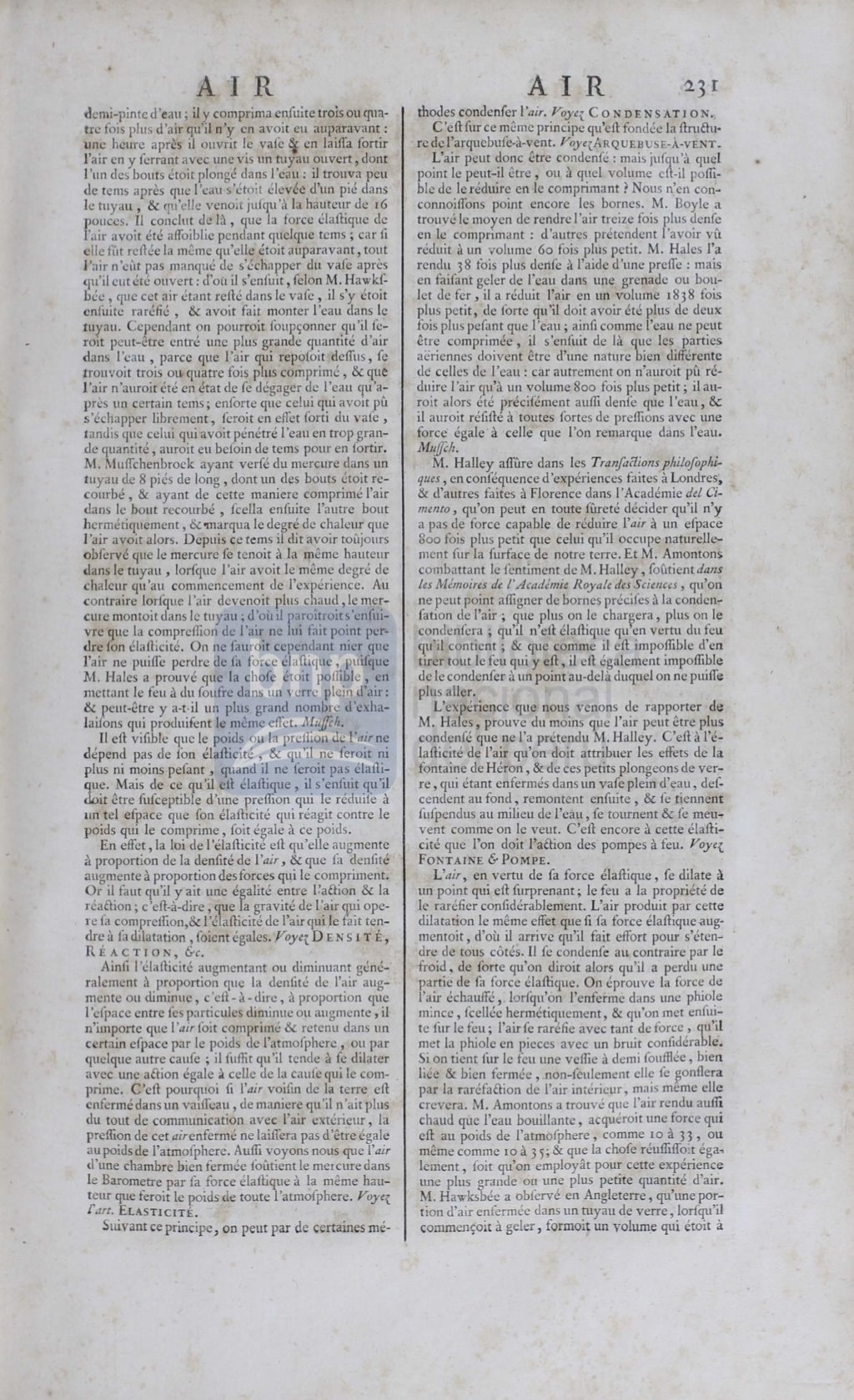
AIR
tlcmi-pinted'eau; il Ycomprima enIuite troisou qua–
trc fois plus d'air qu'il n'y en avoit en auparavant:
\IOC
heure apd!s il ouvrit le va/e
~
en laiffa {onir
l'air en y {errant avec une vis un tuyau ouvert, dont
l 'un des bouts éroit plongé dans l'eau : il trouva peu
de tems apres que l'eau s'étoit élevée d'un pié dans
le tuyau , & (Iu'elle veno: juíqu '11 la hauteur de r6
pouees. II concltlt de
la,
que la force élallique de
rail' avoit été a/foiblie pendant quelque tems ; car fi
elle fltt rell:ée
la
meme qn'elle étoit auparavant, tout
l'air n'eíit pas manqué de s'échapper du vafe apres
qu'il cut été ouvert: d'oit il s'en{uit, {elon M. Hawkf–
héc, que cet air étant rell:é dans le va{e, il s'y étoit
cnlillte raréfié, & avoit fait monter ['ean dans le
tllyau. Cependant on pourroit {oupr,:onner qu'il {e–
roit peut-etre entré une plus grande quantité d'air
dans l'cau , parce que l'air qui repoloit deffus, {e
trouvoit trois ou qllatre fois plus comprimé, & que
l'air n'auroit été en état de {e dégager de I'eau qu'a–
pres un certain tems; en{orte que celui 'lui avoit pu
s'échapper librement, {eroit en eflet {orti du vafe,
tandis que celui qui avoit pénétré
1
'eau en trop gran–
de qllantité, auroit en befoin de tems ponr en [ortir.
M. Muffchenbroek ayant verfé du mt:rcure dans un
tuyau de 8 piés de long, dont un des bouts étoit re–
courbé,
&
ayant de cette maniere comprimé I'air
clans le bout reconrbé , [cella enCuite I'autl'e bout
hermétiquement, &'l11arqua le degré de chaleur que
l 'air avoit alors. Depllis ce tems il clit avoir tOfljOllIS
ob{ervé que
le
mercure {e tenoit a
la
meme hauteuI
dans le tuyan , lor{que l'air avoit le meme degré de
chaleur qu'au commencement de I'expérience. Au
contraire lorfque I'air devenoit plus chaud, le mer–
cme montoit dans le tllyau ; d'Oll il parOltroits'enfui–
vre que la compreffion de I'air ne lui fait point per–
dre fon élall:icité. On ne {auroit cependant nier que
l'air ne puiffe perdre de fa force élaftique, pui{que
M. Hales a prouvé que la chofe étoit poffible , en
mettant le feu
a
du foufre dans un verre plcin d'air:
&
peut-&tre y a-t·il un plus grand nombre d'exha–
lallons qui produifent le meme e/fet.
MuJ[cft.
II efr vifilile que le poids Ol! la preffion de I'airne
dépend pas de Ion élallicité , & qu 'il ne feroit ni
plus ni moins pefant
>
quand il ne feroit pas élafri–
que. Mais de ce qu'il eH élafrique, il s'enfnit qu'il
doit &tre fu{ceptible d'une preffioll qui le réduite
a
un tel efpace que ron élafticité c¡ui réagit contre le
poids qui le comprime, (oit él?ale
¡\
ce poids.
En elfet, la loi de l'élallicite ell: qu'elle augmente
a
proportion de la denfité de
l'air,
& que
{.1
deníité
3ugmente a proportion des forces qui le compriment.
01'
il faut qu'il yait une égalité entre I
~atlion
& la
réaé1ion; c'efr-a-dire, que
la
gravité de l'air
qui
ope-
1
e fa compreflion,&
1
'élall:icité de l'air qui le faít ten–
me a fa dilatation ,foient égales.
Voye{
D EN
S 1 TÉ,
R
É
A C T
ION,
&c.
Ainfi
1
'élallicité augmentant ou diminuant géné–
ralement a proportion que la denfité de l'air aug–
mente ou diminue, c'ell:- a -dire, a proportion que
)'efpace entre fes particules diminue ou augmente, il
n'importe que
l'air
{oit comprimé & retenu dans un
c rtain efpace par le poids de l'atmo[phere , ou par
quelque autre catúe ; il fuRit qu'il tende
a
fe dilater
avec lme aé1ion égale
a
celle de la caufe c¡ui le com–
prime. C'ell: pourqlloi fi
l'air
voifm de la terre ell:
enfermé dans un vai(feau , de maniere qu 'il n'ait plus
du tout de cornmurucation avec l'air extérieur, la
pre1Uon de cet airenfermé ne laiffera pas d'etre égale
au poids de l'atmo{phere. Auffi voyons nous que l'
air
ti
'une chambre bien ferm 'e lofltient le mercure dans
le Barometre par {a force élallique
a
la meme hau–
teur que feroit le poids e toute
1
'atmofphere.
Voye{
r,trl.
ELA TI CITÉ.
5lúvant ce principe, on pent par de certaines mé-
AIR
modes condenfer
l'air. Voye{
e
o N
D
EN
S ATI
o
N.
e
'ell:{ur ce meme principe qu'eíl: fondée la fuué1u.
re de l'arqnebufc-a-vent.
VOyt{
ARQUEBUSE-A-VENT.
L'air peut donc etre condenfé : mais jufqu'a qud
point le peut-il etre , ou aquel volume cfr-i1 poffi–
ble de le réduire en le comprimant
?
Nous n'en con–
connoiffons point encore les bornes. M. Boyle a
trouvé le moyen de rendre I'air treize fois plus denfe
en le comprimant : d'autres prétcndent )'avoir
VIL
réduit a un "Volume 60 fois plus perito M. Hales I'a
rendu 38 tois plus den{e a l'aide d'une preffe : mais
en fallant geler de l'eau dans une grenade ou bou–
let de fer, il a réduit I'air en un volume 1838 foís
plus petit, de lorre qu'i1 doit avoir été plus de deux
fois plus pefant que l'cau; ainfi comme l'eau ne pent
etre comprimée, il s'enfuit de la que les parties
aeriennes doivent etre d'une nature bien di/férente
de celles de l'eau : car autrement on n'auroit pll ré–
duire
1
'air ([u'a un volume 800 fois plus petit; il all–
roit alors été Frécifément auffi den{e que l'ean,
&
il auroit réfill:e
¡\
toutes {ortes de preffions avec une
force égale a celle que I'ón remarque dans l'eau.
MuJ[cft.
M. Halle}' affftre dans les
Tranfaélions plziloJop/¡i–
ques,
en conféquence d'expériences faites
a
Londres,
&
d'aurres faites
a
Florence dans l'Académie
del Ci–
mento,
qu'on peut en toure fltreté décider qu'il n'y
a pas de force capable de réduiTe
l'air
a un efpace
800 fois plus petit que celui qu'il occupe nahlrelle–
ment {ur la (urface de notre terreo Et M. Amonrons
combattant le lentiment de M. Halley , fofttient
dans
les Mémoires de l'AcadJmie Royale des
ScitTlc~s
,
qu'on
ne peut point affigner de bornes préci[es
a
la condcn–
fation de I'air; que plus on le
char~era,
plus on le
condenfera ; qu'il n'ell: élall:ique qu en verht du feu
qu'il conrient ;
&
que comme il ell: impoffible d'en
tirer tout le feu qui y efr , il ell: également impoffible
de le condenfer a un point au-dela duquel on ne puiffe
plus aLler.
L'expérience que nous venons de rapporter de
M. Hales, prouve du moins que I'air peut etre plus
condenfé que ne I'a prétendu M. Halley. C'ell: a l'é–
lafricité de I'air qu'on doit attribuer les effets de la
fontaine de Héron ,
&
de ces petits plongeons de ver–
re, 'luí étant enfermés dans lll1 vafe plein d'eau, def.
cendent au fond, remontent en{uite, & [e tiennent
[u(pendus au milieu de l'eau, {e tOllrnent & fe men–
vent comme on le veut. C'ell: eneore
a
cene élafri–
cité que 1'0n doít l'aé1ion des pompes
a
feu.
Voye{¡
FONTAINE
&
POMPEo
L'llir,
en veffil de {a force élall:ique, fe dilate
a
lll1 point qui efr [urprenant; le feu a la propriété de
le raréfier conCtdérablement. L'air produit par cette
dilatation le meme elfet que fi [a force élailique.aug–
memoit, d'oll il arrive qu'il fait e/fort POttr s'éten–
dre de tous cotés. Il [e conderne au contraire par le
froid, de {orte qu'on diroit alors qu'íl a perdu une
partie de {a force éla1l::ique. On éprouve la force de
l'air échaulfé, lorfqn'on ¡'enferme dans une phiole
mince, fceLlée hermétiquement,
&
qu'on met enfui–
te {m le feu; I'air[e raréfie avec tant de force, qu'il
met la phiole en pieces avec un bruit con/idérable.
Si on tient fur le feu une veffie
a
demi fouHlée , bien
liée
&
bien fermée , noo-{elllement elle fe
~onf1era
par la raréfaéhon de l'air intérieur, mais meme elle
creyera. M. Amontons a trouvé que l'air rendu auiIi
chaud que I'eau bouillante, acquéroit tme force qtü
efr au poids de I'atmotphere, comme 10
a
33, ou
meme comme 10
a
35;
&
que la chofe réuiIiffo:t éga.
lement, (oit qu'on employ¡¡t ponr cette expérience
tUle plus grande on une plus petite quantité d'air.
M. Hawksbée a obfervé en Angleterre, qu'unepor–
tion d'air enfermée dans un Ulyau de verre, lorfqtt'il
commen~oit
a
geler , formoit un yohune qui éroít a
















