
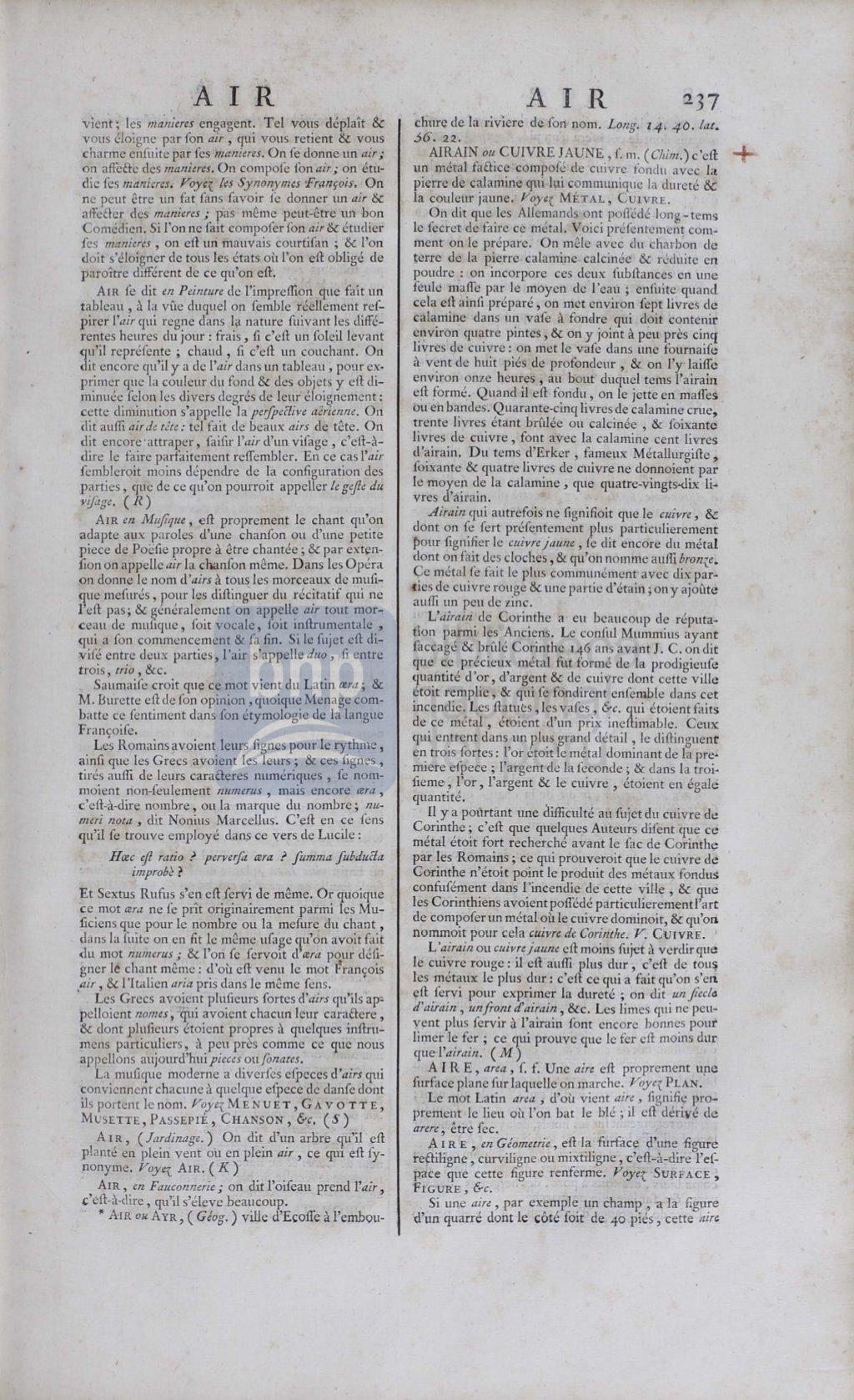
·A 1 R
vient; les
nlauieres
engagent. Te! vous déplalt
&:
vous éloigne par (on
air,
qui vous retient & vous
charme enCuite par (es
manieres.
On (e donne un
air;
on affeae des
manitres.
On compole Ion
air;
on étu–
die (es
lllanieres. Voye{ üs Synonymes -Fr(lnyois.
On
ne peut etre un fat (ans {avoir {e donner un
air
&
affeaer des
mallieres;
pas meme peut-etre un bon
Comédicn. Si I'on ne {ait compoü:r {on
air
& étudier
fes
manieres,
on eí!: un mauvais courti(an ; & l'on
doit s'éloigner de tous les états
011
l'on eíl: obligé de
paroltre différent de ce qu'on eí!:.
AIR (e dit
en
Peillture
de l'impreffion que fait un
tableau ,
a
la vtle duque! on femble réellement re(–
pirer
l'air
qui regne dans la nattlre (uivant les diffé–
rentes heures du jour : frais, /i c'eí!: un {oleillevant
qu'il repré{ente ; chaud, /i c'eí!: un couchant. On
di~
encore qu'il ya de
l'air
dans un tableau, pour ex–
prImer que la couleur du fonel
&
des objets y eí!: di–
minuée felon les elivers degrés de lem éloignement:
cette diminntion s'appelle la
perfpeélive aerienne.
On
dit all/fi
airdet¿te:
tel fait de beaux
airs
ele tete. On
dit encore 'attraper, (ai(u'l'air d'lIn vifage , c'eí!:-a–
dire le faire parfaitement re/fembler. En ce cas
l'air
{embleroit moins dépendre de la configuration des
parties, que de ce (ju'on pOlmoit appeller
le
gejle du
vifilge.
(R)
AIR
en
M1ifi'lue,
eí!: proprement
le
chant qu'on
adapte aux paroles d'une chan(on ou el'une petite
piece de Poe/ie propre a etre chantée ; & par exten–
[¡on on appelle
air
la cllaofon meme. Dans les Opéra
on donne le nom
d'airs
a tous les morceaux de mu/i–
que me(més, pour les diilinguer du récitatif qlÚ ne
reí!: pas; & généralement on appelle
air
tout mor–
ceau de mu/ique, (oit vocale, foit iníl:rumentale ,
<¡ui a (on commencement
&
fa fin. Si le (ujet eí!: di–
vifé entre deux parties, I'air s'appelle
dlto,
fl entre
trois,
trio, &c.
Saumai(e croit que ce mot vient du Latin
cera;
&
M.
Burette ellde (on opinion ,qnoique Menage com–
batte ce (entiment dans fon étymologie de la langue
Francoi(e.
Le's Romains avoient leurs /ignes pour le rythme ,
ainfl que les Crecs avoient les leurs;
&
ces /ignes ,
tirés au/fi de leurs caraaeres numériques , fe nom–
moient non-feulement
numerus,
mais encore
lera ,
c'eí!:-a-dire nombre, ou la marque du nombre;
nu–
meri nota,
dit Nonius Marcellus. C'eí!: en ce fcns
qu'il (e trollve employé dans ce vers de Lucile :
Hcec ejl ratio? perverfiz (Bra
?
fumma fubduéla
improbe?
Et Sextus
Rufi.lss'en eí!: (ervi de meme. Or quoique
ce. mot
ara
ne fe prIt originairement parrni les Mll–
[¡clens que pour le nombre on la mefure dn chant ,
dans la fuite on en fit
le
meme ufage qu'on avoit faít
<lu mot
numerus;
& l'on fe fervoit
d'ara
pour dé/i–
gner le chant meme: d'ol! eí!: venu le mot Fran<;ois
.air,
&
l 'ludien
aria
pris elans le meme fens.
Les Grees avoient plll/ieurs fortes
d'airs
qu'ils ap–
pelloient
nomes,
qtlÍ
avoient chacun lcm caraaere,
&
elont plu/ieurs étoient propres a quelc¡ues inftru–
mens particuliers,
a
peu pres eomme ee que nous
appellons aujourd'hui
pieas oufonates.
La mu/ic¡ue moderne a diverfes efpeces
d'airs
C¡lÚ
~onviennent
chacune
a
quelque e[peee de darúe dont
1Is portent ¡'e nomo
Voyet
M ENUE T, CA
V
o
TT E,
MUSETTE, PASSEPIÉ, CHANSON ,
&c.
(S)
Al R,
(Jardinage.)
On dit d'un arbre qu'il eí!:
planté en plein vent oh en plein
air
,
ce
'luÍ
e11: (y–
nonyrne.
Voytz
AIR.
(K)
,.AlR,.
en
Fall,~on:z:rie;
on dit l'oi(eau prend
l'air,
e
eí!:-a-dire , qUII s eleve beaucoup_
.. AIR
Oll
AYR, (
G/og.
)
ville d'E,o/fe
el
l'embou-
AIR
237
chure de la riviere de (on nomo
Long.
1+
4
Ó •
lato
.5G.22.
AIRAIN
Olt
CUlVREJAUNE ,f. m.
(Clúm.)c'efr
+
un méral faaiee comporé ele cuivre fonelu avec la
pierre de calamine qui lui communique la elureté
&
la couleur jalme.
I'oyet
MÉTAL, CUIVRE.
On dit que .les
Alle~ands o.n~
pofTédé long -tems
le fecret de faHe ce metal. VOICl prefentement COl11-
ment on le prépare. On mete avec du charbon de
terre de la pien'e calamine calcinée & réduite en
poudre : on incorpore ces deux fubfranees en une
feule ma!fe par le moyen de l'eau ; enfuite quanc[
cela
e~
am/i préparé, on met environ fept livres ele
cala.mllle dans u,: vafe a fomlre qui doit contenir
~~vlfon qll~tre
pmtes, & on y joint
el
peu pres cinc[
hvrcs de Clllvre: on met le vafe dans une fOllfnaife
a
v
7
nt ele huit piés de profondeur ,
&
on I'y lai/fe
enVlron
~nze heu~es
, au bout duquel tems l'airain
eí!: forme. Quand
Il
efr fondll, on le jette en ma/fes
ou en bandes. Quarante-cinq livres de calamine crue
r:ente livres. étant brtLlée ou calcinée ,
&
{oixant~
hvres de CUlvre, font avec la calamine cent livres
d'~irain.
Du tems
~'Erker
, fameux Métallurgií!:e,
.{oL'(ante & quatre
hvr.esde cuivre ne donnoient par
le moyen de la calamme, que c¡uatre-vingts-dix li–
vres d'airain.
Airaill
c¡ui autrefois ne /ignifióit que le
cuivre,
&
dont on (e fert préfentement plus partieulierement
pour /ignifier le
cllivrejalllle
,
fe dit encore du métal
elont
~n
fait
de~
cloches,
&
qu'on,nomme au/fi
bron{e.
~e
metal.fefalt le plus communement avec dix par–
(leS de elllvre
rOll.ge& une partie d'étaÍn; on y ajotlte
au/fi un peu ele zmc.
L'
airaíll.deCorir,lthe
a
eu beaucoup ele réputa–
don
p~nm
le:
~ncl~ns.
Le con{¡d Mummius ayant
faecage & bnue COrInthe
J
46
ans avant J. C. on dit
que e.e
,pr~cieu~
métal fut formé de la prodigieu{e
quahtIte d or, d argent & de clúvre dont certe ville
étoit remplie,
&
c¡ui fe fondirent en(emble dans cet
incendie. Les fratues, lesva(es,
&c.
qui étoient faits
de ce métal, éroient d'un prix ineíl:imable. Ceux
c¡ui entrent dans un plus granel détail , le diíl:inuuent
e~
n'ois fortes: ror étoit le métal dominant de
I~
pre'
mlere e(pece ; l argent ele la feconde
¡
&
dans la troi–
/ieme?
~'or
, l'argent & le euivre , étoient en égale
quantlte.
Il
ya pourtant une c'!ifficulté an (ujet du cuivre de
C~rint?e
i
c'efr que qllel9ues Autems di1ent que ce
metal etoa fort recherehe avant le hlC de Corinthe
par !es Romains; ce qui prouveroit que le cuivre de
Connthe n'étolt point le produit des métaux fondus
confi.I{~me~t
dans
I.'incendi~ ~e
cette ville , & que
les Connthlens aVOlent po/fede particulierementl'art
de
com~oferun
métal ollle cuivre dominoit,
&
qu'on
nommOlt pour cela
CUlvre de Corintlte.
V.
CUIVRE.
L'airaillOU cuivrejaune
eí!: moins {¡Ijet
a
verdirque
le cuivre rouge : il eí!: auffi plus dur c'eí!: de tOllS
les
mét~ux
le plus
~nr:
e'efr ce qui a'faít qu'on
s'e~
eí!: Fervl pour expnmer la dureté ; on dit
un
Jiecl5
d'(//Jam, ullfiwu d'airain,
&c. Les limes c¡ui ne peu–
~ent
plus (ervir
a
l'airain font encore bonnes pour
IImer le fer ; ce C¡lÚ prouve que le fer eí!: moins dur
que
I'airaill.
(M)
Al RE,
area,
f.
f.
Une
aire
efr proprement upe
furface plane
(ur
laquelle on marche.
Voye{
PLAN.
Le mot Latín
orea,
d'ou vient
aire,
/ignifie pro–
prement le lieu oll I'on bat le blé; il eí!: dérivé de
arere,
etre {ec.
Al RE,
m
Géometrie
,
eí!: la fllrface d'tlhe -figure
re~'¡gne,
curviligne
011
mixtiligne, c'eí!:-a-dire
l'eC–
pace que cerre figure renferme.
Yoye{
SURFACE,
FIGURE,
&c.
Si une
aire,
par exemple un champ , a la figure
d'un quarré dont le ,óté foit de 40 piés , cette
ai"
















