
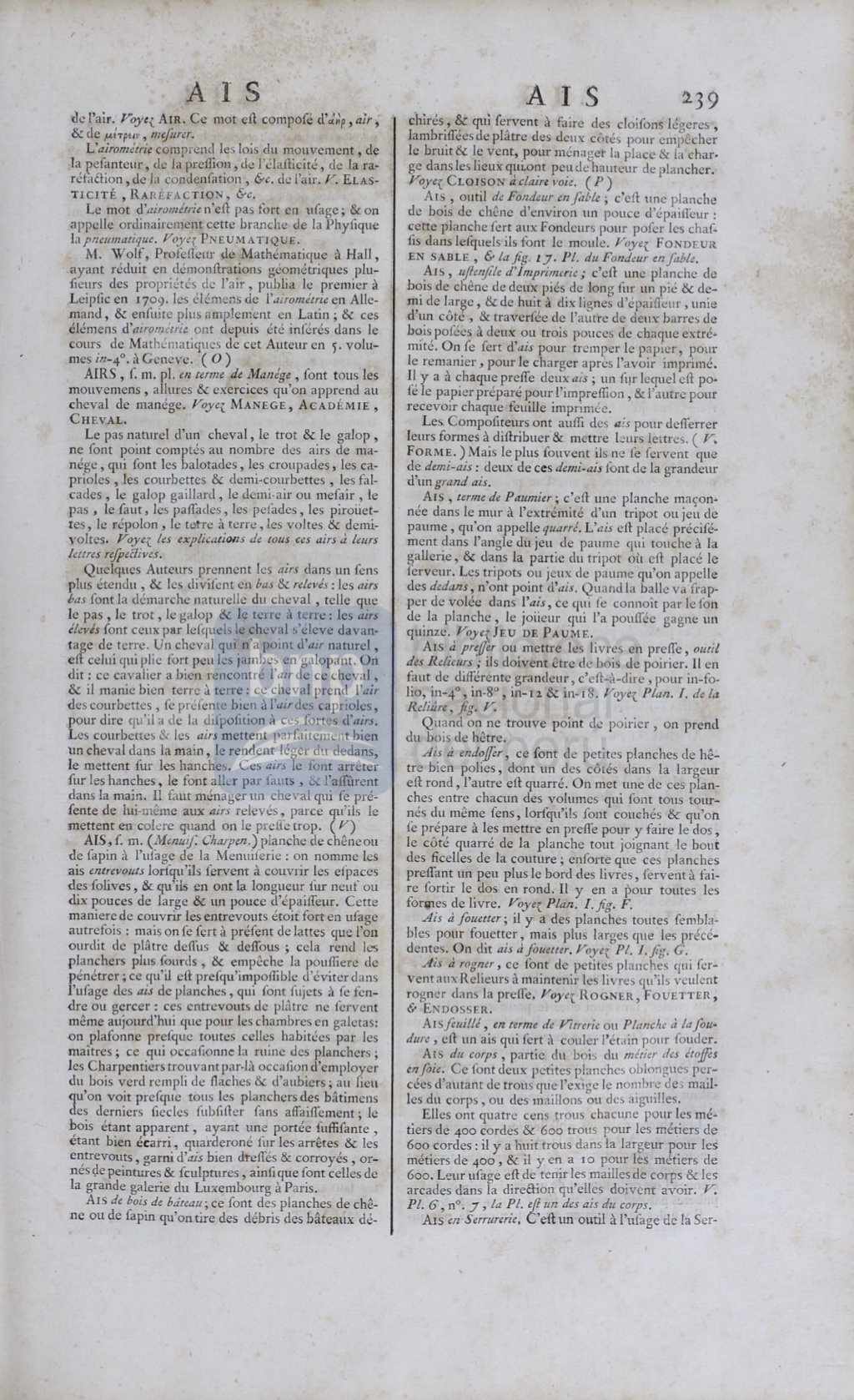
AIS
ticl'air.
Voye{
AIR. Ce mot eíl: compofé
d'd,)p,
alT;
&
de ¡..<:TP"" ,
mifur~r.
L'airométrie
comprend les loís du mouvement, de
la pefantellr , dc la prefiion , de l'élaiticité, de la ra–
réfaélion, de la conden{¡¡tion ,
&c.
de I'air.
V.
ELAS–
TICITÉ ,RAR ÉFACTlO ,
&c.
Le mot
d'airométrie
n'cíl: pas fort en lúage;
&
on
appelle ordinairement cette branche de la Phyiique
la
pneurnatique. Voye{
PNEUlI1ATIQUE.
M. \Volf, Profe{[eur de Mathématique
a
Hall,
ayant réduit en démoníl:rations géométríques plu–
neurs des propriétés dc I'air, pubüa le premier
a
Leiplic en 1709, les élémens de
1',Lirométrie
en Alle–
mand,
&
enfuite plus amplem nt en Latin ;
&
ces
élémens
d'airométric
ont depuis été inférés dans le
COlU"S de Mathématiqucs de cet Auteur en 5. volu–
mes
in-4°.
¡\Geneve.
(O)
AIRS , f. m. pI.
m
terme de Manége
,
font tous les
mouvemens , allures
&
exercices (]ll'on apprend au
cheval de manége.
Voye{
MANEGE, ACADÉlI1IE,
CHEVAL.
Le pas nature! d'un cheval, le trot
&
le galop,
ne font poillt comptés au nombre des airs de ma–
nége, qui font les balotades , les croupades , les ca–
prioles , les courbettes & demi-courbettes , les fal–
cades, le galop gaillard, le demi·air ou mefair , le
pas, le faut, les pa{[ades, les petades , les piroliet–
tes, le répolon , le teh'e
a
tcrre , les voltes & demi–
yoltes.
Voye\.
ÜS
explicalÍOils de
tollS
ces airs ti leurs
Lcttres rqpeélives.
Quelques Auteurs prennent les
airs
dans un fens
plus étendu , & les divifent en
bas
&
rd evés
:
les
airs
óas
font la démarche naturelle du cheval , telle que
le pas , le trot , le galop & le terre a terre : les
airs
¡l.'Vis
font ceuKpsr lefc¡uels le cheval s'éleve davan–
tage de terreo Un cheval qui n'a point
d'air
nature! ,
eíl: celuí c¡ui plie fort peu les jambes en galopant. On
dit ; ce cavalier a bien rencontré l'
air
de ce cheval ,
&
il manie bien terre a terre: cc cheval prend
l'air
<les courbettes , fe préfente bien
a
I'airdes
caprioles ,
pour dire qu'il a de la difpolition ¡\ ces fortes
d'airs.
Les courbettes
&
les
airs
mettent parfaitement bien
\111
cheval dans la main , le rendent léger du dedans,
le mettent fur les hanches. Ces
air,
lc font arreter
{ur les ha.nches , le font alicr par fauts ,
&
l'aífttrent
dans la main.
Il
faut ménager un cheval qui fe pré–
(ente de hlÍ-memc ame
airs
relevés , parce qu'ils le
mettent en colere quand on le prc[ e tropo
( V)
AIS, f. rn.
(Mlf2uif.
Charpen.)
planche de cheneou
de fapin a l'ufage de la Menui(erie: on nOrnme les
ais
entrevo/tts
10rf~u'i1s
fervent ¡\ couVI;r les elpaccs
des folives,
&
'Iu
ils
en ont la longuetrr
(ur
neuf ou
<lix
pOllces de largc
&
un pOllce d'épaifTeur. Cette
manierc de couvrir lesentrevouts étoit fort en lúage
autrefois ; mais on fe fcrt a préfent de lattes que l'on
ourdit dc platre de{[us
&
de{[ous ; cela rend
les
planchers
plus
fOllrds , & empechc la pouffiere de
pénétrer; ce 'Iu'il eíl prefqu'impoíl'ible d'éviter dans
l'ufage des
ais
de planches,
qui
font fujets
11
fe fen–
are ou gercer ; ces cntrevouts de plñtrc ne fcrvent
meme aujOLrrd'hui que pour leschambres en galetas:
on plafonne prefque toutes celles habitées par les
maltres ; ce qui occafionne la mine des planchers;
les Charpentiers trouvantpar-La occaliond'employer
du bois verd rempli de flaches
&
d'aubiers ; au [jen
qu'on voit prefc¡ue tous les planchers des batimens
des derniers lieeles fubliíl:er fans affaiífement; le
bois étant apparent , ayant une portée fuffifante ,
étant bien écarri , qu,u'deroné fm les arretes & les
entrevouts , aarni d'
ais
bien drefTés
&
corroyés , or–
nésQe
peintu~es
&
fculptmes , ainli que font celles dc
la grande galerie du Luxembourg
a
Paris.
Al
de bois
de
bá.teau;
ce font des planches de che–
ne ou de fapio qu'on tire des débris des bateaux dé-
A 1 S
¿hirés ,
&
qul
fervent
11
faire des c1oifons légeres ,
lambriífées de platre des deux c{,tés pour empccher
le bruit & le vent, pour ménager la place
&
la char–
ge dans les lieux qui.ont peudehaureur de plancher.
Voyez
CLOISON
a claire voi•. (P)
AIS , outil
de Fondeur enJable;
c'eíl: une planche
de bois de chene d'environ un pouce d'épaiífcur :
cette planche {ert aux Fondcurs ponr pofer les ehaf,
ns dans lefquels ilsfom le moule.
V oye\.
FONDEUR
EN SABLE, {,.
iafig.
l.7.
Pi. du Fondeur w jtzble.
AlS ,
lIj1uifile
d'lmprimerie ;
e'eíl: une planchc de
bois de chene de deux piés de long fur un pié & de–
mi de lar
g
e ,
&
de huit
11
dix lignes d'épaiirellr, unie
d'un cote ,
&
traverfée de l'autre de deux barres de
bo!s pofées
11
deux ou trois pouces de chaque extré·
mité. On fe fen d'
ais
pour u·cmper le papier, pour
le remanier, pOUT le charger apres l'avoir imprimé.
Il
y a achaque pre{[e deux
ais
;
un fllr leque! eíl: po–
fé le papier préparé pour l'impreíl'ion ,
&
l'autre pOlrr
recevoir chaque feuille imprimée.
Les Compoíiteurs ont auíl'i des
/lis
pour de{[errer
leurs formes
a
diíl:ribuer
&
mettre lellrs lemes. (
V.
FORlI1E.) Mais le plus fouvent ils ne fe fervent que
de
demi-ais :
deux de ces
demi-aÍJ
font de la grandeur
d'un
grand aÍJ.
Als ,
termed¿ Pallmier;
c'eíl: une planche ma<;:on–
née dans le mur
a
l'extrémité d'un tripot ou ¡en de
paume , qu'on appelle
quarré.
L'
ais
eíl: plaeé précifé–
ment dans l'angle du jeu de paume qui touche ¡\ la
gallerie, & dans la partie du tripot oh eíl: placé le
íerveur. Les tripots ou jeux de paume qu'on appelle
des
dedans,
n'ont point
el'és.
Quand la balle va fi'ap–
per de volée dans l'
ais ,
ce 'luí fe connolt par le fon
de la planche , le joiieur qui I'a pou{[ée gagne un
quinze.
Voye{ JEU
DE PAUlI1E.
AIS
ti priffir
ou mettre les livres en pre{[e ,
outil
des R elieurs;
ils doivent etre de bois de poi.rier.
Il
en
faut de diiférente grandeur , c'eíl:-a-dire , pour in-fo–
lio, in-4° , in-8° , in-u & in-1 8.
Voye\.
PLan.
l. de la
R eüüre, fig.
V.
Quand on ne trouve point de poirier, on prend
du bois de hetre.
Ais
ti:
endoJlér ,
ce font de petites planches de he–
tre bien polies , dont un dcs cOiés dans la largeur
eíl: rond, l'autre eíl: quarré. On met une de ces plan–
ches entre chacun des volumcs qui font tous tOUT–
nés du meme fens, 10rfCj1l'ils [om couchés & c¡u'on
fe prépare a les mettre en preíre pour y faire le dos,
le coté quarré de la planche tout joignant lc bout
des /leeHes de la comure ; enforte que ces planches
preiI¡lI1t un peu plus le bord des livres, fervent
a
fai–
re forrir le dos en rond.
Il
y
en a POUT toutes les
forllles de livre.
Voye\. Plan. l. fig. F.
Ais
ti:
fouetter ;
iI
Y
a
des planches toutes fembla–
bIes pour fouetter, rnais plus larges que les pr'cé–
dentes. On dit
ais tifoumtr. Voye{ Pi. l.fig.
G.
A¿s ti rogner ,
ce font de petites planches 'lui fer–
Vent auxRelieurs
a
maintenir les livres Cju'ils veulent
rogner dans la pre{[e.
VOY"\.
ROGNER, FOUETTER ,
&-
ENDossER.
A ISfeuillé , en terme de Vttrerie
ou
pltllzc!ze ti la
Jou.
dur¿
,
eíl: un ais Cj1!Í fert a couler I'étain pour fouder.
AIS
da corps
,
partie du bois du
müier d¿s itoffis
en
Joie.
Ce font deuK petites planches oblongues pe:–
céesel'amant de trousCj1le l'eXIge le
nombJ"~
des mail–
les du corps, ou des maillons Otl des alguilles.
Elles ont quatre cens trous chacune pour les mé–
tiers de 400 cordes & 600 trous pour les
mé~iers
de
600 cordes ; il Ya huit trous dans la largeur P?ur les
métiers de 400, & il yen a 10 pour les metlers de
600. Leur ufage eíl: de tenir les mailles de corps & les
arcades dans la direfrion Cj11'elles doivent avoir.
V.
Pi.
6
n
O •
.7,
La
Pi.
e(l
un des ais du corps.
AI~
en Sermrerie.
C'eíl: un outil
11
I'ufage de
la
Ser-
















