
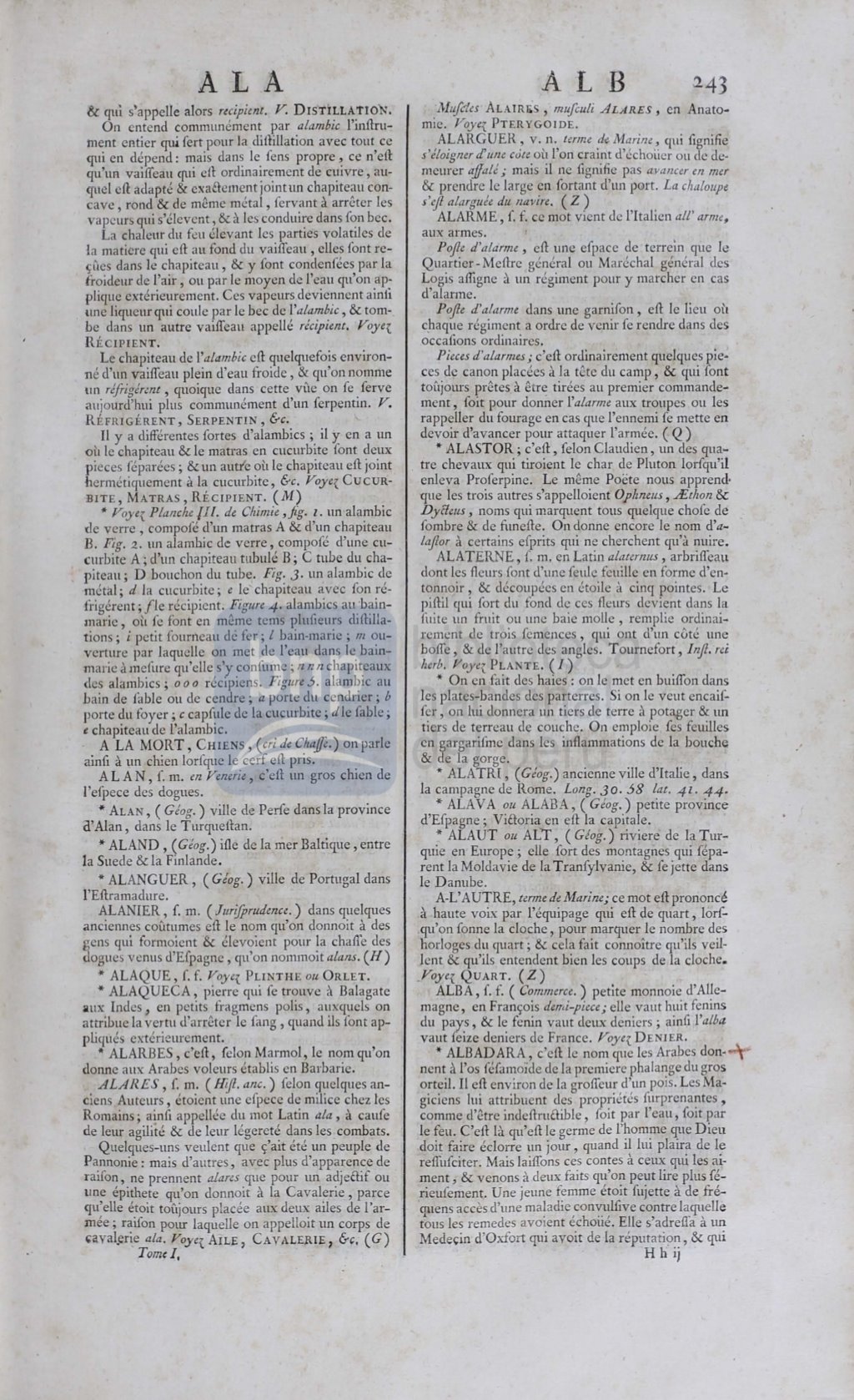
ALA
&
qUl s'appeUe alors
mipiwl.
V.
D IS'TILLATION.
On entend communément par
alambie
l'inftru–
n1ent eatier qui {ert pour la diftilIation avec tout ce
qui en dépend: mais dans le {ens propre, ce n'eí!:
qU'l1R vaiífeau 'lui efl: ordinairement de cuivre, au–
quel ea adapté
&
exaétementjointun chapiteau con–
cave, rond
&
de m&me métal , [ervant
a
arr&ter les
vapeurs qui s'élevent,
&
a
les conduire dans ron beco
La chaleur du feu élevant les parties volatiles de
la maticre 'lui eí!: au fond du vaiífeau , elles {ont re–
~í'les
dans le chapiteau,
&
Y
[ont conden{ées par la
fi-oideur de l'air, ou par le moyen de l'eau Cju'on ap–
plique eA'térieurement. Ces vapeurs deviennent ainli
une liql1enrqui coule par le bec de
I'alambie,
&
tom–
be dans un autre vaiffeau appellé
récipient. Yoye{
RÉCIPlENT.
Le chapiteal1 de
I'alambie
efl: Cfllelquefois environ–
né d'un vailfeau plein d'eau fi'oide ,
&
qu'on nomme
un
réftigérmt
,
CfllOiqne dans cette vtie on {e [erve
aujourd'hui plus communément d'un [erpentin.
Y.
RÉFRIGÉRENT, SERPENTlN ,
&e.
II
y a differentes [ortes d'alambics ; il
Y
en a un
ollle chapiteau
&
le matras en cucurbite {ont deux
pieces feparees ;
&
un auo'e ollle chapiteau efl: joint
hermetiquement
a
la cucurbite,
&e. Yoyez
CUCUR–
BITE, MATRAS,RÉCIPIENT.
(M )
..
Y oye{ Planc"e
[Il.
de Cltimie
,jzg.
l.
un alambic
de ven'e , compo{e d'un matras A
&
d'un chapiteau
B.
Fig.
2.
un alambic de verre, compo[é d'une cu–
curbite A; d'un chapiteau tubnle
B;
C tube du cha–
piteau; D bouchon du tube.
Fig.
3.
un alambic de
métal;
d
la cucurbite;
e
le chapiteau ave
e
ron ré–
frigérent; ¡le récipient.
Figure
4 .
alambics au 'bain–
marie, oll [e font en m&me tems plufieurs cliftilla–
tions;
i
petit [ourneau dé fer ;
l
bain-marie ;
m
ou–
verture par laCfllelle on met de I'eau dans le bain–
marie
a
me{ure qu'elle s'y confume ;
n nn
chapiteaux
des alambics;
o oo
récipiens.
Figure
".
alambic au
bain de Cable ou de cendre;
a
porte du cendrier;
b
porte du foyer;
c
cap[ule de la cucurbite; die [able;
e
chapiteau de l'alambic.
A LA MORT, CHIENS,
(cri de Chafo.)
on parle
ainfi
a
un chien lor{que le cerf eí!: pris.
A L A
N , [.
m.
en
Yencri~,
c'efl: un gros chien de
l'efpece des dogues.
*
ALAN , (
Géog.
)
ville de Perfe dans la province
a'
Alan, dans le Turqueílan.
.. ALAND ,
(Géog.)
i/le de la mer Baltique, entre
la Suede
&
la Finlande.
.. ALANGUER,
(Géog.)
ville de Portugal dans
l'Eí!:ramadure.
ALANIER,
f.
m.
(JurifFrudence. )
dans quelques
anciennes cotitumes eí!: le nom qu'on donnoit
a
des
gens qui formoient
&
élevoient pour la challe des
dogues venus d'E{pagne , qu'on nommoit
alans. (H)
.. ALAQUE, f. f.
Voye{
PLINTHE
ou
ORLET.
*
ALAQUECA, pierre qui [e trouve
a
Balagate
aux Indes, en petits fragmens polis, auxcluels on
attribue la vertu d'arr&ter le [ang , quand ils font ap–
pLiqués extérieurement.
.. ALARBES, c'eft, {elon MarmoI, le nom Cfll'on
donne aux Arabes voleurs établis en Barbarie.
ALARES,
f.
m.
(H'ifl.
ane.)
[elon quelques an–
ciens Auteurs, étoient une efpece de milice chez les
Romains; a¡nfi appellée du mot Latín
ala,
a
cau{e
de leur agilité
&
de leur légereté dans les combats.
Quelques-uns veuIent que c;:'ait été un peuple de
Pannonie: mais d'antres, avec plus d'apparence de
raifon, ne prennent
alaru
CfllC pour un adjeilif ou
une épithete Cfll'on donnoit
a
la Cavalerie , parce
qu;elte é.toit toí'ljours placée am::
deu~
ailes de I'ar–
mee;
r~ifon
pour laquelle on appellOlt un corps de
,aval.ene
ala. VoyezAILE,
CAVALERIE,
&c. (G)
TomeI,
ALB
]'yf¡iféles
ALAIRl>S ,
muJculi ALARES,
en Anato.
mie.
Yoyez
PTERYGOIDE.
ALARGUER, v. n.
terme
de
Marine ,
qui figniñe
s'éloignerd'llIle cote
0111'on craint d'échoiier ou de de–
meurer
affaL.t;
mais il ne figniñe pas
avancer en mer
&
prendre le large en (ortant d'un port.
La c¡'aloupe
s'ejl alarguée dlt llavire. (Z)
ALARME,
f.
f.
ce mot vient de l'Italien
all' arme,
aux armes.
Pojle d'alarme,
efl: une e{pace de terre!n Cflle le
Quartier-Meíl:re général ou Maréchal général des
Logis alIigne
a
un régiment pour y marcher en cas
d'alanne.
Pojle d'alarme
dans une garnifon, efr le líeu 011
c,haque régiment a Ol·dre de venir {e rendre dans eles
occafions ordinaires.
Pieces d'alarmes;
c'efl: ordinairement quelques pie–
ces de canon placées
a
la tete du camp,
&
qui [ont
toí'tjours pr&tes
a
&tr<: tirées au premier commande–
ment , [oit pour donner
l'alarme
aux troupes ou les
rappeller du fourage en cas que l'ennemi fe mette en
devoir d'avancer pour attaCfller I'armée. (
Q)
.. ALASTOR; c'efl:, {elon Claudien, un des
Cflla~
tre chevaux qui tiroient le char de Pluton 10rfCflI'il
enleva Proferpine. Le m&me Poete nous apprend·
"lue les trois autres s'appelloient
Ophmus, .k:t!lOn
&
Dyéleus,
noms qui marCfllent tous quelque chofe de
fombre
&
de funefre. On donne encore le nom d'a–
lajlor
a
certains e{prits Cfl1i ne cherchent Cfll'a nuire.
ALATERNE, [. m. en Latin
alaternltS,
arbrilfeau
dont les f1eurs (ont d'une [eule feuille en forme d'en–
tonnoir,
&
découpées en étoile a cinq pointes. Le
pifl:il qui [ort du fond de ces f1eurs devient dans la
[¡tite un fmit ou une baie molle, remplie ordinai–
rement de trois [emences, qui ont d'un coté une
bolfe,
&
de I'autre des angles. Tournefort,
Infl. rei
herb. f/oye{
PLANTE.
(1)
.. On en fait des haies : on le met en builfon dans
les plates-bandes des parterres. Si on le veut encaif–
[el' , on lui donnera un tie1's de terre
a
pot~er
&
un
tiers de terreau de couche. On emploie [es feuilles
en gargari[me dans les inflammations de la bouche
&
de la gorge.
.. ALATRI ,
(G¿og.)
ancienne ville d'Italie, dans
la campagne de Rome.
Long. 30.
,,8
lato4
l .
44-
.. ALA
V
A
ou
ALABA, (
Géog.)
petite province
d'Efpagne; ViB:oria en eft la capitale.
.. ALAUT
ou
ALT,
(Géog.)
riviere de la Tur–
quie en Enrope; elle {ort des montagnes qui [épa–
rent la Moldavie de la Tran[ylvanie,
&
[e jette dans
le Danube.
A-L'AUTRE,
tmm de Marine;
ce mot efr prononcé
a
haute voix par l'éCfl1Ípage qui efl: de c¡uart, lor[–
Cfll'on [onne la cIoche, pour marCfller le nombre des
horloges du quart;
&
cela fait connoitre Cfll'ils veil–
lent
&
qu'ils entendent bien les coups de la c1oche•
Foye{
QUART.
(Z )
ALBA,
f.
f. (
Comrnerce. )
petite monnoie d'
Alle–
magne, en Franc¡:ois
demi-piece;
elle vaut huit fenins
du pays,
&
le fenin vaut deux deniers; ainfi
l'alba
vaut {eize deniers de France.
Yoye{
DENl ER.
.. ALBADARA, c'efr le nom Cflle les Arabes don–
nent
a
l'os {é{amoide de la premiere phalange du gros
orteil.
II
efl: environ de la groífeur d'un pois. Les Ma–
giciens lui attribuent des propriétés {urprenantes ,
comme d'&tre indefrruB:ible, [oit par I'eau, {oit par
le feu. C'efl: la Cfll'efl: le germe de l'homme que Dieu
doit faire écIorre un jour , c¡uand il lui plaira de le
reíru{citer. Mais laiifons ces contes
a
ceux qui les ai–
ment,
&
venons a deux faits qu'on peut lire plus [é–
rielúement. Une jeune femme étoit fujette
a
de fré–
mlens acd:s d'une maladie convulfive contre laCfllelle
t~us
les remedes avoient échoiié. Elle s'adreíl'a
a
lID
Medecin d'Oxfort Cflli avoit de la réputation ,
&
qui
Hh
ij
















