
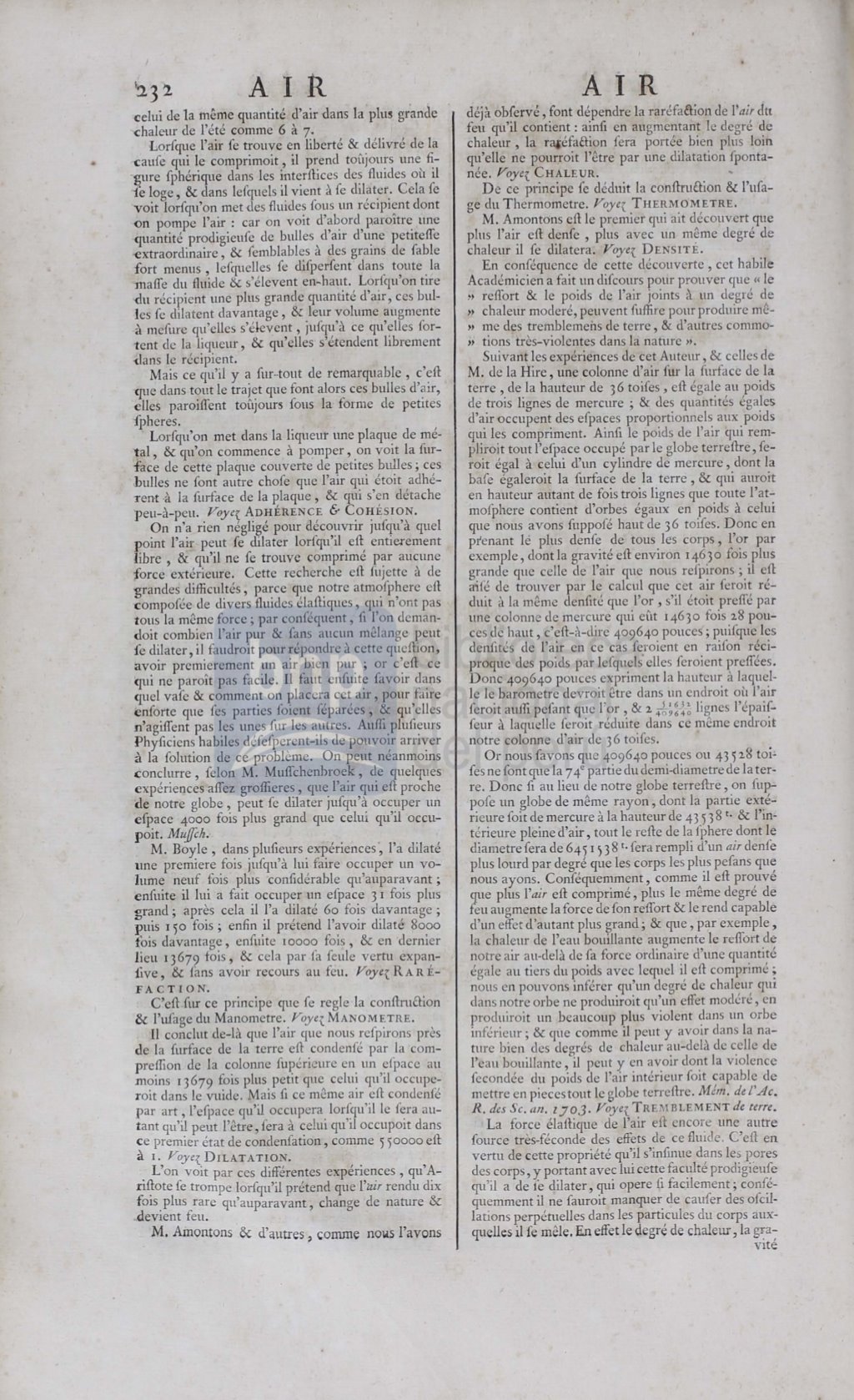
AIR
celui de 1a meme quantité d'air -dans la plu5 grande
chaleur de I'été comme 6 it 7.
Lorfc¡ue l'air fe trouve en liberté
&
délivré de la
cau{e qui le comprimoit, il prend toftjonrs une
fi–
-gure fphérique dans les interilices des fluides
011
il
·Ú!
loge ,
&
dans lefc¡uels
i~
vient
a
fe dil?ter: Cela {e
voit lor{qu'on met <les fhudes {ous un reclplent dont
on pompe l'air : car on voit d'abord paroitre une
quantité prodigieu{e de bulles d'air d
'u.nepetiteiTe
-extraordinaire,
&
{emblables
a
des grams de Cable
fort menus , le{c¡nelles {e di{per{ent dans tonte la
maiTe du flnide
&
s'élevent
en~haut.
Lorfc¡u'on tire
dn récipient une plus grande ql.lantité d'alr, ces bul–
les fe dilatent davantage,
&
lem volume augmente
a
me{me qu'elles s'élevent , ju{qu'a ce qu'elles for–
tent de la liqueur,
&
qu'elles s'étendent librement
~lans
le récipient.
Mais ce qu'il y a {nr-tout de remarquable , c'efl
'que dans tout le trajet que font alors ces bulles d'air,
elles paroiiTent tOlljours {ous la forme de petites
{pheres.
Lorfqn'on met dans la liqueur une plaque de mé–
tal,
&
qu'on commence a pomper, on voit la {ur–
face de cette plaque couverte de petites bulles; ces
.bulles ne {ont autre chofe qlle l'air qui étoit adhé–
Tent
a
la {urface de la plaque,
&
qui s'en détache
peu-a-peu.
Voye{
ADHÉRENCE
&
COHÉSION.
On n'a rien négligé pour découvrir jufqu'a que!
point l'air peut {e dilater lorfqu'il efl entienment
libre,
&
qu'il ne fe trouve comprimé par allcune
force extérieure. Cette recherche efl lujette
a
de
grandes difficultés, parce que notre atmo{phere efl
compo{ée de divers flllides élafliques, qui n'oot pas
tous la meme force; par con{équent, fi I'on deman–
doit combien I'air pnr
&
fans aucun melange peut
fe dilater, il faudroit pour répondre
a
cette queilion,
avoir premierement un air bien pur ; or c'efl ce
qui ne parolt pas facile.
II
fam en{uite favoir dans
quel vafe
&
comment on placera cet air , pour faire
enforte que fes parties {oient féparées,
&
qu'elles
n'agiíTent pas les unes fur les autres. Auffi plufieurs
Phyficiens habiles défefperent-ils de pouvoir arriver
a
la folution de ce probleme. On peut néanmoins
conclurre, felon M. MuiTchenhroek, de quelques
expériences aiTez groffieres, que l'air qui efl proche
de notre globe, peut {e dilater jufqu'a occuper un
ef¡J3Ce 4000 fois plus grand que celui qu'il occu–
poit.
Muffch.
M. Boyle, dans plufieurs expériences, l'a dilaté
une premiere fois ju{qu'a lui faire occuper un vo–
lume neuf fois plus confidérable qu'auparavant;
enfuite il lui a fait occuper nn efpace 31 fois plns
grand; apres cela il l'a dilaté 60 fois davantage;
puis 150 fois; enfin il prétend I'avoir dilaté 8000
fois davantage, enfuite 10000 fois ,
&
en dernier
lien 13679 fois,
&
cela par fa feule vertu expan–
five,
&
fans avoi!' reconrs au feu.
Voye{
RA
RÉ–
FA
CTI ON.
C'efl fUI ce principe que fe regle la conflmilion
&
l'túage du Manometre.
Vtrye{
MANOMETRE.
Il
concha de-la que l'aiI que nous refpirons pres
de la furface de la terre efl conden{é par la com–
preffion de la colonne fupérieure en un efpace au
moins 13679 fois plus petit que celui qu'il occupe–
roit dans le vuide. Mais fi ce meme air efl condenfé
par art, l'ef¡Jace qu'il occnpera lorfqu'ille fera au–
tant qu'il peut l'etre, fera a celui qu'il occupoit dans
ce premier état de conden{ation, comme 550000 efl
a
1.
Voye{DILATATION.
. L'on voit par ces différentes expérienees , qu'A–
Xl~ote
{e trompe lorfc¡u'il prétend C[lle
l'uir
rendu dix
fOls.plus rare C[ll'auparavant, ehange de nattlre
&
devlent feu.
M. Amontons
&
d'antres, conune no
liS
l'avons
AIR
déjit obfervé, font dépendre la raréfaétion de
l'air
dtt
feu C[ll'il eontient: ainfi en augmentant le degré de
chaleur, la ra¡éfaétion fera portée bien plus loin
qu'elle ne pourroit l'etre par une dilatation (ponta–
née.
Voye{
CHALEUR.
D e ce principe fe dédlút la eonfuuilion
&
l'ufa–
ge du Thermometre.
Voye{
THERMOMETRE.
M. Amontons eflle premier qui ait découvert que
plus l'air efl denfe , plus avee un
m~me
degré de
ehaleur
i1
fe dilatera.
Voye{
DENSITÉ.
En con{éC[llence de eette découverte , cet habile
Académieien a fait un di{cours pour prouver que" le
" reiTort
&
le poids de I'air joints a un degré de
»
chaleur moderé, peuvent fuffire pOllT produire m&–
»
me des tremblemeos de terre,
&
d'autres commo–
»
tions tres-violentes dans la nattlre
».
5uivant les expériences de cet Auteur ,
&
eelles de
M. de la Hire, une eolonne d'air fur la fllrface de la
terre, de la hauteur de
36
toi{es, efl: égale au poids
de trois lignes de mercure ;
&
des C[llantités égales
d'air oceupent des efpaees proportionnels aux poids
qui les eompriment. Ainfi le poids de l'air qui rem–
pliroit tout l'e(pace oecupé par le globe terrefue, fe–
roit égal a eelui d'un cylindre de mercure, dont la
bafe égaleroit la furface de la terre,
&
qui auroit
en hauteur autant de fois trois lignes C[lle tollte I'at–
mo{phere eontient d'orbes égaux en poids a eelui
C[lle nous avons {uppo{é haut de
36
tolles. Done en
p¡'enant le plus den{e de tous les corps, I'or par
exemple, dontla gravité efl environ 14630 fois plus
grande que eelle de I'air C[lle nous refpirons ;
i1
dI:
aifé de trouver par le calcul C[lle cet air feroit ré–
duit
a
la meme denfité que l'or , s'il étoit preífé par
une colonne de merCllTe qui ellt 14630 fois 28 pou–
ces de haut, e'efl:-a-dire 409640 pouces; puifC[lle les
denfités de l'air en ce eas feroient en raifon réci–
proque des poids par le{C[llels'elles feroient preiTées.
Donc 409640 pouces expriment la hauteur a laquel–
le le barometre devroit etre dans un endroit
011
l'air
feroit auffi pefant C[lle
1'01' ,
&
2
.;i;}!ci
lignes l'épaif–
feur a laquelle feroit réduite dans ce meme endroit
notre colonne d'air de
36
toifes.
Or nous favons que 409640 pOllees ou 43528 toi–
fesne font C[lle la 74
e
partie du demi-diametre de la ter–
re. Done
ti
aulieu de notre globe terrefl:re, on {up–
pofe un globe de meme rayon, dont la partie exté–
rieure foit de mercure a la hauteur de 43
538
t.
&
I'in–
térieure pleine d'air, tout le refle de la{phere dont le
diametre {era de 645
I
~
38
t.
{era rempli d'un
air
denle
plus lourd par degré que les corps les plus pefans C[lle
nous ayons. Con{éC[llemment, comme ji efl: prouvé
C[lle plus
l'air
efl: comprimé, plus le meme degré de
feu augmente la force de fon rciTort
&
le rend capable
d'un effet d'autant plus grand;
&
que, par exemple,
la ehaleur de l'eau bouillante augmente le reiTort de
notre air au-dela de fa force ordinaire d'une C[llantité
égale au tiers du poids avec leC[llel il efl: eomprimé ;
nous en pouvons inférer qu'un degré de chaleur qui
dans notre orbe ne produiroit qu'un effet modéré, en
produiroit un beaucoup plus violent dnns un orbe
inférjeur;
&
que comme jI peut y avoir dans la na–
ttlre bien des degrés de chaleur au-dela de celle de
l'eau bouillante, il peut y en avoir dont la violence
feeondée du poids de l'air intérieur {oit capable de
mettre en pieeestout le globe terreflre.
Mém. del'Ae.
R. des Se.
ano
1:703. Voye{
TRE !BLEMENT
de terreo
La force élaflique de I'air efl: encore une autre
fource tres-féconde des effets de ce fllllde C'eft en
vertn de cette propriété qu'il s'infinlle dans les pores
des eorps, y portant avec lui cene faculté prodigieufe
qu'il a de
Ji!
dilater, C[lli opere
ti
facilement ; eonfé–
C[llemment il ne {auroit manC[ller de cau{er des o{cil–
latlOns perpétuelles dans
les
partieules du eorps aux–
C[llelles il fe mele.
En
effet le degré de ehaleUT, la gra-
vité
















