
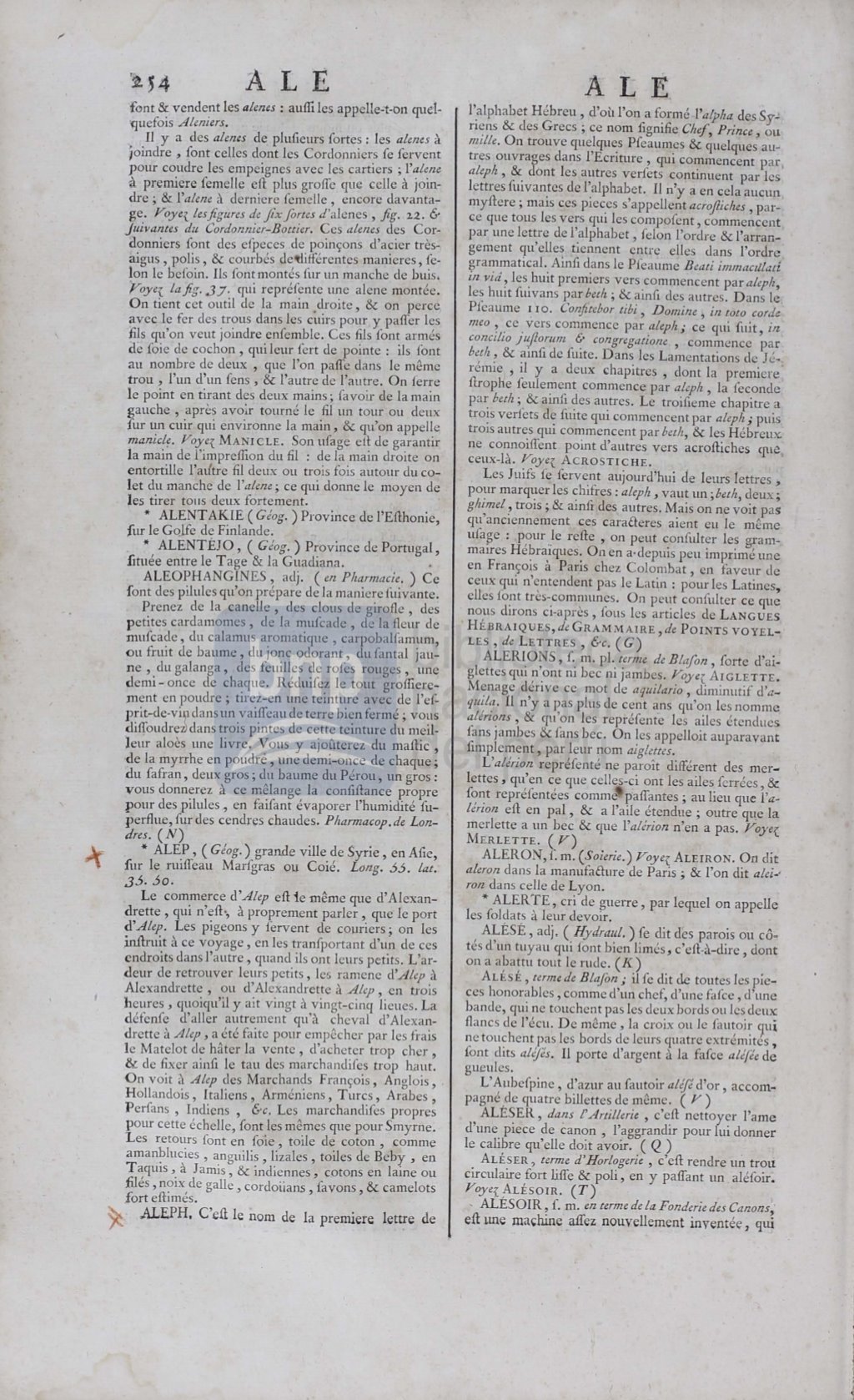
ALE.
font
&
vendent les
olenes
:
auíIi les appelle-t-on quel–
'f:juefois
Aleniers.
Il
y a des
alenes
de pluíieurs [ortes ; les
alenes
a
]oindre , [ont celles dont les Cordonniers [e [ervent
pour coudre les empeignes avec les cartiers ;
l'~l~ne
a
prerniere [emelle ell plus gro{fe que ceHe a )om–
dre;
&
I'olene
a derniere [emelle, encore davanta–
ge.
Voye{ lesjigures deJix forles
d'alenes ,
jig.
22.
&
Juivantes du Cordontzier-Bouier.
Ces
alenes
des Cor–
donniers [ont des efpeces de poin<;ons d'acier tres-
aigus, polis ,
&
courbés
d~~ifférentes
manieres,
!e–
Ion le befoin. lis [ontmontes fur un manche de blllS.
roye{ lajig.
.].7.
qui
repré[~nte
ur:e alene montée.
On tient cet outil de la mam drolte,
&
on perce
avec le fer des trous dans les citirs pour y pa{fer les
JiIs qu'on veut joindre .enfemble. Ces
~s [on~
armés
de [oie de cochon , qm leur fert de pOl11te: ils font
au nombre de deux , que I'on pa{fe dans le meme
trou> I'un d'un fens,
&
l'autre de I'mltre. On íerre
le point en tirant des deux mains; fa voir de la main
gauche , apres avoir tourné le ñl un tour ou deux
fur un cuir qui environne la main,
&
c¡u'on
appel~e
manicl~.
Voye{
MANICLE. Son ufage
el~
de
g~antlr
la main de I'impreffion du ñl : de la mam drolte on
entortille l'adtre fil deux ou trois fois autour du co–
let du manche de
I'alene;
ce c¡ui donne le moyen de
les tirer tOIlS deux fortement.
*
ALENTAKIE
e
Géog.
)
Province de I'Efrhonie,
;fur le GoJfe de Finlande.
*
ALENTÉJO,
e
Géog.
)
Province de Portugal,
fituée entre le Tage
&
la Guadiana.
.
ALEOPHANGINES, adj.
e
en P"armacie.
)
Ce
font des pilules qu'on prépare de la maniere fuivante.
Prenez de la canelle, des clous de girofle, des
petites cardamomes, de la mufcade , de la fleur de
mu[cade, du calamus aromatic¡ue , carpobalfamum,
Olt
frnit de baume, du jonc odorant, du fantal jau–
ne , du galanga, des feuilles de rofes rouges, une
cemi - once de chaque. Réduifez le tout groffiere–
ment en poudre; tirez-en une teinture avec de l'ef–
prit-de-villdansun
.va~eau
de terre
bi~n
fermé;
VO~IS
¿i{foudre¡)dans trOIS pllltes de cette telllture du mell–
leur aloes une livre. Vous y ajollterez du ma!l:ic ,
de la rnyrrhe en poudre , une demi-once de chaque;
du fafran, deux gros; du baume du Pérou, un gros:
vous donnerez a ce melange la confi1l:ance propre
pour des pilules , en fai[am évaporer l'humidité fu–
Í)erflue,fur des cendres chaudes.
P
/zamzacop.deLon–
dres.
eN)
*
ALEP,
(Gtog.)
grande ville de Syrie, en Afie,
fur le rui{feau Mar[gras ou Coié.
LOIlg.
.5.5.
lato
.].5. .50.
Le commerce
d'Alep
e!l:ie meme que d'Alexan–
drette, c¡ui n'e!l:·, a proprement parler, que le port
d'Alep.
Les pigeons y [ervent de couriers; on les
in1l:ruit
a
ce voyage , en les tranfportant d'un de ces
endroits dans l'autre , quand ils ont leurs petits. L'ar–
deur de retrouver leurs petits, les ramene d'
Alep
a
A1exandrette, ou d'A.lexandrette a
Alep,
en trois
heures> quoiqu'il y ait vingt a vingt-cinc¡ lieues. La
défenfe d'aller autrement qu'a cheval d'Alexan–
crette
a
Alep
,
a été faite ponr empecher par les frais
le Matelot de hater la vente, d'acheter trop chef,
&
de fixer ainfi le tau des marchandifes trop hant.
On voit a
Alep
des Marchands Fran<;ois, Anglois,
Hollandois ltaliens, Arméniens, Turcs, Arabes ,
Perfans ,
I~diens,
&c.
Les marchandifes proprcs
pour cette écheHe, fom les memes que pour Smyrne.
Les retottrs font en foie, toile de coton, cornme
ama~lucies
, anguilis , lizales , toiles de
Beby
,
en
Taqllls, a Jamis ,
&
indiennes, cotons en lame ou
filés ,noix de galle , cordoiians , favons ,
&
camelots
iort e!l:imés.
;<-
ALEPH.
C'efr
le nom de la premiere lettre de
A L É
I'alphabet Hébreu, d'oll l'on a formé
l'aplla
d€s
Sy–
riens
&
des Grecs ; ce nom [¡gniñe
Chef, Prince,
ou
mi!le.
On trouve quelques P[eaumes
&
quelques au–
tl'es ouvrages dans l'Ecriture, qui commencent par
alep/l,
&
dont les autres verfets continuent par les
lettres fuivantes de l'alphabet. Il n'y a en cela aucun
my!l:ere; mais ces píeces s'appellent
acroJliclles
,
par–
ee que tous les vers c¡ui les compo[ent, commencent
par une lettre de l'alphabet , felon l'ordre
&
l'arran–
gement qu'elles tiennent entre elles dans l'ordre
grammatical. Ainfi dans le P[eaume
Beati immacúlaLÍ
in vid,
les huit premiers vers commencent par
aleplz,
les huit fuivans par
bet"
;
&
ainfi des autres. Dans le
P[eaume 110.
Confitebor tibi, Domine, in tOLO corde
meo,
ce vers commence par
aleplz;
ce c¡ui [uit,
in
concilio jujlofltm
&
congregaLÍone
,
commence par
ba",
&
all1fi de [uite. Dans les Lamentations de Jé–
rémje , il
Y
a deux chapitres , dont la premiere
fuophe feulement commence par
aleplz,
la feconde
par
betlz;
&
ainfi des autrcs. Le troifieme chapiu'e a
trois verfets de fuite qni commencent par
aleplz;
puis
trois alltres qui commencent par
bez",
&
les Hébrellx
ne connoi{fenr point d'autres vers acro!l:iches que
cel1x-la.
Voye{
ACROSTI CHE.
Les Juifs [e [ervent aujourd'hui de leurs lettres,
pour marquer les chifres :
alep"
,
vaut un;
betlz,
deux;
glzimel,
trois;
&
ainfi des autres. Mais on ne voit pas
c¡u'anciennement ces caraél:eres aient eu le
m~me
llfage : pour le relle , on pcut conflllter les gral11-
maires Hébralques. On en a·depuis pell imprimé une
en Fran<;ois 11 Paris chez Colombat, en faveur de
ceux qui n'entendent pas le Latín; pour les Latines,
elles font tres-communes. On peut confulter ce que
nous dirons ci-apres, [ous les articles de LANGUES
HÉBRAIQUES,
de
GRAMMAIRE,
de
POINTS VOYEL–
LES,
de
LETTRES ,
&c.
(G)
ALERIONS, [. m. pI.
lerme de Blafon
,
[orte d'ai–
glettes (lui n'ont
ni
bec
ni
jambes.
Voye{
AIGLETTE.
Menage dérive ce mot de
aquilario,
dinúnutif
d'a–
quila.
H
n'y a pas plus de cent ans qu'on les nomme
atérions,
&
qu'on les repréfente les ailes étendues
fans jambes
&
fans beco On les appeIloit auparavant
úmplement, par leur nom
aigletus.
L'aUrion
repréfenté ne parolt di/férent des mer–
lettes , qu'en ce que celles-ci om les ailes [errées,
&
font repréCentées comme pa{fantes; aulieu quc I'a–
Urion
e!l: en pal,
&
a l'aile étendue ; outre qqe la
merlette a un bec
&
que
l'alérion
n'en a pas.
Voye{
MERLETTE.
e
V)
ALERO ,( m.
e
Soierie.) Voye{
ALEIRON. On dit
aleron
dans la manufaél:l11'e de Paás ;
&
1'0n dit
alei-'
ron
dans ceHe de Lyon.
*
ALERTE, cri de guerre, par lequel on appelle
res foldats
a
leur devoir.
ALÉSÉ, adj. (
Hydrttul.
)
fe dit des parois ou
ca–
tés d'ul1 tuyau qui font bien limés, c'e!l:-a-dire, dont
on a abattu tout le nlde.
e
K)
ALÉSÉ,
termede Blafon;
il fe dit
ele
toutes les pÍe–
ces honorables, comme d'un chef, d'une fafce , d'une
bande, qui ne touchem pas les deux bords oules delLX
flancs de l'écu. De meme, la croix Ol! le fautoir 9ui
ne touchent pas les bords de leurs quatre extrémites ,
[ont dits
aléfls.
Il porte cl'argent
a
la fafce
aUfte
de
gueules.
L'Aubefpine , d'azur au fautoir
aléfl
d'or , accom–
pagné ,de quatre billettes de meme.
e
Y)
ALESER,
dans
f
Artillerie
,
c'e!l: nettoyer l'ame
cl'une piece de canon, l'aggrandir pOLU luí donner
le calibre qu'elle doit avoir.
e
Q
)
.
ALÉSER,
lerme d'Horlogerie
,
c'e!l: renclre un trou
circulaire fon }j{fe
&
poli, en y pa{fant un aléfoir.
Yoyet ;'\LÉSOIR.
eT)
, ALESOIR, [. m.
en ltrme de la Fonderie des Canoas;
efr lme
ma,lúne aifez nouvellement inventée , qui
















