
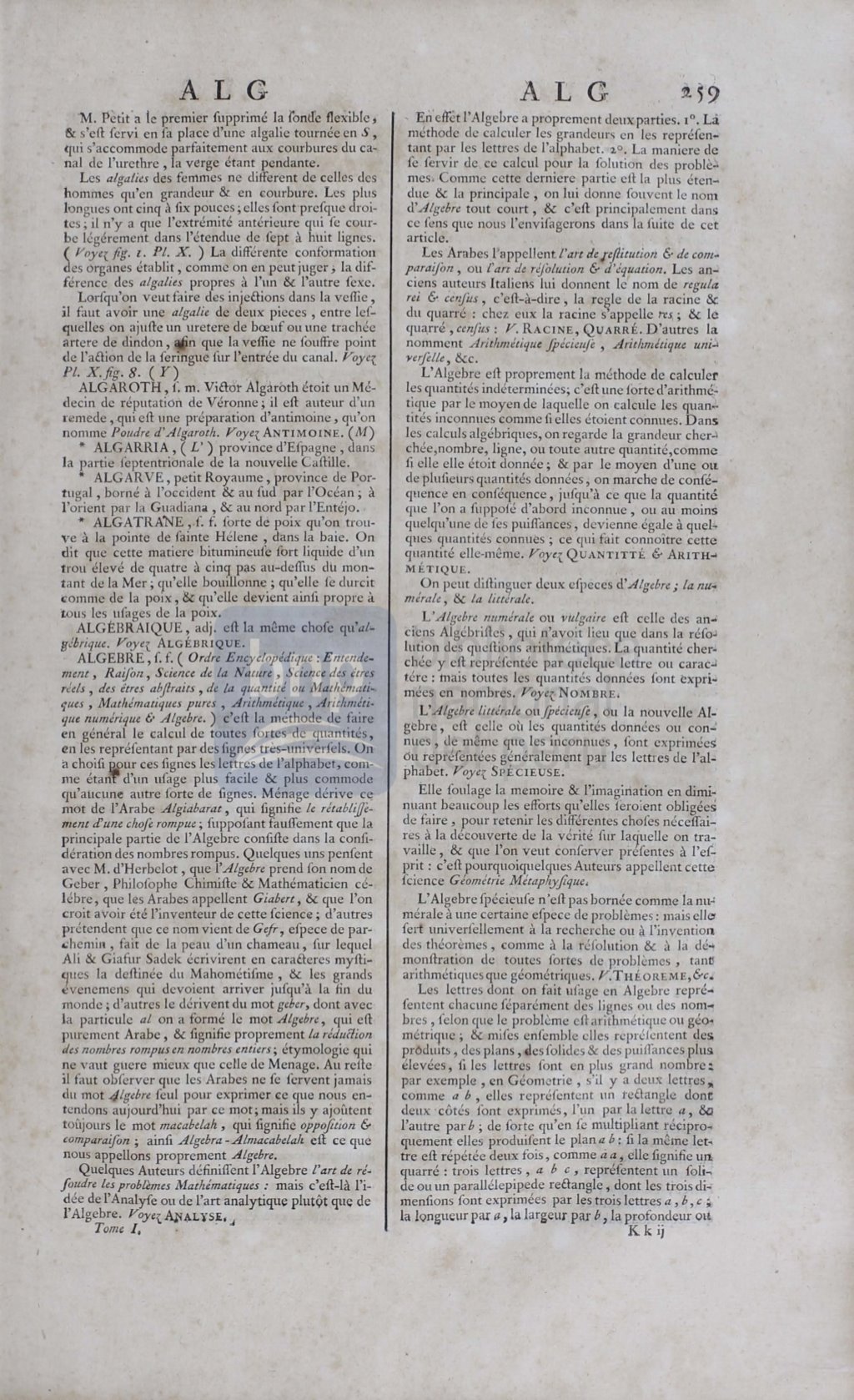
ALG
'M.
Fetit'a le premier fupprimé la Contl'e flexible,
&
s'ca
fervi en (a place d'une algalie toumée en
S,
<lui s'aceommode parfaitement aux courhures du ca–
nal de I'urethre , la verge étant pendante.
Les
algalies
des femmes ne dilferent de ceUes des
hommes qu'en grandeuT
&
en courbure. Les plus
longues ont cinq
a
lix pouces; eUes font pTe(que clroi–
tes; iln'y a que l'extrémité antérieure qui (e com–
be légérement dans l'étendue de [ept
a
huit lignes.
( f/oye{
jig.
l.
PL. X.
)
La dilférente conformation
des organes établit , commc on en peut juger; la dif–
férence des
algaLies
propres
a
1'un
&
l'autre fexe.
L()J{qu'on veut faire des injefrions dans la velTie,
il faut avoir une
aLgaLie
de deux pieces , entre leC–
quelles on ajuae un uretere de brel1f ou une trachée
:\rtere de dindon ,
~in
que la veRie ne Coulfre point
<le l'afrion de la feringue Cur I'entrée du canal.
VoyC{
PL.
X.fig.
8.
(Y)
ALGAROTH, [. m. Vifrot Algároth étoit un Mé–
<lecin de réputation de Véronne
¡
il eíl: auteur d'un
remede ,qui
ea
une préparation d'antimoine, qu'on
nomme
Poudre d'ALgarot".
Voye{ANTIMoINE.
CM)
.. ALGARRIA, (
L')
province d'ECpagne , dans
la partie fcptentrionale de la nouvelle Caíl:ille.
.. ALGARVE, petit Royaume, province de Por–
tugal , bomé
iI
I'occidant
&
au {ud par l'Océan;
a
l'orient par la Guadiana ,
&
au nord par l'Entéjo.
.. ALGATRANE, f. f. forte de poix qtl'on trou–
ve iI la pointo de [ainte Hélene , dans la baie. On
dit que cetre matiere bitumineufe
Cort
liquide d'l1n
trou élevé de quatre
a
cinq pas au-delfus dlt mon–
tant de la Mer ; c¡u'elle bouillollne ; qu'elle
le
durcit
C10mme de la pOlX,
&;
qu'eUe devient ainli propre
a
-tous les llCages de la poix.
ALGÉBRAIQUE, adj. ellla meme chofe qu'al"
gJbrique_ Voye{
ALGÉBRIQUE.
ALGEBRE, f. f. (
Ordre Encyclopédiqlle
:
Entende–
mem, RaiJon, Science de la Namre, Science des étres
rdds
,
des itres abjlraits
,
de
La
quantité ou Matt.émati.
'lues
,
Matldmatiques pllres
,
Aritltmüiqlle
,
Arithméti.
que nllmérique
(/
Algebre.)
c'ell la méthode de faire
en général le caleul de toutes (ortes de quantités,
en les repréCentant par des lignes tres-univerfels. On
a choiíi gpur ces íignes les lettres de I'alphabet, com–
me étanr d'un u(age plus facile
&
plus commode
qu'aucune autre {orte de íignes. Ménage dérive ce
mot de l'Arabe
ALgiabarat,
qui
íi~nifie
Le
rétabLiffe–
meru d'une
cluife
rompue;
(uppo(ant faulfement que la
principale partie de l'Algebre coníiile dans la conft–
déracion des nombres rompus. QlIelques uns penCent
avec M. d'Herbelot, que
l'Algebre
prend (on nom de
Geber , PhiloCophe Chimiile
&
Mathématicien eé–
lébre, que les Arabes appellent
Giabert,
&
que I'on
croit avoir été I'inventeur de cette Ccience; d'autres
prétendent que ce nom vient de
Gefr,
efpece de par–
o;;hemin , fair de la peau d'un chameau, fUT lequel
Ali
&
Giahlr Sadek écrivirent en carafreres mylli–
~ues
la dellinée du MahométiCme,
&
les grands
evenemens qui devoient arriver juCqu'a la fin du
monde; d'autres le dérivent du mot
geber,
dont avec
la particule
al
on a formé le mot
ALgebre,
qui ea
)mrement Arabe,
&
íignifie proprement
la rJduc1ion
des nombres rompus en nombres entiers;
étymologie Glui
ne vaut guere mieux que celle ue Menage. Au refie
il faut ob(erver que les Arabes ne Ce fervent jamais
du mot
4lgebre
(eul pour exprimer IZe que nous
en~
tendons aujourd'hui par ce mot; mais ils y ajotltent
tOlljours le mot
macabelah,
qui íignifie
opprifiúon
&
comparaifon;
ainíi
A 1gebra
-
Almacabelah
ell ce clue
nous appellons proprement
ALgebre.
Quelques AlIteurs définiiI'ent l'Algebre
L'art de
ré–
fOlu/re
les
probllmes Mathématiqlles:
mais c'eíl:-liI l'i–
dée de l'Analyfe ou de I'art analytique plutQt que de
l'
Algebre.
Voye{
~~L
YS!i•
.J
Tome
l.
ALG
, Eñ'eff"ét l'Algehre a proprement deuxparties.
l°.
La
méthode de calculer les
grandeur~
en les repréCen–
tant par le lettres de I'alphabet.
2°.
La maniere de
fe (ervir de ce calcul pour la (olution des proble–
mes. Comme cette derniere partie ellla plus éten–
due
&
la principale , 011 lui donne fouvent le n0111
d'Algebre
tout comt,
&
c'eíl: principalement dans
ce fens que nous l'enviCagerons dans la fuite de cet
anide.
Les Arabes l'appellentL'art
de ¡if!iwtion
6·
de com–
paraiJon ,
ou
tare de nljollllion
&
d'.!quation.
Les an–
ciens auteurs ltalieos lui donnent le nom de
regula
reí
&
CUlfllS,
c'ell-a-dire, la re§le de la racine
&
du quarré :
chez
eux la racine s appelle
res,;
&
le
qua.rré,
myils: V.
RACINE, QUARRÉ. D'autres la
nommellt
AritlwlIüique fp¿cielye, Arithmétique llni..l
""foLLe,
&c.
.
L'Algebre ell proprement
1"
méthode de ca1culer
les ([uantité indéterminées; c'ell une {orte d'arithmé–
tique par le moyen de laquclle on calcule les quan–
tités inconnues COl1lme
Ii
elles étoient connues. Dans
les calculs algébriques, on Tegarde la grandeur eher–
ehée,nombre, ligne, ou toute autre quantité,comme
íi
elle elle étoit donnée;
&
par le moyen el'une
Olt
de pluíieurs
q~lantités
données, on marche de confé–
qllence en con(équence, ju(qu'i1 ce que la cJuantité
que I'on a Cuppolé d'abord inconnue, ou au moins
quelqu'une de (es plúlfances, devienne égale
a
quel–
ques quantités connu1!S; ce qui fair connoltre cette
quantité elle·meme.
Vaye{
QUANTITTÉ
&
AIUTH..¡
MÉTlQUE.
On peut dillil1
9
uer deux eCpcces
d'Algebre; La nu.
nzéraLe,
&
La ¡¡&Cerale.
L'ALgebre Ilttl/lJrale
ou
vulgaire
eíl: celle eles an–
ciens Algébriíles , qüi n'avoit lieu que dans la ré(oJ
lution des queilions arithmétiqucs_La quahtité cher–
chée y ell repréCentée par quelque lettre ou caracol
tére : mais toutes les quantités données font 1!xpri·
mées en nombres.
Voye{
NOMBRE.
L'Algebre liuéraLe oufpécieufl,
011 la nOllvelle
Al–
gebre, ell celle 011 les quantités données ou con–
nues, de meme que les inconnues, (ont cxprimées
ou repré(entées généralement par les lettres de I'al–
phabct_
Voye{
$rÉcIEusE.
Elle Coulage la memoire
&
I'imagination en dimi–
nuant beaucoup les efiorts qu'elles íeroient obligées
de faire, pour retenir les dilférentes chofes néce{[ai–
res
a
la découverte de la vérité [¡Ir laquelle on
tra~
vaille,
&
clue l'on veut con(erver préCentcs
a
l'e[–
prit: c'eíl:'pourquoiquelCfuesAuteurs appellent cette
fcicnce
G~ométrie
Métaplryjiqlle.
L'Algebre (pécieu(e n'ell pas bornée comme la nu.
mérale
a
une certaine e(pece de problemes: mais ellCl
fe11 lIniver(ellement á la recherche ou
a
I'invention
des théonl mes, comme
a
la réfolHtion
&
iI la dé..
moníl:ration de tolltes (011es de problemos, t3nU
arithmétiC¡lIesque géométriques. V.THÉOREME,&C_
Les lemes dont on fait uCage en Algebrc
rcpré~
fentent chacune féparément des lignes OH des 110m..
bres, [elon que le probleme ellarlthmétique ou géo.
métri~ue;
&
mifes enCemble elles repréJcl1tent des;
prOdU1t~
, des plans, desfolides
&
des pui{[ances plus
élevées,
ii
les lettres Cont en plus grand nombre!
par exemple , en Géomctrie , s'il y a deult lettres,.
comme
a
b
,
elles repréfcntent \In j-efrangle done
deux cotés (ont exprimés, 1'1In par la lettre
a,
&¡
I'autre par
b
;
de forte qu'en Ce multipüant récipro.,
'1uement
elle~
prodlúCent le plan
a
¡, :
íi la
m~mc
ler.
tre eíl: répétée deux fois, comme
ti
a,
elle úgnifie un,
Cjllarré : trois lettres,
a
b
a,
repréCentent un
(oli~
de ou un parallélepipede refrangle, dont les troi
di.
meníions (ont exprill1ées par les trois lettres
a,
b,
e
~
la lQngllellr par
a,
la largeur par
¡"
la profondcm-Olt
Kkij
















