
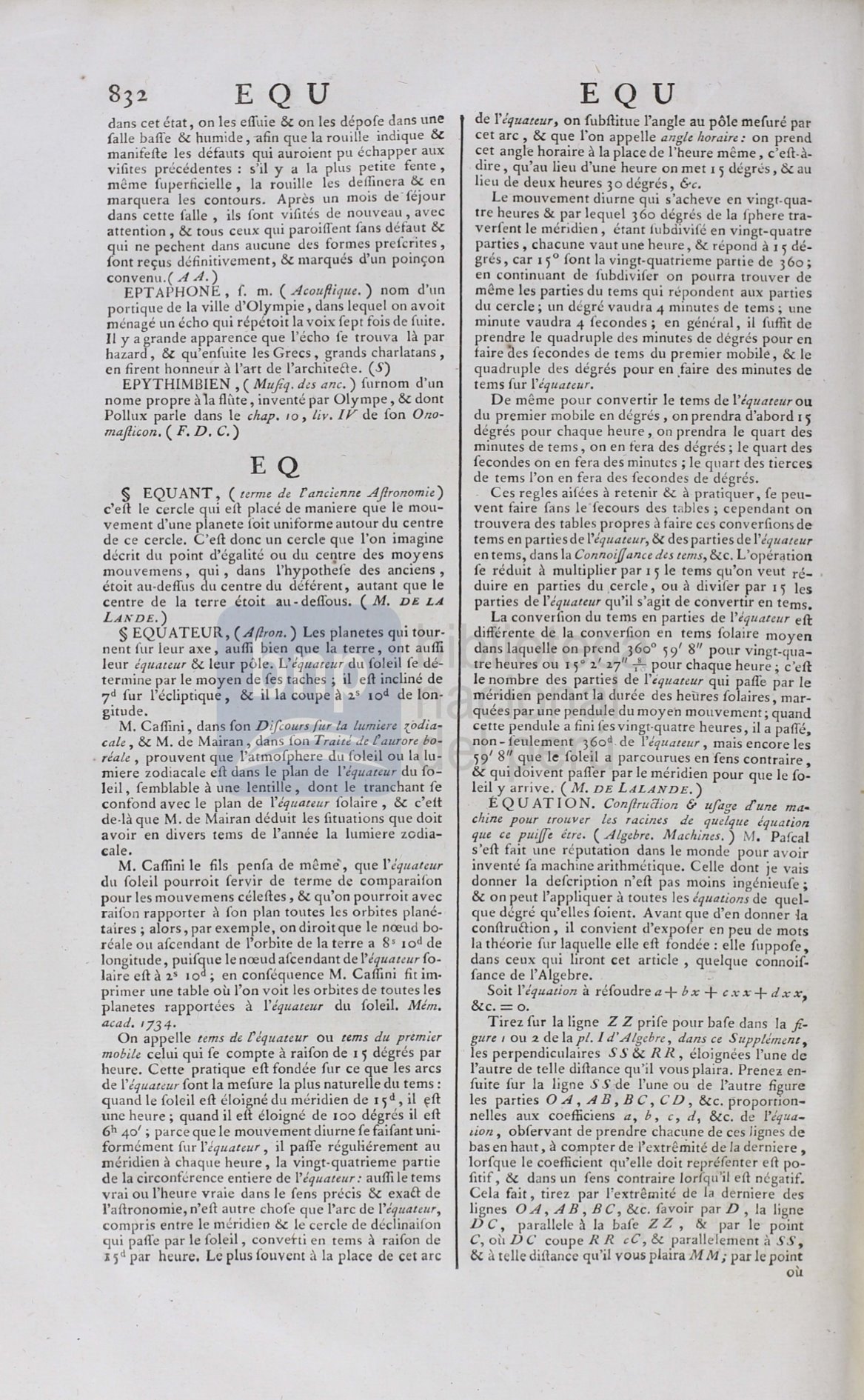
EQU
daos cet état, on les eífuie
&
on les dépofe daos une
falle baífe
&
humide, -afio que la rouille indique
&
rnanifefte les défauts qui auroient pu
éch~pper
aux
viíites précédentes : s'il y a la plus peute fente ,
rneme fuperficielle' la rouille les deqinera
~
en
marquera les contours. Apres un mo1s de · feJour
daos cette falle ils font viíités de nouveau, avec
attention,
&
to~s
ceux qui paroiífent fans
défa~1t
&
qui ne pechent dans aucune des formes
prefc~ttes,
{ont res;us définitivement,
&
marqués d'un pom<;on
convenu.(
A A.)
EPTAPHONE , f. m.
e
Acouflique.
)
nom d'un
portiq~e
de, la ville.
d'~lyn~pie, d~ns
leque.l on av.oit
ménage un echo qm repetolt la vo1x fept fots de fmre.
11
y a grande apparence que l'écho fe trouva
1<\
par
hazard,
&
qu'enfuite les Grecs, grands charlatans,
en firent honneur
a
"l'an
d~
l'architeéte.
e
S)
EPYTHIMBIEN, (
Mujiq. des anc.)
furnom d'un
nome propre
a
1a fl[He, inventé par Olympe,
&
dont
Pollux parle dans le
chap.
10,
Liv. IV
de fon
Ono-
majliéon.
e
F. D. C.)
.
EQ
§
EQUANT,
e
terme de l'ancienne Ajlronomie)
c'efi le cercle qui efi placé de maniere que le mou–
vement d'une planete foit uniforme autour du centre
de ce cercle. C'eft done un cercle que l'on imagine
décrit du point d'égalité ou du centre des moyens
mouvemens, qui, dans l'hypothefe des anciens,
étoit au·deffus du centre du déférent, autant que le
centre de la terre étoit au- de.ífous;
e
M.
DE LÁ
LANDE.)
§
EQUATEUR,
(Aflron.)
Les planetes qui tour–
nent fur leur axe, auffi bien que la terre, ont auffi
le
u
r
équateur
&
leur póle. L'
équateur
du foleil fe dé–
termine par le moyen de fes taches ; il eft incliné de
7d
fur l'écliptique'
&
illa coupe
a
2
5
IOcl
de Ion·
gitude.
M.
Caffini, dans fon
Difcours fur La lumure {odia–
cale,
&
M.
de
M
airan, dans fon
Traité de
t'
aurore ho–
réale,
prouvent que l'atmofphere du foleil ou la lu–
miere zodiacale eft dans le plan de
l'équateur
du fo–
leil' femblable
a
une lenrille' dont le tranchant fe
confond avec le plan de
l'équateur
folaire,
&
c'eit
de-la que
M.
de Mairan déduit les fttuations que doit
avoir en divers tems de l'année la lumiere zodia–
cale.
M.
Caffini le fils penfa de m eme, que
1'
équateur
du
foleil pourroit fervir de terme de comparaifon
pour les mouvemens célefies,
&
qu'on pourroit avec
raifon rapporter
a
fon plan toutes les orbites plané–
taires; alors, par exemple, on diroitque le nreud bo–
xéale on afcendant de l'orbite de la terrea
8s
1od
de
~
longitude, puifque le nreud afcendant de
l'équateur
fo–
laire efi
a
2s 1
od ;
en conféquence
M.
Caíiini fir im·
primer une table
Oti
l'on voit les orbites de toutes les
planetes rapportées
a
l'équateur
du foleil.
Mém.
acad.
1734·
On appelle
tems de l'équateur
ou
tems du premier
mohile
celui qui fe compte
a
raifon de
1
5 dégrés par
heure. Cette pratique eft fondée fur ce que les ares
de
l'équaaur
font la mefure la plus naturelle du tems:
quand le foleil efi éloigné du méridien de
1
5
d,
il
~fi
une heure; quand il efi éloigné de
100
dégrés il eft
6h
40
1
;
paree que le mouvement diurne fe faifant uni–
formément fur
l'équateur,
il palfe réguliérement au
méridien
a
chaque heure' la vingt-quatrieme partie
de la circonférence entiere de
1'
équateur:
auffi le tems
vrai ou l'heure vraie dans le fens précis
&
exaét de
l'afironomie, n'eft autre chofe que l'arc de
l'équateur,
compris entre le méridieo
&
le cercle de déclinaifon
qui paífe par le
fo~eil'
convehi en tems
a
raifon de
I
~d
par heure. Le plus fouvent
a
la place de cet are
EQU
de
l'équateur,
on fubfiitue l'angle au pote mefuré par
cet are,
&
que l'on appelle
angle horaire:
on prend
C~t
angle horaire
a
la place de l'heure meme, c'eft-a–
~lre,
qu'au líe
u
d'une heure on rnet
1
5
dégr 's,
&
a
u
he
u
de deux heures
30
dégrés,
&c.
Le mouvement diurne qui s'acheve en vingt-qua–
tre he ures
&
par lequel 36o dégrés de la fphere tra–
ver~ent
le méridien, étant fubdivifé en vingt-quatre
partleS, chacune vaut une heure,
&
répond
a
I
5
dé–
grés, car
15°
font la vingt-quatrieme partie de
3
6o;
en continuant de fubdivifer on pourra trouver de
meme les parties du tems qui répondent aux parties
du
cercle; un dégré vaudra
4
minutes de tems; une
minute vaudra
4
fecondes; en général, il fuffit de
prendre le quadruple des minutes de dégrés pour en
faire aes fecondes de tems du premier mobile'
&
le
quadruple des dégrés pour en .faire des minutes de
tems fur
l'équateur.
·
De meme pour convertir le tems de
l'lquateurou
du premier mobile en dégrés, on prendra d'abord
1
5
dégrés pour chaque heure, on prendra le quart des
minutes de tems, on en fera des dégrés; le quart des
fecondes on en fera des minutes; le quart des tierces
de tems l'on en fera des fecondes de d ' grés.
Ces regles aifées
a
retenir
&
a
pratiquer, fe peu–
vent faire
fa.nsle fecours des tables; cependant on
trouvera des tables propres
a
faire ces converfions de
tems en parriesde
l'équateur,
&
des partí es de
l'équateur
en tems, dans
la
Connoiflance des tems,
&c. L'opérqtion
fe réduit
a
multiplier par
l
5
le tems qu'on veut ré–
duire en partÍeS du .cercle,
OU
a
divifer par
I
5
les
parties de
1'
équateur
qu'il s'agit de convertir en tems.
La convedion du
tems
en parties de
l'équateur
eft
différente de la converfion en tems folaire moyen
dans laquelle on pr nd
3
6o
0
59' 8" pour vingt-qua–
tre heures ou
I
5o
2'.
27
11
1
8
0
,~our
chaqúe heure; c'eft
le
~?n:bre
des parues d;
1
equateur
qui
p~ffe
par le
mend1en pendant
la
duree des heures fola1res mar–
quées par une pendule du moyen mouvement; quand
cette pendule a fini fes vingt·quatre heures, il a palfé
non- feulement
3
6od . de
l'équateur,
mais encore
le~
59' 8"
que le foleil a parcourues en fens contraire
&
qui doivent paffer par le méridien pour que le fo:
leil
y
arríve.
e
M.
DE L.tJLANDE.)
E
Q
U
AT ION.
ConjlruBion
&
ufage d'une ma–
ehine pour trouver les racines de quelque équation
q:te ce
fUiJ!t
ét;e.
(
4lgebre. Machines.)
M.
Pafcal
s
eft fan une reputat10n dans le monde pour avoir
inventé fa machine arithmétique. Ceile dont je vais
donner la defcription n'eft pas moins ingénieufe;
&
on peut l'appliquer
a
toutes les
équations
de quel–
que dégré qu'elles foient. Avant que d'en donner
~a
confiruétion, il convient d'expofer en peu de mots
la théorie fur .la9uelle elle eft: fondée : elle fuppofe
~
daos ceux qm hront cet art1cle , quelque connoif-
fance de
1'
Algebre.
•
Soit
1'
équation
a
réfoudre
a+ h
X
+
e X X+ d X
x,
&c.=o.
Tirez fur la ligne
Z Z
prife pour bafe dans · la
fi–
gure
1
ou
.2
de la
pl. 1 d'ALgehre, dans ce S upplément
~
les perpendiculaires
S S
&
R R,
éloignées l'une de
l'autre de telle difiance qu'il vous plaira. Prenez en–
fuite fur la ligne
S S
de l'une ou de l'autre figure
les parties
O
A, A
B, B C, CD,
&c. proporrion–
nelles aux coefficiens
a, b, e, d,
&c. de
l'équa–
Lion,
obfervant de prendre chact!ne de ces Jignes de
basen haut,
a
compter de l' xtremité de Ia derniere,
lorfque le coefficient qu'elle doit repréfenter efi po–
fitif,
&
dans un fens contraire lorfqu 'il efi négatif.
Cela
fait,
tirez par Fextremité de Ia derniere des
lignes
OA, A B, B C,
&c. favoir par
D
,
la ligne
D C,
parallele
a
la bafe
Z Z
,
&
par le point
C,
oú
D C
coupe
R R cC,
&
parallelement
a
S
S,
&
a
telle difiance qu'il vous plaira
M
M;
par le point
o
u
















