
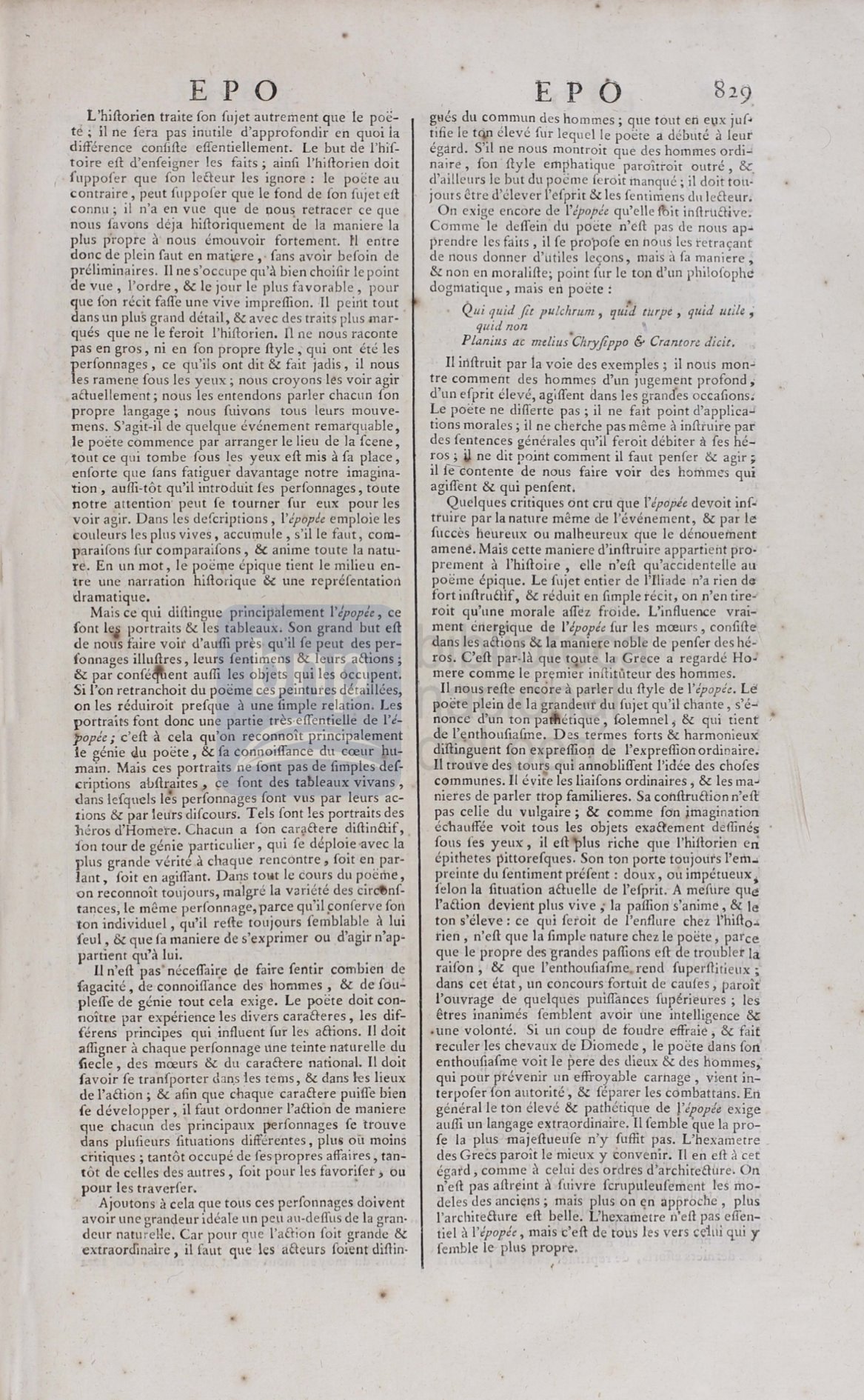
E PO ·
t
'hifiorien traite fon fu jet autrement que le poe–
t~ ~
í1
ne fera pas inutile. d'approfondir en quoi la
d1fférence confifte eífenuellement. Le but de l'hif–
toire eft d'enfeigner les faíts; ainíi l'hi!lorieh doit
fuppofer que fon leéteur les ignore : le poete au
contraire, peut fuppofer que le fond de fon fujet eft
connu ; il n'a el! vne que de
90u~
retracer ce que
nons favons déJa hiftoriquement de la maniere la
plus propre a nous émouvoir fortement.
fl
entre
done de plein faut en matiere, fans avoi.r befoin de
préliminaires.
11
ne s'occupe qu'á bien choifit le point
de vue, l'ordre,
&
le jour le plus favorable, pour
que fon récit faífe une vive impreffion.
I1
peirtt tour
daos un plus grand détail,
&
avec des traits plus mar–
q~és
que ne le feroit l'hiíl:orien.
Il
ne nous raconte
pas en gros, ni en fon propre fiyle, qui ont été les
perfonnages , ce qu'ils ont dit
&
fait jadis, il nous
les
ramene fous les yeux; nons croyons
les
voir agir
aél:uellement; nous les entendons parler chacun fon
propre langage; nous fuivons tous leurs mouve–
mens. S'agit-il de quelque événement remarquable,
le poete commence par arranger le lieu de la fcene,
tout ce qui tombe fous les yeux eft mis a fa place'
enforte que fans fatiguer davantage notre imagina–
tion, auffi-tot qu'il introduit fes perfonnages, toute
notre attention· peut fe tourner fur eux pour les
voir agir. Dans les defcriptions,
l'épopde
emploie les
ouleurs les plus vives, accur.nule, s'ille fant, com–
paraifons fur comparaifons,
&
anime toute la na tu–
re. En un mot, le poeme épique tient le milieu en–
tre une narration hifiorique
&
une repréfentation
rlramatique.
Mais ce qui difiingue principalement
l'lpople,
ce
íont les portraits
&
les tableaux. Son grand but eft
de nous faire voit d'auffi pres qu'il fe peut des per–
fonnages illufires, leurs
fentim~ns
&
leurs aél:ions;
&
par confé
ent auffi les objets qui les óccupent.
Si
l'·on retranchoit du poeme ces peintut'es détaillées,
on les réduiroit prefque
a
une íimple relation. Les
pottrairs font done une partie tres·eífentielle de
1'
é–
popée;
c'efr a cela qu'on reconnoit principalement
ie génie
du
poete ,
&
fa connoiífance du c-reur htt–
main. Mais ces portraits he font pas de íiniples de(–
criptions abfiraites
,
~e
font des tableaux vivans ,
dans lefquels les perfonnages font vus par leurs ac–
tions
&
par 1eurs difcours. Tels font les port_ra!ts
~es
héros d'Horñete. Chacun
a
fon carí¡lél:ere dtfrmétif,
:Ion tour de génie particulier, qui fe
deplo~e
avec la
plus grande vérite achaque rencon,tre' fmt en.yar–
lant
foit en agiífant. Dans tout le cours du poeme,
on
r~connoit
toujours, malgré la variété des cir
nf–
taqces, le meme perfonnage,
p~rce
qu'il FOnferve
fo~
t-on imlividuel, qu'il refre tOUJOUrS femblable
a
lm
íeul,
&
que fa maniere
de
s'exprimer ou d'agir n'ap–
partient qu"a lui.
1.1
n'eft pas néceífaire de faire fentir .combien de
f'<igaciré, de connoiífance des hommes,
&
de fóu–
_pleífe de génie tout cela exige. Le poete doit con–
noitre
par expétience les divers caraéteres, les dif–
férens
princip.esqui influent fur les aétions. Il doit
affigner achaque perfonnage ttne teinte na1:urelle du
fiecle , des mreurs
&
du caraélere national..
11
doit
favoir fe tranfporter dan.s
~es
tems,
&
áans l·es lieux
de l'aétion;
&
afin que chaque ·caraél:ere puiífe bien
fe développer, il faut ordonner l'aétion de maniere
que _chacun des principaux perfonnages fe Houve
dans p1ufieurs -fituations différentes, plus oit moins
critiques; tantot occupé de fes propres affaires, tan–
tot de celles des ruitres, foit pour les favorifer _, ou
pour les traverfer-.
Ajoutons
a
cela que tous ces perfonnages
doiv~rtt
avoir une grandeur idéale un peu au-deífus de la gran·
dcur natureHe. Car pour que l'aél:ion foit grande
&
extraordinaire' il faut que les aaeurs foient diftin-
.
1
EPO
g_t~és
du
~o~mt~n
des hommes; que tout en eux juf
..
t,Ifie le
t~~
eleve
fur
lequel!e poete a d ' buté
a
leur
eg~rd.
SIl ne nous montroit que des hommes ordi–
naJre, fon fryle emphatique paraitroit outré
&
d'ailleurs le but du poeme {;
róit
rnanqtté;
il
doit :ou-·
jours etre d'élever l'efprir
&
les fentimens dnleél:eur.
On exige encore de
l'épopée
qu'elle íbit iníhuél:ive.
Comme le deífein du poere n'efi pas de nous ap–
prendre les faits, il fe propofe en nous
les
ietra<;ant
de nous donner d'utiles le<;ons, mais
~
fa
maniere,
&
non en motalifre; point fur le ton d'un philofophe
dogmatique, mais en poete :
Qui quid jit pulchrum, quid ttape, quid utile;
quid non
Planius ac mdi.us.Chryjippo
&
Crantore
dicit.
Il
iñfiruit parÍa voie des exemples ;
il
nous mon–
tre comment des hommes d'un jugement profond;
d'un efprit élevé, agiífent &ans les grancfes ocG:afions:
~e
poete ne diíferte pas ;
il
ne fait point d'applica–
tiOns morales;
il
ne chetche pas meme
a
infituíre par
des fentences générales qu'il feroit débiter
a
fes hé–
~os;
U
ne dit po.ínt comment
il
faut penfer
&
agir;
1l iecontente de nous faire voir des horñmes qui
agiífent
&
qui penfent.
9uelques critiques ont cru que
1'
épojée
devoit inf–
trmre par la nature
m
eme
de
l'événement'
&
parlé
fucces l'ieureux ou malheureux que le dénoueinent
amene. Mais cette maniere d'inflruire appartieht prd–
prement
a
l'hifioire ' elle n'eíl qu'accidentelle au
poeme épique. Le fujet entier de l'Iliade n'a rien
d~
fort infiruéHf,
&
réduit en fimple técit, on n'en
tire~
roit qu'une morale aífez froide. L'influence vrai–
ment éherg1que de
1'
épopée
fur les mreurs, coníifie
dans les aél:ions
&
la maniere noble de penfer des hé–
ros. C'efi par-Ia que toute la Grece a regardé Ho..–
mere cornme le premier inftituteur des hommes.
Il
nous refie encore a parler du fiyle de l'
épopée.
Le
poete plein de la gr9-ndem• du fu jet qu'il eh-ante, s'é–
nonce d'un ton pa
étique, folemnel,
&
qui tient ,
de l'enthouíiafme. Des termes forts
&.
harmonieux
diRinguent fon expreffio.r de l'expreffion
ordinaire~
11
rrouve des tours
qui
annobliífent Jlidée des chofes
communes.
I1
évite les liaifons ordinaires;
&
les
ma..~
nieres de parler ttop familieres. S
a
conílruél:ion n'eít
pas celle du vulgaire;
&
comme fon imagination
éc'hauffée voit tous les objets exaél:ement deffinés
fous fes yeux,
il
efi 1Jlus riche que l'hiilorien en
épithetes pittorefques. Son ton porte toujours
l
1
em.
preinte du fentiment préfent: doux, ou
impétueux~·
felon la fituátion áél:uelle de l'efprit.
A
mefure que
raaion devient plus vive; la paffion s'anime'
&
le
ton s'éleve: ce qui fetoit de l'enflure chez l'hifi
0
.,¡
ríen, n'eft que
la
fimple nature chez le poete, paree
que le propre des "grandes paffions eft de troubler la
raifon,
&
que l'enthoufiafme rend fuperfiitieux •
dans cet état, un concours fortuit de caufes,
paroi~
l'ouvrage de quelques pui.ífances fupérieures ; les
etres inanimés femblent avoir une intelligence
&
. une volonté. Si urt coup de foudre effraie,
&
fait
reculer les chevaux de Diomede, le poete dahs fort
enthouíiafme voit le pere des dieux
&
des hommes,
qui pour prévenir un effroyable carhage, vient in–
terpofer fon autorité,
&
féparer les combattans.
En
généralle ton élevé
&
p_at~étique
de
!'é¡;opée
exige
auffi un langage extraordmalre. I1 fembl·e que la pro–
fe la plus maje:fiueufe n'y fuffit pas. L'hexametre
des Grecs paroit le mieux
y
convenir. I1 en efi
a
cet
égard, comme
a
celui des ordres d;archire-B:ure. On
n'efi pas aftrcint
a
fuivre fcrupuleufement les mo–
deles des anciens; mais plus on
~n
apptoche, plus
l'architeaure efi belle. L'hexafuetre n'efi pas eífen–
tiel
a
l'épopée,
mais c'eft de tous les vers cei11i qtti
y
femble le
pllls
propre.
















