
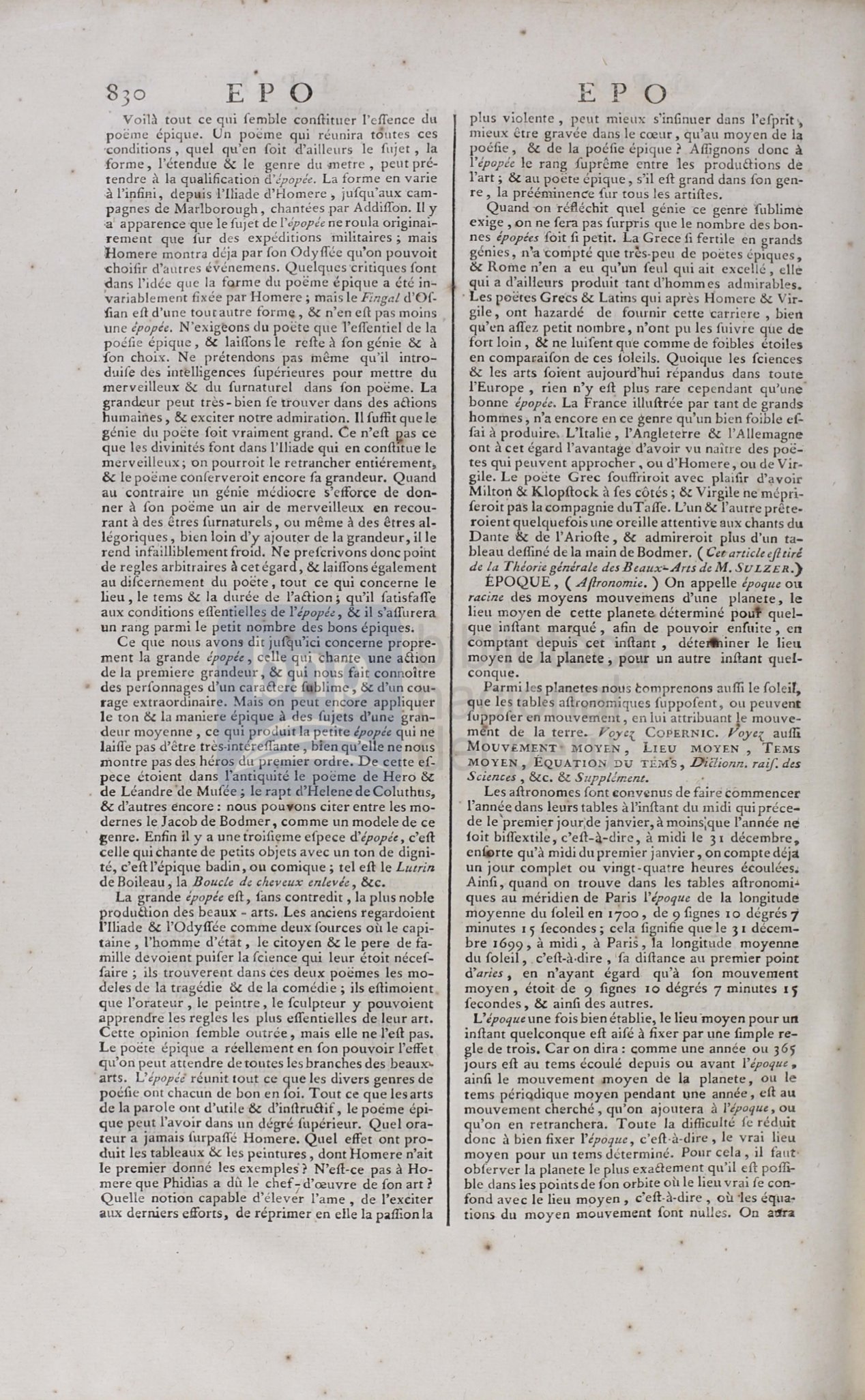
EPO
Voila tout ce qui femhle conftituer l'eífence dli
poeme épigue. Un po ··me qui réunira tontes
ces
·condirions, quel
qt~.'e n
foit d'ailleurs le fujet , la
forme, l'érendue
&
le genre
du
metre , peut pré–
tendre
a
la qualificarion
d'épopie.
La
forme en varie
a
l'infiai, depuis ·l'Iliade d'Homere, jufgu'aux cam–
pagnes de Marlborough, chantées .par Addiífon.
Il
y
·a
apparence que le fujet
d~
1'.
~opée
ne
_r?u~a origina~·rement que fur des exped1t10ns milltanes; ma1s
Homere montra déja par fon Ody:ífée qu'on pouvoit
-choifir d'autres événemens. Quel<:¡ues ·critiques font
dans l'idée que la forme du poeme épique a été in–
variablement fixée par Homere ; mais le
Fingal
d'Of–
Ílan efr d\me tourautre forme,
&
n'en efi pas moins
une
épopée.
N'exigeons du poete que l'e:ífentiel de la
p oéfie épigue,
&
laiífons le refie
a
fon génie
&
a
íon choix . Ne prétendons pas meme qu'il intro–
duife des intelligences fupérieures pour mettre du
merv eilleux
&
du furnaturel dans fon poeme. La
grand.eur peut tres- bien fe trouver d!lns des aé.tions
humaines,
&
exciter notre admiration.
11
fuffit que le
génie du poete foit vraiment grand. Ce n'efr eas
~e
que les divinités font dans l'lliade qui en confl:itu-e le
merveilleux; on pourroit le retrancher
entiérement~
&
le poeme conferveroit encare fa grandeur. Quand
au contraire un génie médiocre s'efforce de don–
ner a fon poeme un air de merveilleux en recou–
rant
a
des e tres furnaturels, Oll meme
a
des etres al–
légor~que_s ~
bien loin
d'y
ajout~r
de
~a
grandeur, íl.,Ie
rend mfa1lhblement fro1d.
N
e preferlvons done pomt
de regles arbitraires
a
cet égard'
&
laiffons également
au difcernement du poete, tour ce qui concerne le
lieu, le tems
&
la dnrée de l'aé.tion
j
qu'il fatisfaífe
aux conditions eífentielles de
l'épopée,
& il s'aífurera
un rang parmi le petit noinbre des bons épiques.
Ce que nous avons dit jufqu'ici conce·rne propre–
ment la grande
épopée,
celle qui chante une aé.tion
de la premiere grandeur, & qui nous fait connohre
des perfonnages d'un caraé.tere fublime, & d'un cott–
rage extraordinaire. Mais on peut encore appliquer
le ton
&
la maniere épique
a
des fujets d'une gran–
deur moyenne, ce qui produit la perite
épopée
qui ne
Iaiífe pas .d'etre tres-intéreífanre, bien qu'elle ne nous
montre pas des
héro~
du premiet ordre. De cette ef–
pece étoient dans l'antiquité le poeme de Hero
&
de Léandre de Mufée; le rapt d'Helene de Coluthus,
&
d'autres encare: nous pouvons citer entre les mo–
dernes le Jacob de Bodmer, comme un modele de ce
genre. Enfin il
y
a une iroifieme efpece
&épopée,
c'~íl:
celle qui chante de petits objets avec un ton de digni–
té, c'eíl:l'épique badin, ou comique; tel eíl: le
Lutrin
de Boileau, la
Boucle de cheveux enlevée,
&c.
La grande
épopée
eíl:, fans contredit , la plus noble
proclué.t~on
des beaux - arrs. Les anciens regardoient
l'Iliade
&
l'Odyífée comme deux fources otile capi–
táine, l'homme d'état, le citoyen
&
le pere de fa–
mille devoient puifer la fcience qui leur étoit nécef–
faire; ils trouverent dans ées deux poemes les mo–
deles de lá tragédie
&
de la comédie; ils efiimoient
que l'orateur, le peinrre, le fculpteur y pouvoient
apprendre les regles les plus eífentielles de leur art.
C ette opinion femble outrée, mais elle ne l'eíl: pas.
Le poere épique a réellement en fon pouvoir l'effet
qu'on peut attendre de toutes les branches des beauXlo
arts.
L'épopée
réunit tout ce que les divers genres de
poéú e ont chacun de bon en foi. Tout ce que lesarts
de la parole ont d'u.tile & d'inflntaif, le poeme épi–
que p eut l'avoir dans un dégré fupérieur. Quel ora–
teur a jamais furpaífé Homere. Quel effet ont pro–
duit les tableaux
&
les peintures, dont Homere n'ait
le premier donné les exemples' ? N'eíl-ce pasa Ho–
mere que Phidias a dtt le chef¡ d'reuvre de fon art?
Quelle notion capable d'élever l'ame , de l'exciter
aux derniers etforrs, de réprimer en elle la paffion la
EPO
plus violente, peut mieux s'inúnuer dans l'efprít ,
tnieux erre gravé e dans le creur' qu'au moyen de la
poéfie,
&
de la poéfie épique
?
Affignons done
a
l'épopée
le rang {upreme entre les produé.tions de
l'art;
&
a
u
poete épique, s'il efr grand dans fon gen–
re , la prééminene'e íur tous Jes artifies.
Quand "On réfléchit quel génie ce genre íublime
exige , on ne fera pas furpris que le nombre des bon–
nes
épopks
.foit fi petit. La Grece
fi.
fertile en grands
génies, n'a l:ompté que tres-peu de poetes épiques,
&
Roine n'en
a
eu qu'un {eul
qui
ait excellé, elle
sui a d'ailleurs produit tant d'homm es admirables.
· Les p€>"eres Gréts
&
Latins qui apres H omere
&
Vir–
gile, ont hazardé de fournir cette 'Carriere , bien
qu'en a:ífez petit nombre, n'ont pules fuivre que de
forr lo in ,
&
ne luifent qt1e comme de foibles étoiles
en compar;aifon de ces foleils. Quoique les fciences
&
les arts foi'ent aujour'd'hui répandus dans toute
l'Europe , rien n'y efr plus rare cependant qu'une
bonne
-épopée.
La France illuíl:rée par tant de grands
hommes; n'a e-ncore en ce gen re qu'un bien foihle ef–
fai
a
produire\ L'ltalie, l'Angleterre
&
1'
Allemagne
Ont
a
cet égard l'avantage d'avoir
VU
naitre des poe-·
tes qui peuvent approcher" ou d'Homere , ou de
Vir–
gile. Le poete Grec fouffriroit avec plaifir d'avoir
Milto~
&
Klopfiock a fes c·orés;
&
Virgile ne mépñ–
feroit pas la compagnie duTaífe. L'un
&
l'aurre prete–
roient quelqi.l<:foi.s une oreille
at~enti-ye
aux chants du
Dante
&
de
1'
Anofie,
&
adm1rero1t plus d'un
ta–
bleau deífmé de la main de Bodmer. (
Cet article
ejl
tiré
de la Théorie glaérale desBeaux-..Arts de M. SuLZER.)
ÉPOQUE, (
Aflronomie.)
On appelle
époque
oa
racine
des moyens mouvemens d'une planete,
le
lieu moy en de cette planete déterminé pou quel–
que infiant marqué, afin de pouvoir . enfuite, en
comptant depuis cet infiant , déte
iner le liett
moyen de la planete ; pour un autre infiant
·que!–
conque.
Parmi les planetes riot
S
comprenons aufii le foleil,
q4e les tables afironomiques fuppofent, ou peuvent
fuppofer en mouvement, en lui attribuant le mouve–
rnent de la terre..
Foye{
COPERNIC.
Poye{
auffi
Mouv.t.M~NT
MOYEN, LIEU MOYEN , TEMS
MOYEN, EQUATION DU TEMS,
Díaionn. raif. des
S
ciences
,
&c.
&
Suppl 'ment.
Les afironomes font gonvenus de faire commencer
l'année dans leurs tables a l'infrant du midi qui préce–
de le premie.r jour;de janvier, a rnoins;que l'année ne
ÍOÍt biífexti}e, c'efi-a-dire,
a
midi le 3
I
décembre,
eníerte qu'a midi du premier janvier, on compte déja
un jout complet ou vingt -quatre heures écoulées.
Ainfi, quand on trouve dans les tables afironomi.l
ques au méridien de París
l'époque
de la longitude
rnoyenne du foleil en
1700,
de 9 fignes
10
dégrés
1
minutes
1
5 fecondes; cela fignifie que le 3 r décem–
bre 1699,
a midi, aParis, la longitud e moyenne
du foleil, c
'efl:-a.dire, fa difiance au premier point
d'aries,
en
n'ayant égard qu'a
fon mouveqtent
rnoyen, étoit de 9 fignes
10
dégrés 7 minutes
15
fecondes, & ainfi des autres.
L'
époque
une fois bien établie, le lieu ·moyen pour un
infiant quelconque efi aifé
a
fixer par une úmple re–
gle de trois. Car on dira: comme une année on 365
jours efi au tem-s écoulé depuis o u avant
1'
époque
•
ainfi le mouvement moyen de la planete, ou le
tems périQdique moyen pendant Qne année, eft au
mouvement cherché, qn'on ajoutera
a
l'époque,
ou.
qu'on en retranchera. Toute la difficulré fe
~éd.uit
done a bien fixer
l'époque,
c'efi -a-dire, Je
Vf~l
heu
moyen pour un tems déte rminé. Pour cela, 1l faut
obferver la planete le plus
e~aéte~en~
qu'il
~ft
poffi–
ble da ns les pointsde fon
or~1te
ou
~e
heu vra1 fe,con–
fond ave e le lieu moyen, e efi-a-d1re, ou ·les
equa~
tions du moyen mouvement font nulles. On am-a
















