
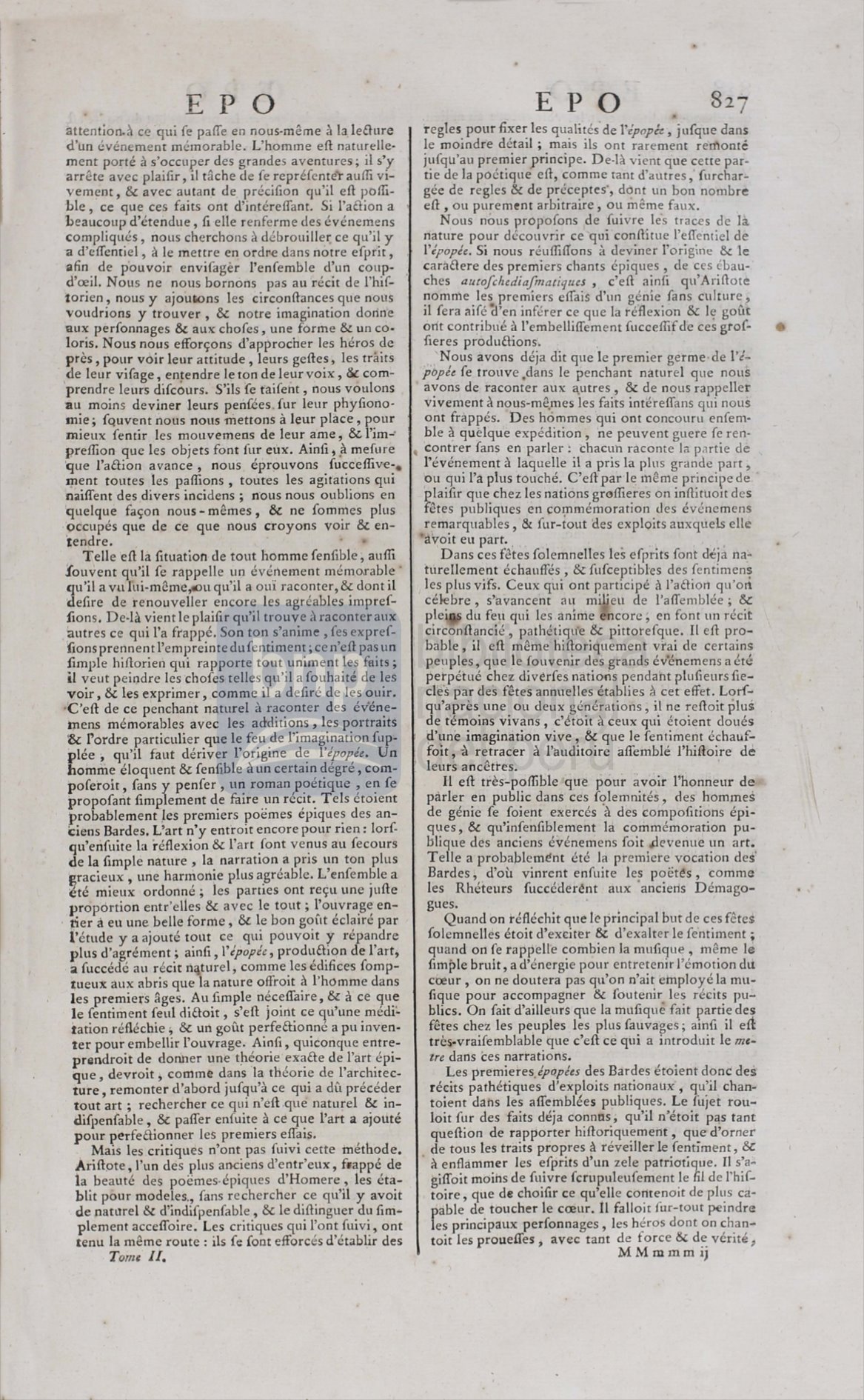
E PO
attention. c ce qui fe palre en nous-meme
a
la
leéture
d'un évén mem mémorable . L'homme eft naturelle–
ment porté
a
s'occuper des grandes aventures;
il
5'y
a rrete avec plaifir ' il tache de fe repréfenter auffi vi–
vement,
&
avec autanc de p récifio n qu'il efr poffi–
b le, ce que ces faits ont d'intéreífant.
Si
l'aél:ion a
l>eaucoup d'étendue, fi elle renferrn e des é vénemens
compliqués ' no us chercbons
a
débrouiller ce qu'il
y
a
d'eífentiel'
a
le mettre en ordre dans notre efprit'
afin de pouvoir envifager l'enfemble d'un coup–
d'ceil. Nous ne nous bornons pas au r écit de 1hif–
torien, nous
y
ajoutons les circonfrances que nous
voudrions y trouver ,
&
notre imagination donne
QUX
perfonnages
&
aux chofes, une forme
&
un co–
loris. Nous nous effon;ons d'approcher les héros
de
pres, pour voir leur attitude, leurs gefi:es, les traits
de Ieur vifage,
en~endre
le ton de leur voix,
&
com–
prendre leurs difcours. S'ils fe taifent, nous voulons
au moins deviner leurs peníees fur leur phyfiono–
mie; fquvent nous nous rnetrons
a
leur place' pour
mieux fentir les mouvemens de leur ame,
&
l'im–
preffion que les objets font fur eux. Ainfi; a mefure
'que l'aélion avance, nous éprouvons fucceffive- .
ment toutes les paffions , toutes les agitations qui
mliífent des divers incidens ; n·ous nous oublions en
quelque
fa~on
nous- memes'
&
ne fommes plus
·occupés que de ce que nous croyons voir
&
en–
tendre.
Telle efi la fituation de tout homme fen fible, auffi
Jouvent qu'il fe rappelle un événement mémo.rable ·
qu'il a vului-meme,.ou qu'il
a
oui raconter,
&
dont il
rlefire de renouveller encore les agr éables impref–
:fions. De-la vient le plaiíir qu'il trouve
a
raconter aux
,a
utres ce qui l'a frappé. Son ton s'anime , fes expref–
fionsprennentl'empreinte dufentiment; ce n'efr pasun
fimple hifl:orien qui rapporte tout uniment les faits;
il
veut peindre les chofes telles qu'il
a
fouhait é de les
voir,
&
les exprimer, comme
il
a deíiré de les ouir.
C'efi de ce penchant naturel
a
raconter des év.éne–
mens mémorables avec les additions,
les
portraits
&
rordre particulier que le feu de l'imagination fup–
plée, qu'il faut dériver l'origine de
l'épopée.
lJn
homme éloquent
&
fenflble
a
un certain dégré' com–
pofe'roir, fans
y
penfer , un roman poétique , en fe
propofarit fimplement de faire un récit. Teis étoient
probablement Jes premiers poemes épiques des an–
ciens Bardes. L'art n'y entroit
encare
pour ríen: lorf–
qu'erifuite
la
réflexion
&
l'art font ve nus au fecours
de la íimple náture , la narration a pris un ton plus
gracieux, une harmonie plus agréable. L'enfemble a
~té
mieux ordonné ; les panies ont
re~u
une jufie
propórtion entr'elles
&
av ec le tout; l'ouvrage en-
.
~er
a
eu une belle forme'
&
le bon goftt éclairé par
l'étude
y
a ajouté tont ce qui pouvoit
y
répandre
plus d'agrément; ainíi,
1'
épopie ,
produaion de l'art,
a
fuccédé a
u
récit tiaturel, comme les édifices fomp–
tueux aux abrís que la nature offroit
a
l'homme dans
les premiers ages.
Au
fimple néceífaire ,
&
a
ce que
le fentiment feul diaoit, s'efi joint ce qu'une
médi~
tation réflécbie ;
&
un goí'tt perfeaionne a pu inven·
ter pour embellir l'ouvrage. Ainfi, quiconque entre–
prendroit de doriher une
tJ'l~orie
exaa e de l'art épi–
que, devroit, comme dans la théorie de l'archirec–
ture, remonter d'abord jufqu'a ce qui a dfl précéder
tout art ; rechercher ce q ui n'eft que naturel
&
in–
difpenfable '
&
paífer enfuite a ce que l'art a ajouté
pour perfeél:ionner les premiers eífais.
Mais les critiques n'ont pas fuivi cette méthode.
Arifipte, l'un des plus aociens d'entr'eux, frappé de
la beauté des poemes-épiques d'Homere , les éta–
blit pour modeles., fans r echercher ce qu'H
y
avoit
de natt.trel & d indifpenfable ,
&
le diftinguer du fim–
plement acceífoire. Les critiques qui l'ont fuivi, ont
tenu la meme route:
ils fe
font efforcés d'établir des
Tomt
JI.
EPO
r egles. pour
fi~e~
les
qu~\i~és
de
1
épopá,
jufque dans
le motndre deta1l ; ma1
1ls o nr rarement r e onté
j~tfqu'au p r~~ i e r
prínci pe. De-la vient que cene par–
ne de la póetique efi, comme ranr d'autres
furchar–
gée de regles & de pr
1
ceptes, dont un
bo~
nombre
efi' ou purement arbitraire ' ou meme faux.
Nous nous pró pofons de fuivre les traces de la
nature pour d
1
couv ri r ce qui confiirue l'eífentiel de
l'épopée.
Si
nous réuffiíions
a
deviner
1
origine
&
le
caraélere des premiers chants épiques , de
ces
ébau–
ches
autofchediafmatiques
,
c'efi ainíi qu Ariftote
nomme les premíers eífais d'un génie fa ns culture;,
il fera
aif~
él';n
i?férer ce que la r éflexion
&
1~
gout
orit contn bue a
1
embelliífement fucceffif de ces grof·
iieres produilions.
Nous avons déja dit que le premie r germe de
l'é~
p opte
fe trouve .dans le penchant naturel que nous
a~ons
de racon re r
aux
autres, & de nous rappeller
VIVement
a
nous-me.mes les faits ÍntéreífanS
qui
OOUS
ont frapp és.
D es
hommes
<)llÍ
ont concouru enfem·
ble
a
quelque expédition ' ne peuvent guere {eren–
contrer fans en parler : chacuh raconte la partie
de
l'événement
a
laquelle
il
a pris la plns grande part '
ou qui l'a plus tou ché. C'efrpar
l ~
tneme príncipe de
plaifir que chez les nations groffi eres on infiituoit des
fetes publiques en
co~mémorati on
des événemens
r~ m.a rquables,
&
fur-tout des exploits auxquels elle
avott eu part. .
Dans ces fetes fGlemnelles les efprits font déja na·
turellement échauffés ,
&
fufce pribl·es des fentimens
les plus vifs. Ceux qui ont participé
a
l'aél:iort qu'ort
célebre, s'a vancent atl mili eu de l'aífemblée;
&:.
plei s du feu qui les anime encore; en font un récit
círconfiancié, pathétiqtie
&
pi tto tefque.
Il
efr pro..
bable'
il
eft meme hifroriqu ement vrai de cer tains
peuples, que le fouve nir des grands év'énemens a été
perpétué chez diverfes natioris pendant plufi eurs fie–
cles
par des fetes annuelles établies
a
cet effet. Lorf
...
qu'apres une ou deux gé nérations,
il
ne refioit plus
de témoÍJ:lS VÍVans, c'éroi_t
a
ceux qui étoient doués
!f'une imagination vive,
&
que le fen timent échauf–
foit'
a
retracer
a
I'auditoire aífemblé l'hifioire de
Ieurs ancetres.
Il
efi tres-poílible que pour avoir l'honneur de
parler en public dans ces f<?lemnités, des hommes
de génie fe foient exercés
a
des compofiti ons épi·
ques,
&
qu'infeníiblement la commémoration pu–
blique des anci ens év énemens foit .rlevenue un a rt.
Telle a probaplemént é té la premiere vocation des·
Bardes, d'ou vinrent enfuite les poétes, comme
les Rhéteurs fuccéderént aux ·anciens D émago..
gues.
Quand on téfléchit que
le
principal but de ces fetes
fol emnelles étoit d'exciter
&
d'exa lter le fentiment ;
quand on fe rapp elle combien la rnufique , tneme
le
fimple brult, a d'énergie pou r entreteni r l'émotion du
c~ur,
on ne doutera pas qu'on n'ait einployé la m
u–
fique pour accompagner & fo utenir les récits pu..
blics. On fait d'ailleurs que la mufique fait partie des
fetes chez les peuples les pl us fauvages; ainfi
il
eít
tres-vraifemblable que c'efi ce qui
a
i nrroduit le
me–
'tre
dans ces narrations.
Les premieres.épopées des Bardes étoient done des
récits pathétiques d,exploits nationaux , qu'il chan–
toient dans les aífemblees publiqu es. Le fuj et r ou–
loit fur eles faits déja connus, qu'il n'étoit pas tant
quefiion de rapporter hifroriquement , que d'orner
de tous les traits propres
a
réveiller le fentiment'
&
a
enflammer les efprits d'un zele patriotique.
Il
s'a~
giífoit moins de fuivte fcrupul eufement le
lil
de
l'hif–
toire, que de choiíir ce qu'elle coritenoir de plus ca–
pable de toucher le creur.
11
falloit fur-tout peindre
les principaux perfonnages, les béros dont on chan...
toit les proue!fes ,
avec
tant
de
fo rce
&
de vérité,
M M
m
mm
ij
















