
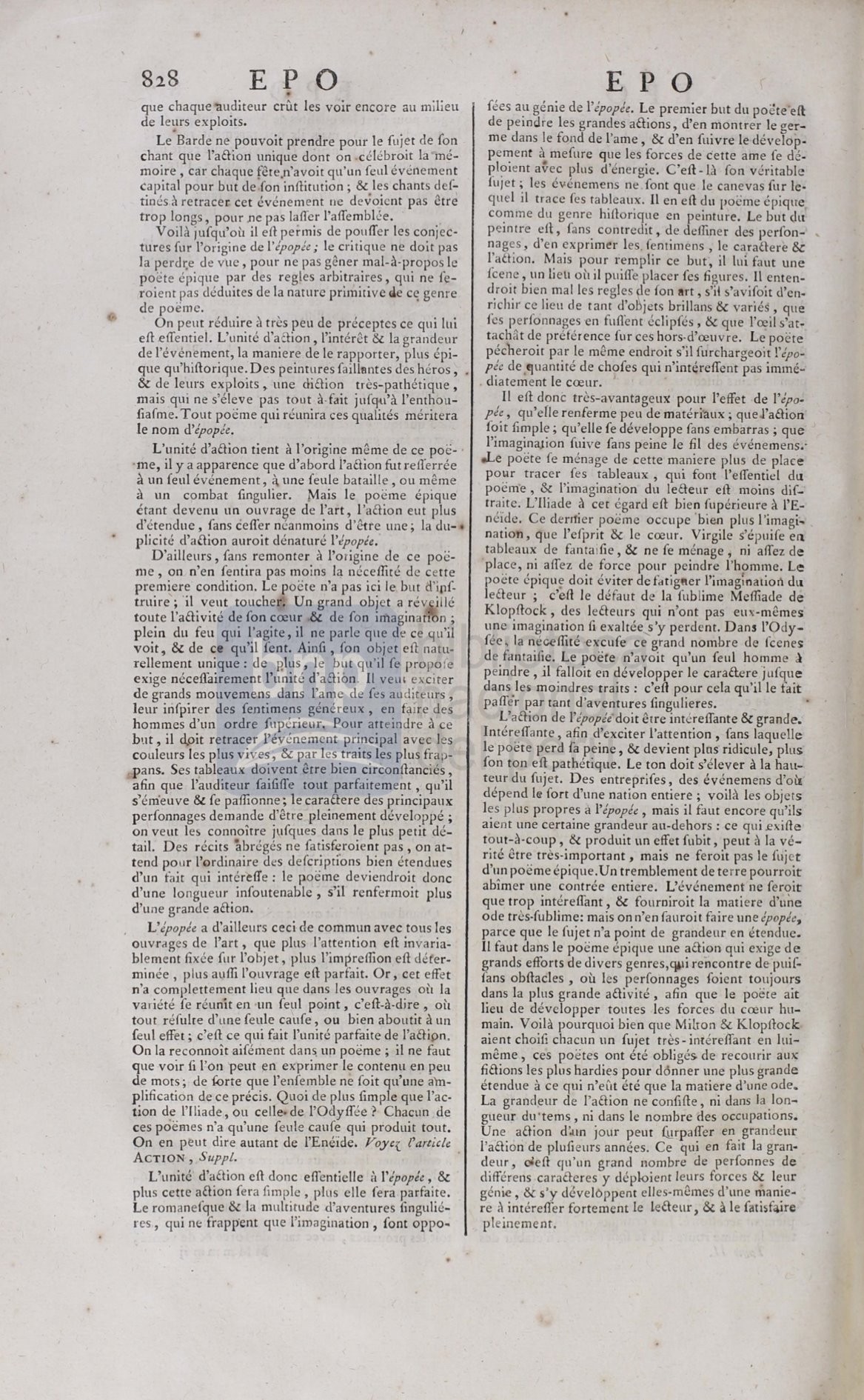
EPO
que chaque auditeur cr('tt les voir encore au milieu
de
le~trs
ex ploits.
Le Barde ne pouvoit prendre pour le fujet de fon
chant que l'aétion unique dont on
célébro.itla mé–
mo~re,
car chaque fere.n'avoit qu'un feul événement
cap1tal pour but de fon infritution;
&
les chants def–
tinés
a
retracer cet événement
ne
devoient pas erre
trop longs, pour
ne
pas laífer l'aífemblée.
Voila jufqu'oit il efr permis de pouífer les conjec–
tures fur !'origine de
l'épopée ;
le critique ne doit pas
la perdr:e de vue , pour ne pas gener mal-a-propos le
poete épigue par des regles arbitraires,
qui
ne fe–
roient pas déduites de la nature primitive <ie
e~
genre
de poeme.
On peut réduire a tres peu de préceptes ce qui lui
efi eífentiel. L'unité d aél:ion, l'intéret
&
la orandeur
de
l'év~n.e me~t,
la manier
_e.dele rapporter, plus
1
pi–
que qu h1fionque. Des pemrures faillsntes des héros,
&
de leurs exploits,. une diétion tres-parhétiqne
mais _qui ne s'éleve pás tout a-fait jufqu'a
l'enthou~
fiafme. Tout poeme qui réunira ces qúalités méritera
le nom
d'épopée.
L'~nité
d'aétion tient
a
l'origine meme de ce poe- '
·me, 1l y a apparence que d'abord l'aélion fut reirerrée
a
un feul événement'
a
une feule bataille' o u meme
a
un combat fingulier. Mais le poeme épique
étant devenu un o uvrage de l'art, 1'aétion eut plus
d'étendue, fans ceífer néanmoins d'etre une; la du-.
plicité d'aB:ion auroit dénaturé
l'épopée.
D'ailleurs, fans remonter a !'origine de ce poe–
me, on n'en fentira pas moins la oéceffiré de cette
premiere condition. Le poere n'a pas ici le but d'ipf–
truire; 'il vent toucher. Un grand objet a rév i lé
toute l'aél:ivité de fon creur
.&
de fon imagination ;
plein du fe u qui !'agite, il ne parle que de ce qu'il
voit,
&
de ce qu'il fent. Ainfi, fon objet eft natu·
rellement unique: de Blus, le but qu'il fe propo fe
exige néceífairement l'unité d'aétion . Il vem exciter
de grands
mouveme.nsdans l'ame de fes auditeurs,
leur infpirer des fentimens généreux , en fa jre des
hommes d'un ordre fupérieur. Pour atteindre a ce
but, il d,oit retracer l'événement principal avec les
couleurs les plus vives,
&
par les traits les plus fra p–
pans.
Ses
tahleaux doivent erre bien circonítanciés,
afin que l'auditeur faiíiífe rout parfaitement, qu'il
s"'énieuve
&
fe paffionne; le caraétere des principaux
perfonnages demande d'etre pleinement développé;
on veut les connoitre jufques dans le plus petit dé–
tail. Des récits abrégés ne fatisferoienr pas, on at–
tend pour l'ordinaire d
s
defcriprions bien étendues
d'un fair qui intéreffe: le poeme deviendroit done
d'une lo ngueur infoutenable, s'il renfermoit plus
d'une grande aétion.
L'
épopée
a d'ailleurs ceci- de commun avee tous les
ouvrages de l'art, que plus l'attention efi inva ria–
hlement fixée fur l'objet, plus l'impreffion efi déter–
min ée , plus au:ffi l'ouvrage eít parfait. Or, cet effet
n'a complettement lieu que dans les ouvrages ott la
va riété fe réunít en un feul point, c'efi-a-dire , o1t
tour r éfulre d'une feule caufe' ou bien aboutit
a
un
feul effer; c'efr ce qui fait l'uniré patfaite de l'aétion.
On la reconnoir aifément dans un poeme; il ne faut
que voir
íi
l'on peut en exprimer le contenu en peu
de mors; de í<>rte que l'enfemble ne foit qu'une am–
plification de ce précis. Quoi de plus fimple que l'ac–
tion
d~
l'Iliade, ou celle· de l'Odyífée? Chacun de
ces poeFnes n'a qu'une feule caufe qui produit tout.
On en peut dire autant de l'Enéide.
Voye{ l'article
AcTION,
Suppl.
L'unité
d'~él:ion
efi done eífentielle
a
l'épopée,
&
plus cette aél:wn fera fimple, plus elle fera parfaite.
Le romanefque
&
la multiturle d'aventures finguli é–
res, qui ne frappent que l'irnagination, font
oppo~
EPO
fées
a~
génie de
1'
'popée.
Le premier but du poete
elt
de pe1ndre les grandes aél:ions, d'en montrer le ger-–
me clans le fond de l'ame,
&
d'en fuivre le dévelop–
p e~ent
a mefure que les forces de c'ette ame fe d
1
•
pl?Ient avec plus d'énergie. C'eft-
la
fon véritable
fuJet
~
les événemens ne font que le canevas fur le–
que! 1l trace fes tab.leau:c.
11
en efi du po··me épique
co:nme du genre h1íl:onque en peinture. Le but
dlt
p e1nrre
~H,
fans_ contredit,
~e
deffiner des perfon–
~ag~s ,
den
~xpnmer
les.
f~ntlmens
, le caraétere
&
1
aét10n. Ma1s pour rempltr ce but, il lui faut une
fce~e, ~m
lieu oú il puiífe placer fes figures.
11
enten–
d.r01_t b1en_ mal les regles de fon art, s'il s'avifoit d'en–
nchn· ce l!eu de tant
d:oBj~ts
_bri,Jlans
&
varíés, que
fes p"erfonnapcls -en fuílent echpfes,
&
que l'ceil s'at–
talchat
d~
preference fur ces hors-d'ceuvre. Le poete
pecherolt par le meme endroir s'il furcharoeoit
l'épo–
p~c
de quantité de chofes qui n'intéreífent pas immé–
dtatement le creur.
Il
efr done tres-avanta geux pour l'effet de
1'
épo·
pé~ ,
qu'efle renferme peu de marériaux; que l'aélion
\~lt
fit?pl:; qu'7lle fe développe fans embarras ; que
limagma.tJon furve fans peine
le
fil des événemens.-
e poete fe ménage de .cette maniere plus de place
potlr tracer fes tableaux , qui font l'effentiel du
poeme ,
&
l'imagination du letteur efi moins dif–
tra.~te.
L'Iliade a cet égard efr bien fupérieure
a
l'E–
néi?e. Ce dernier poeme occupe 'bien plus 1 'imagi,
nat10n, que l'efprit
&
le coour. Virgile s'épuife en
tablea
u~
de fanta ifie,
&
ne fe ménage, ni aífez de
place, m aífez de force pour peindre l'homme. Le
poete épique doit éviter de farig er
l'imag~nation
dtt
leél:eur ; c'efi
le
défaut de la fub lime Meffiade de
Klo~fioc~, ~es leéteur~
qui n'ont pas enx-memes
une 1magmat10n fi exaltee s'y perdent. Dans l'Ody–
fée
~
la
~éce:ffiré
excufe
c~grand
nombre de fe enes
de_fanta1fie. Le poete n'avoit qu'un feul homme
a
pemdre,
jl
falloit en développer le carafrere jufque
dans_Jes moindres traits: c'eil pour cela qu'ille fait
paífer par rant d'aventures fingulieres.
·
~'a étion
de
l'épopée
doit etre intéreífante
&
grande.
lnter~ffa nte,
afin d'exciter l'attention, fans laquelle
le poete perd fa peine,
&
devient plus ridicule, plus
fon ton efi pathétique. Le ton doit s'élever a la hau–
telur du fujet. Des entreprifes, des événemens d'ou
depend 1€ fort d'une natign entiere ; voila les objets
l:s pl us
propr~s
a
l'épopée,
mais il faut encore qu'ils
a1ent une certame grandeur au-dehors
:
ce qui .exifie
tout-a-coup'
&
produit un effet fubit' peut a la vé–
r~té etr~ tre~-i:nportant,
mais ne feroit pas le fuj et
d 1!n poeme
eptque.Untremblement de te rre pourroit
ab1mer une contrée entiere. L'événement ne feroit
que trop intéreífant,
&
fouroiroit la matiere d'une
ode tres-fublime: mais on n'en fauroit faire une
épopée,
paree que le fu jet n'a point de grandenr en étendue.
Il faut dans le poeme épique une aél:ion qui exige de
grands efforts de divers genres,c¡llÍ reñcontre de- puif·
fans obfiacles , ou les perfonnages foient toujours
dans la plus grande aétivité, afin que le poete ait
lieu de développer toutes les forces du cceur hu–
n:tain. Vo.ila pourquoi bien que Milton
&
Klopfrock
a1ent cho1fi chacun un fu jet tres- intéreffant en lui–
meme, ces poetes ont été obligés. de recourir ame
fittions les plus hardies pour donner une plus grande
étendue
a
ce
qui n'elit été que la matiere d'une ocle..
La grandeur de l'aél:ion ne confifie, ni dans la lo n–
gueur du ·tems, ni dans le nombre des occupations.
Une attion d'.un jour peut (urpaífer en grandeur
l'aél:ion de plufi eurs ann¿es. Ce qui en fait la gran·
deur, cJefi qu'un grand nombre de perfonnes de
différens caraél:eres y déploient leurs forces
&
leur
gén ie,
&
s'y développenr elles-memes d' une
manie~
re
a
intéreífer fortement le le.tleur'
&
a
le
fatisf~re
pleinement.
















