
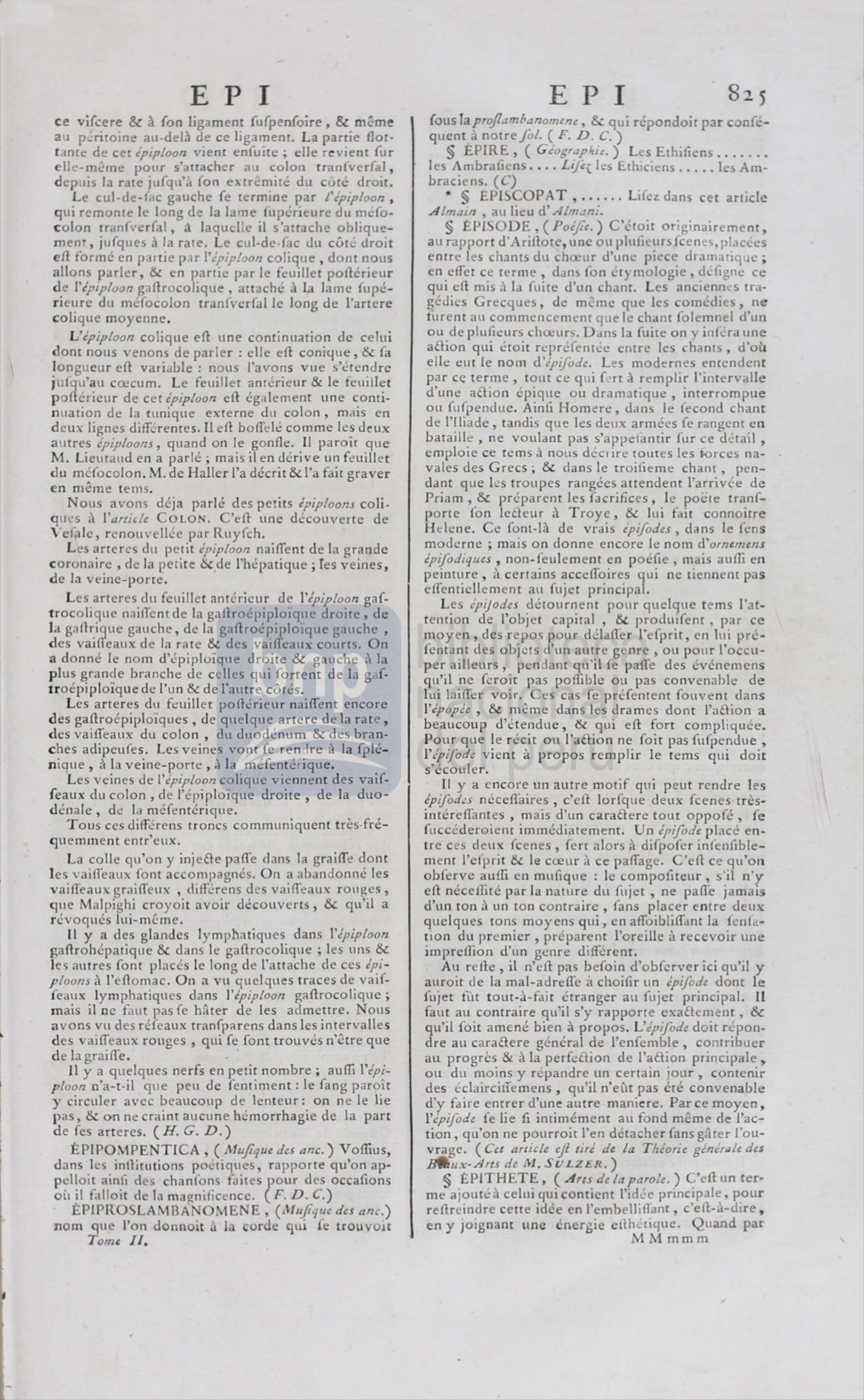
E
P
I
ce vifc:ere
&
fon ligament fufpenfoire,
&
méme
a p.!ri
oine a t-dela de ce ligamen . La parrie flo -
t ante
de cer
t!pi.ploon
vienr
enfuire · lJe
re
•ienr fur
lle-mcme pol
r
s'arracher a u colon tranfverfa ,
d ep
is
la rare jufqu'a fon e tremir' du cot' droir.
L e
cul-de-fac gauche fe termine par
L'épiploon,
q ui remonte le long de la lame upérieure du m
'(o –
colon tranfrerfal ,
a
Jaquelle
il
s'a tache oblique–
men ' jufques
a
la ra e.
e
cul-de-fac
uu
córé droit
eft
formé en partie par
PJpiploon
colique, dont nous
allons parler,
&
en parrie par le
fi
uiller pofi 'rieur
de
l'épiploon
gafirocolique attach
1
a la lame fupé–
rieure du méfocolon tranfv rfal le long de l'artere
coligue moyenne.
L'épiploon
coligue efi une continuation de celui
dont nous venons de parler : elle efi conique,
&
fa
longueur efi variable : nous l'avons vue s't::r ndre
ju qu'au ccecum. Le feuillet anrérieur
&
le euillet
pofiér ieur de cet
épiploon
eft également une conti–
nuation de la tunique externe du colon, mais en
d eux lignes diffi' remes. Il eftboíTelé comme les deux
a utres
épiploons,
quand on le gonfle. Il paroir que
M.
Lieuraud en a parlé; mais il en dérive un feuillet
du m ' focolon. M. de Hall r l'a décrit &l'a fair graver
en meme tems .
Nou avons d ' ja parlé des petits
épiploons
coli-
q u
S
a
l'arti Le
CoLO. 'eft une d ' couverte de
. e fa le, renonvell ' e par Ruyfch.
L es arreres du perit
épiploon
naiífent de la grande
coronaire , de la perite & ,de l'hépatique ; Ies veines ,
de la veine-porre.
Les arteres du feuillet ant 'rieur de
répiploon
gaf–
t rocolique naiífent de la gaftroépiploique droite, de
la gaíhique gauche, de la gaíhoépiploique gauche ,
des vailfeaux de la rate & des vaiifeaux courts. On
a donné le nom d épiploiqne droire
&
gauche
a
la
plus grande branche de celles qui fortent de la gaf–
troépiplo1qne de l'un
&
de l'autre cotés.
Les arte res du feuillet pofr ' rieur naiífent encore
d es gafiroépiploiques, de que lque arte re de la ra te ,
d es aiífeaux du colon
~
e\
u duod ' num & de bra n–
c hes adipeufes. Les veines vont fe rendre
a
la fplé–
n ique ' a 1 ve ine-porte ,
a
la méfen térique.
Les veine de
l'épiploon
coliqne vie nnen t des vaif–
feaux du colon , de l'épiploique droite, de la duo–
d énale, de la méfentérique.
Tous e différens rroncs communiquent tres-fré–
q uemmen t entr'enx.
La colle qu on y injette paífe dans la graiífe dont
l es aiíreaux font accompagnés. On a abandonné les
vaiffeaux graiífeux différens des vaiffeaux ronges,
que Malpighí croyoi t avoir découverts,
&
qu'il a
r ' voqu
1
s
lu i-meme.
11
y
a des glandes
1
ymphatiques dans
1'épiploon
afirohépatique
&
dans le gafirocolique ; les uns
&
l es autres font plac ' s le long de l'attache de ces
épi–
ploons
a
l'ellomac. On a
Vll
quelqnes traces de_ vaif–
feaux lymphatiques dans
]'épiploon
gafirocohque ;
mai il ne faut pas fe hater de les admertre. ous
avon vu des r ' feaux tranfparens dans les intervalles
d es aiífeaux rouges , qui fe font trouv ' s n " tre que
d la <Yraifre.
. ·
I1
y
a quelques nerfs en petit nombre; auffi
l'épi–
ploon
n a-t-il que eu de entiment: le fang paro'lt
irculer av e beaucoup de lenteur: on ne le líe
pa ,
ron
ne craint aucune h ' morrhagie de la part
de fes arteres.
(H. G. D.)
PIP
MPE
TI A (
filujique d s anc.)
Voffius,
dan 1 inftitu tions po tiques, ra pporte qu on ap–
pelloit ainfi de chanfons faites pour de occafions
oit il
fi
lloit d la maanifi c nce.
(F. D. C.)
ÉPI R L
BA...
ME E
(/~tujique
des anc.)
nom que l on donnoit
a
la orde qui fe trou oit
Tome.
JI.
E
I
-5
fous a
projlJmbanom~ne.
•
qui r po doi ar
q uen .
a
notre
fol.
(
F. D
. )
IRE, (
ogr.2p>tt
. ) Les E hiti ns .... .. .
les mbrafien ....
Ltj
-les
th~
ten.s .....
1
s
Am–
bracjen . ( )
•
EPI
OP
T .... . .
L 1{¡
z
dans
cec
article
A lmatn
au lieu
d'
Alm n:.
§
É
I
O
E (
Poijie..)
C '
oit or· . nair ment,
au rappo rt d'Arifio e, un ou plutieurs cene
~r
e
' es
entre les chant du h ur
d~un
pie e d1am
i
;
en ffet ce terrne, dan fon tymologie d fign ce
qui efi mis
a
la fuite
d
un banr. Les an ienn
S
tra–
gé<.Ji
s
Grecques , de m me que les com 'dies, n
fiuenr au commencemen que l eh nt olemnel d'un
o
u
de pluú urs hreur . Dans
1
fui te on
iní~ra
une
a ion qu· 'roit r pr fenr
e
entre les hanrs, d'ot
elle eut le nom
d'¿pijod
.
Le modernes emend nt
par e terme, tout e qui
C·rr
a
remplir l'intervalle
d une a ion
1
pique ou dramatique , inrerrompue
ou fufpendue. Ainfi Homere, dan le fecond chant
de ll1iade , randis que les deu. arm es fe rangenr en
baraille , ne voulant pas s appefantir urce dera·l,
emploie ce tems nous dect ire toutes les r es na–
vales de Gre s;
&
dans le tro ifteme chanr, pen–
dant que 1
s
troupes rangées attendent 1arriv 'e de
Priam ,
&
pré parent les facrifices, le poere tranf–
porte fon leéleur
a
Troye,
&
luí fait connoirre
H lene. Ce font-la de vrais
ipifodes,
dans le fe ns
mod rne ; mais on donne encore le nom d
orne.me.nsipifodique.s ,
non-feulement en poéfie, mais auffi en
peinture '
a
cerrains acceífoires qui ne tiennent pas
elfentiellement au fujet principal.
Les
épijodes
détournent pour quelque t ems l'at–
tenrion de l'objet capital ,
&
produifenr par ce
moyen , des repos pour délaífer l'efprit, en lui pr ' ..
fentant des obj ts d'un autre ge nre , ou pour l'occu–
per aiUenrs, pendant qu'il fe paífe des événemens
qu'il ne
{;
roit pas poffible ou pas convenable de
l uí laiífer voir. es cas fe pr ' fentent fouvent dans
l'épopée
'
&
meme dans les drames dont l'atlion a
beaucoup
d'
' tendue,
&
qui efi fort compltqu e.
Pour que le r écit o u l'aélion ne foit pas fufpendue ,
l',éfifode
vient
a
propos r emplir le tems qui doit
s
couler.
Il
y
a encore un autre motif qui peut rendre les
é.pifod s
n ' cefiaires , c'efr lorfque deux {cenes tr ' s–
intéreífantes , mais d'un caratl-ere tout oppofé , fe
íuccéder0ienr immédiatement. Un
épifode
placé en–
tre ces deux {cenes' fen alors
a
difpofer infenfible–
menr l'efprit & ls cceur
a
ce paífage. C'eíl: ce qu'on
obferve auffi en mufique : le compofiteur, s'il n'y
eft néceffité par la nature du fujet , ne paífe jamais
d'un ton
a
un ton contraire ' fans placer
en tre
deux
quelques tons moyens qui, en affoiblilfant la fenfa–
tion du pr emier' préparent l'oreille
a
recevoir une
impreffion d'un genre d ifférent.
Au reíl:e, il n'efi: pas befoin d'obfcrver ici qu'il
y
a uroit de la mal-adreífe
a
choifir un
épifode
dont le
fujet fut t out-a-fai t étranger au fujet princjpal. II
faut au contraire qu il s'y rapporte exaélement,
&
q u'il foit amené bien
a
pro pos. L'
ripiJode
doit répon–
dre au caraélere général de l'enfemble , contribuer
au progres
&
a
la perfi B:ion de l'aél:ion principale,
o u du moins
y
r
1
pandre un certain jou r , contenir
des ' claircilfemens, qu'il n'eftt pas été convenable
d
y
faire entrer d'une autre maniere. Par ce moyen,
l'épifode
fe lie
ú
inrjmément au fond meme de 1ac–
tion, qu on ne pourroit l'en dé ra ber fans
ga
er l'ou–
vrage. (
C
t
arricl
eft
tiré
de la Théorie.
gént:raLe
des
ux-Arts de
J"vJ.
ULZER.)
§
ÉPITHETE,
(Artsdela parole..)
,efi:unter–
me ajour ' a celui qui contient l idée principale P.our
refireindre cerre idée en l'embelliífant , c'efi- -d1re,
en
y
joignant une
1
nergie e he ique.
uand par
r 1 mmm
















