
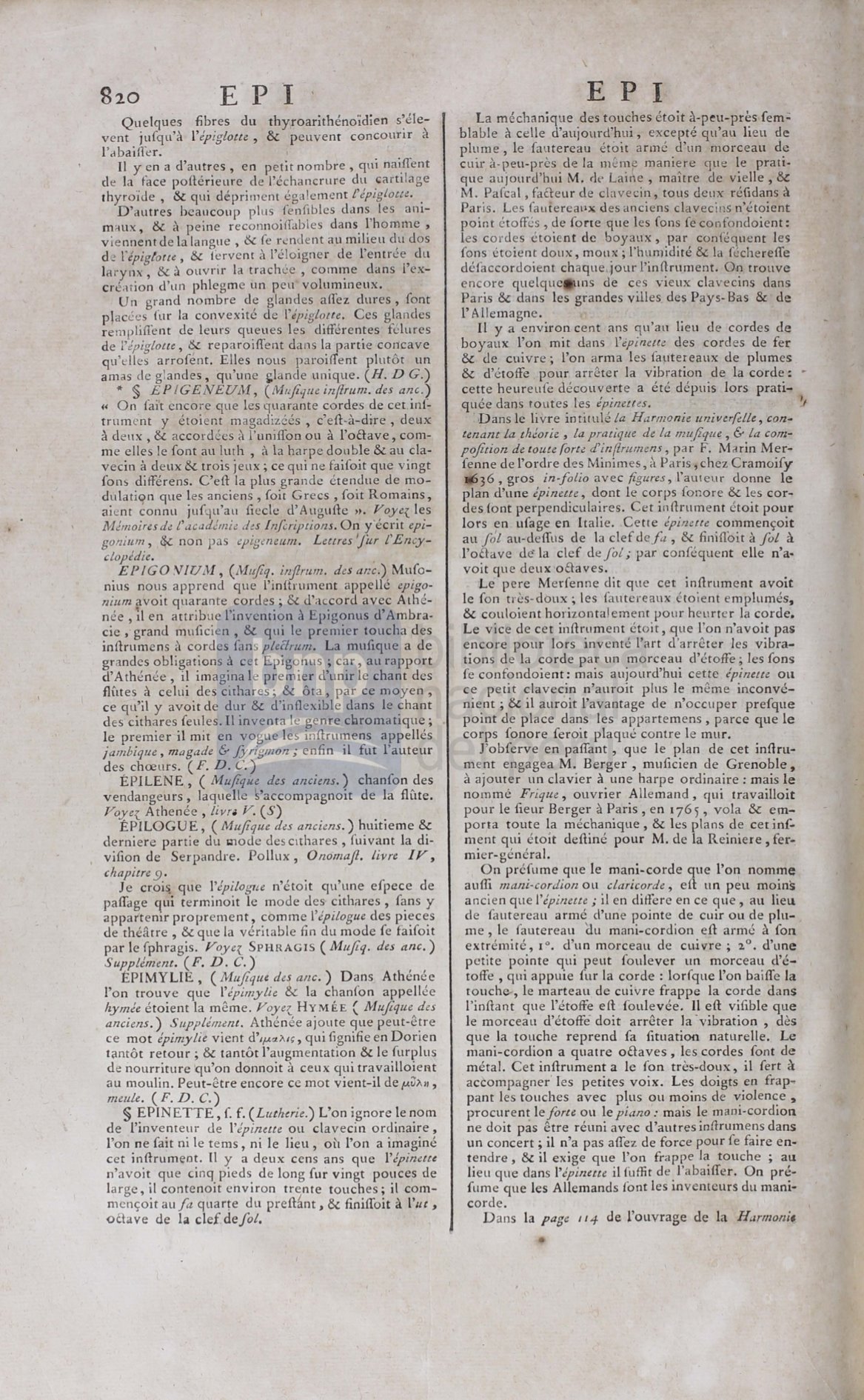
EPI
Quelques
:hbres du
thyroarithéno'idien s'éle–
vent jufqu'a
l'épiglotte'
&
peuvent concourir
a
l'ctbaifier.
Il y en a d'autres , en petit nombre, qui nai_«ent
de la face pofiérieure de Eéchancrure du cartllage
thyro!de ,
&
qui dépriment également
tépigLotte.
.
D'autres beauc·oup plus fenfibles dans les am–
m· ux'
&
a peine reconnoiífables dans.
~'homme
,
viennent de
la
langue,
&
fe
r
ndent au mtheu du dos
d
l"épigtotte'
&
íervent a l'éloigner de l'entrée du
larynx,
&
a
Ottvrir la trachée ,
COmr~e
dans i'ex–
cré~ ti on
d'un phlegme un peu volummeux.
Un grand nombre de glandes affez dures, font
p}acées
fnr
la convexité de
J'épigLotte.
Ces glandes
rempliífe nt de leurs queues les différentes félures
de
l'épiglotte ,
&
reparoiífent dans la partie corica ve
qu' Ues arrofént. Elles nous paroiífent plutot un
amas de glandes, qu'une glande unique.
(H. D G.)
*
§
EP IGE1VEUM ,
(
Mujique inflru.m. des anc..)
({ On_
fait encore que les quarante
co~des
de cet inf–
trument
y
étoient magadiz
1
és , c'eíl:-a-dire, deux
a
deux '
&
accord
1
es
a
l'uniífon ou
a
l'oétave' com–
me elles le font au lurh '
a
la harpe double
&
au cla–
vecin
a
deux
&
trois jeux; ce qui ne faifoit que vingt
fons différens. C'eíl: la plus grande étenclue de mo–
dulati(\>n que les anciens, foir Grecs , foit Romains,
aient connu jufqu'all íiecle d'
A
uguíle
H.
V
oye{
les
MJmoires de L'académie des lnfcriptions.
On y'écrit
epi–
gonium,
&
non pas
epigenettm. Lettres 'fur tEncy–
cLopédie.
EP!GO
VIULY,
(
~ujiq.
inftrum. des anc.)
Mufo–
nius nous apprend que l'infhument appellé
epigo–
niu.m
?VOÍt quarante cordes;
&
d'accord avec Athé–
née , il en attribue l'invention
a
Epigonus d'Ambra–
cie
,-
grand muíicien ,
&
qui le premier toucha d@s
iníl:rumens
a
corcles fans
pleélrum.
La muíique a de
grandes obligations a cet Epigonus ; car, au rapport
d'Athénée , il imagina le premier d'unir le chant des
flfttes a celui des cithares;
&
ota' par ce moyen'
ce qu'il y avoit de dur
&
d'inflexible dans le chant
des cithares feules. 11 inventa le gen re c.laromatique;
le premier il mit en vogue les iníl:rumens appellés
jambique, magade
&
JYrigmon;
enfin il fut l'auteur
des cbceurs.
(F. D. C.)
ÉPILENE, (
Mufiqu.e des anciens.)
chanfon des
vendangeurs, Iaquelle
~'accompagnoit
de la flute.
Voye{
Athenée,
Livra
V.
(S)
ÉPILOGUE, (
Mujique des anciens.)
huitieme
&
derniere partie du .mode des cnhares' fuivant la di–
vifion de Serpandre. Pollux,
Onomajl. livre
IY,
-chapitre
.9.
J
e
croi~
que
I'épiLogrte
n'étoit qu'une efpece de
paífage qui terminoit le mode des cithares , fans y
appat'tenir proprement, comme
l'épiLogue
despieces
de théatre,
&
que la véritable fin du mode fe faifoit
par le fphragis.
Voye{
SPHRAGIS (
Mujiq. des anc.)
SuppLément.
e
F.
D. C.)
ÉPIMYLIE,
e
lv!.ujique des anc.)
Dans Athénée
l'on trouve que
l'épi.mylie
&
la chanfon appellée
lzymée
étoient la meme.
Voyez
HYMÉE (
Mujique des
anciens.) SuppLémmt.
Athén
1
e ajoute que peut-etre
ce mot
épimyLie
vient
d't,
u.a.At~,
qui fignifie en Dorien
lflnto t
retour;
&
tantot l'augmentation
&
le furplus
de nourriture 'qu'on donnoit a ceux qui travailloient
a u moulin. Peut-etre encore ce mot vient-il de
p.'JAn,
made.
(F. D.
C.)
§
EPINETTE, f. f. (
Luth"ie.)
L'on ignore le nom
de l'inventeur de
l'épinute
ou clavecin ordinaire,
l'on ne fait ni le teros' ni le lieu' on l'on a imaginé
cet infirumeot.
n y
a deux cens ans que
l'épinette
n'avoit que cinq pieds de long fur vingt pouces de
large, il contenoit environ trente touches;
it
com–
mens:oit au
fa
quarre du
preíl:~nt,
&
finiífoit
a
l'llt,
oétave de la def de
fol.
EPI
la méchanique des touches étoit a-peu-pres fem;
blable
a
celle d'anjourd'hui' erxcepté qn'au lieu de
plume, le fantereau étoit armé d'un morceau de
cuir a-peu-pres de la mt!me maniere que le prati–
que aujourd'hui
M. de
Laine, maitre de vielle,
&
M.
Pafcal, faéleur de clavecin, tous deux réfidans
<\
Paris. Les fautereat•x des anciens clavecins n'étoient
point étoffés, de forre que les fons fe confondoient:
les cordes étoient
de
boyaux, par conféquent les
fons étoient doux, moux; l'humidíté
&
la féchereífe
cléfaccordoient chaque.jour l'infirument. On trouve
encore quelque uns de ces vieux davecins dans
París
&
dans les grandes villes des Pays-Bas
&
de
1'
Allemagne.
Il
y a environ cent ans qu'au lieu de cordes de
boyaux l'on mit dans
l'épinette
des cordes de fer
&
de cuivre; l'on arma les fautereaux de plumes
&
d'éto:ffe pcmr arreter la vibration de la corde:
cette heureufe décou verte a été dépuis lors prati-
G¡uée dans toutes les
épinettes.
!1
•Dans le livre intimlé
La Harmonie zmivcr{eLle, con·
tenant la théorie, La pratique de La mujic¡ue,
&
La com–
pojition de toute {orte d,in(lrumens,
par
F.
Marin Mer:.
fenne de l'ordre des
Mini
mes,
a
París,
e
hez Cramoi{
y
11636,
gros
in-folio
avec
figures,
l'auteur donne le
plan d'une
épinette,
dont le corps fonore
&
les cor–
des {ont perpendiculaires. Cet iníl:rument étoit pour
lors en ufage en Italie. Cette
épinette
commens:oit
a
u
fdl
au-deífus de la clef
deftt'
&
:hn1iloit a
fol
a
l'oétave de· la clef
de
foL;
par conféquent elle n'a·
voit que deux oétaves.
Le pere Merfenne dit que cet iníl:rume1H avoit
le fon tres-doux; les fautereaux étoient emplumés,
&
couloie
nt horizontalement pour heurter la corde,
. Le vice de
c.etinfi:rument étoit, que
l'~n
n'avoit pas
encore pour lors inventé l'art d 'a rreter
-les
vibra–
tions de la corde par un morceau d'étoffe; les fons
fe confondoíent: mais aujourd'hui cette
épinette
ou
ce petit clavecin n'auroit plus le meme inconvé–
ni~nt
;
&
il auroit l'avantage de n'occuper prefque
pomt de place dans · les appartemens, paree que le
corps fonore feroit plaqué contre le mur.
J'obferve en paífant , que le plan de cet inílru–
ment engagea M. Berger , muficien de Grenoble,
a
ajouter un clavier a une harpe ordinaire: mais le
nommé
Frique,
ouvrier Allemand, qui travailloit
pour le fieur Berger
a
Paris, en
176
5 , vola
&
ero–
porta toute la méchanique,
&
les plans de cet inf–
ment qui étoit deíl:iné pour M. de la Reiniere, fer–
mier-général.
On préfume que le mani-corde que l'on nomme
auffi
mani-cordion
o u
daricorde,
eíl: un peu moins
ancien que
l'épinette;
il en differe en ce que, au liea
de fautereau armé d'une pointe de cuir ou de plu–
me' le fautereau
Clu
mani-cordion eíl: armé
a
fon
extrémiré,
1°.
d'un morceau de cuivre;
2°.
d'une
perite p<;>inte qui peut foulever un morceau d'é–
toffe , qui appuie fur la corde : lorfque l'on baiífe la
touche.--, le marteau de cuivre frappe la corde dans
l'iníl:ant que l'étoffe eft foulevée. Il eft vifible que
le morceau d'étoffe doit arreter la "vibration ' des
que la touche reprend fa
íituation naturelle. Le
mani-cordion a quatre oétaves, les cordes font de
métal. Cet iníl:rument a le fon tres-doux, il fert
a
accomp gner' les perites voix. Les doigts en frap–
pant les touches avec plus ou moins de violence ,
procurent le
forte
ou le
piano:
mais le mani-cordion
ne doit pas etre réuni avec d'autres inll:rumens dans
un concert ; il n'a pas aífez de force pour fe faire en–
tendre,
&
il exige que l'on frappe la touche ; au
lieu que dans
l'épinette
il fuffit de l'abaiífer. On pré–
fume que les Allemands font les inventeurs du mani·
corde.
D ans la
page
11
;¡.
de l'oLtvrage de la
Harmo-ni1
















