
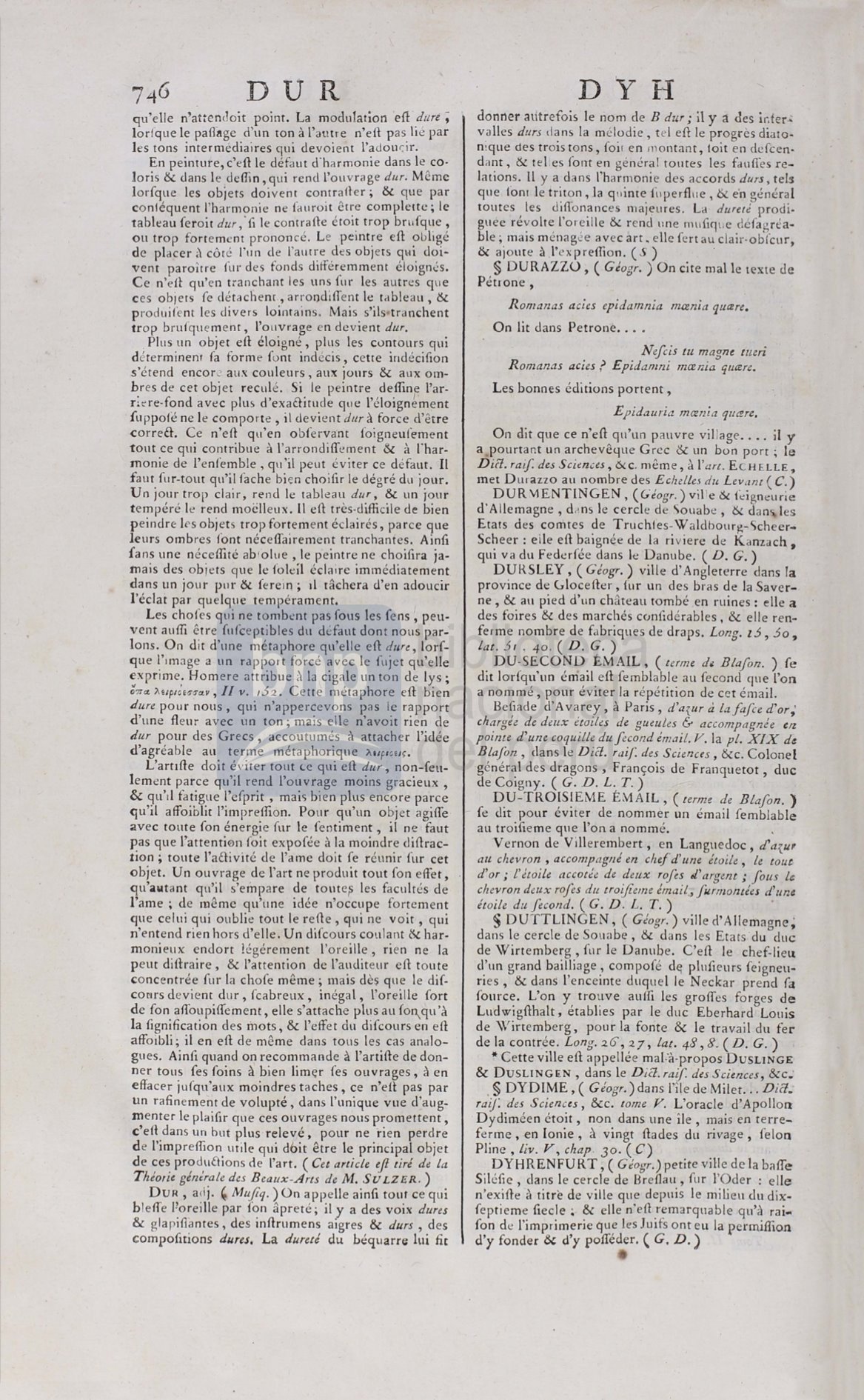
DUR
c::¡u'elle n'attenJoit point. La modulation eít
dtLre;
lorfque le paíllige d'un ton
a
l'at tre n'efi pas lié par
les tons intermédiaires
qui
devoient l'adou r: ir.
En peinrure, c'efi le défaut d'harmonie dans le CO·
loris
&
daos le deffin,qui rend l'ouvrage
dur.
Meme
lorfque les objets doivent conrraírer;
&
que par
coníéquent
l'harm~mie
ne fauroit
,et~e
complettc; le
tableau feroit
dur
ú le contrafie eto1t trop bn,fque,
ou
trop fortem
;t
prononcé. Le
peint~e
efi
?bli&é
de placer
a
COté
l'un de
l'aut~e ~eS
ObJets
~1:11. d~t
vent paroirre fur des fonds d1fferemment elo1gnes.
Ce n'eít qu'en trancharlt les uns
Íur
les aLltres que
ces objers fe détachenr., arroodiífent le tableau,
&
produifenr les divers lointains. Mais s'ils tram:hent
trop brufquement, l'ouvrage en devient
dur•
. Plus un objet eít éloigné,
plu~
les contours qui
dérerminent fa forme font ind ' cis, cetre indéciúon
s'érend encor:: aux couleurs, aux jonrs & aux om–
bres
de cet objet reculé. Si le peintre deffine l'ar–
r~ere-fond
avec
plu~
d'exaB:itude ql1e l'éloignkment
fuppofe ne le comporte' il devient
dar
a
force d'etre
correa. Ce n'efi qn'en obferva·nr
foigneufement
tour ce qui contribue a l'arrondiífement
&
a
l'har–
monie de l'enfemble, qu 'íl peut éviter ce défaut. Il
faut fur-tout qu'il fache bien choiúr le dégré du jour.
Un jour trop clair, rend le tablea u
dur,
& un jour
tempéré le rend moelleux. ll efi tres-difficile de bien
peindre les objets trop fortement éclairés, pare e que
leurs ombres íont néceífairement tranchantes. Ainfi
fans une néceffité ab •olue , le peintre ne choiúra ja–
rnais des objers que le foleíl éclaire immédiatement
dans un jour pnr
&
ferem; 1l
t~khera
d'en adoucir
l'éclar par quelque tempérament.
Les chofes qui ne tombent pas fous les fens
~
peu–
vent auffi etre fufceptibles du d ,faut dont nous par–
lons. On dit d'une métaphore qu'elle efi
dure,
lorf–
<jUe l'tmage a un rapport forcé avec le fujet qu'elle
exprime. Homere attribue
a
la cigale un ton de lys;
o71ct
A.~'P'¿eG"a-a..v,
JI
v.
d2.
Cette métaphore efi bien
dure
pour nous, qui n'appercevons pas le rapport
d'une fleur avec un ton; mais elle n'avoit ríen de
áur
pour des Grecs, accoutumés
a
attacher l'idée
d'agréable au
terme métaphorique
A.tJpt~,.~~.
L'artlÍle doit éviter tout c.e qui efi
dur,
non-feu–
lement paree qu'il rend l'ouvrage moins gracieux,
&
qu'tl fatigue l'efprit , mais bien plus encore paree
qu'il affoiblit l'impreffion. Pour qu'un objet agiífe
avec toute fon énergie fur le fentiment,
ii
ne faut
pas que
l'attenti~m
foit expofée a la moindre difirac–
tion; toute l'aB:ivité de l'ame doit fe réunir fur cet
objet. Un o uvrage de l'art ne produit tout fon effet,
qu'awtant qu'il s'empare de
toute~
les facultés de
l'ame ; de rneme qu'une idée n'occupe fortement
que celui qui oublie tout le refie, qui ne voit, qui
n'entend ríen hors d'elle. Un difcours coulant
&
har–
rnonieux endort légérement l'oreille, ríen ne la
peut difiraire,
&
l'attention de l'auditeur efi toute
concentrée fur la chofe meme; mais
de~
que le dif–
COI'Irs devient dur, fcabreux, inégal, l'oreille fort
de fon affoupiífement, elle s'attache plus au fon..qu'a
la úgnification des inots, & l'effet du difcours en efi
affoibli; il en efi de meme dans tous les cas analo–
gues. Ainfi quand on recommande
a
l'artifie de don–
ner tous fes foins
a
bien
lim~r
fes ouvrages'
a
en
effacer jufqn'aux moindres taches, ce n'eíl pas par
un rafinement de volupté, dans l'unique vue d'aug–
menter le plaiúr que ces ouvrages nous promettent,
c'eH dans un but plus relevé, pour ne ·rien perdre
de l'impreffion utile qui dóit etre le principal objet
de ces produétions de l'art. (
Cet article efltiré de la
Théorie générale des
B
eaux-Arts de
M.
S
u
LZ fiR.
)
DuR, adj.
~
Mujiq.)
On appelle ainú tour ce qui
b eífe Poreille par fon apreté; il
y
a des voix
dures
&
glariífantes, des infirumens aigres &
durs
,
des
compoíirions
dures.
La
dureté
du béquarre lui
fit
DYH
donner atitrefoi.s le nom de
B dur;
il
y
<1
des ir.ter;:
valles
durs
dans
la
mélodie, t el efi le progres diato–
nique des trois tons, foi 1en montanr, toit en dcfcen·
dant,
&
tel es font en général routes les fauífes re–
lations.
Il
y
a dans l'harmonie des accords
durs,
tels
que Iom le triton,
la
quinte fnperflue,
&
e·n général
toutes
les
diífonance majeures.
La
duretd
prodi–
guée révolte l'oreille
&
rend une muúqLe défagréa–
ble; mais ménagée a ve
e
art. elle fert
a
u clair-obfcur,
&
ajoure
a
l'ex preffion.
(S)
.
§
DURAZZO, (
Géogr.
)
On cite malle texte
de
Pétrone,
Romanas acies epidamnia mamia quare.
On lit dans Petrone.•••
Nefcis
tu
magne
meri
Romanas acies? Epidanmi ma.nia quare.
Les bonnes éditions portent,
E
pidauria manía. qruere.
On dit que ce n'efi qu'un pauvre vil lage.•.. il
y
a pourtant un archeveque Grec
&
un bon porr ; le
Difl. raif. des Scimces'
&c.
meme' al'
art.
ECHELLE,
met Durazzo au nombre des
Eclzelles du Levant
(C.)
DUR vtENTINGEN, (
G'éogr.)
vil 'e
&
feigneurie
d' Allemagne ,
d.~ ns
le cercle de Souabe,
&
dan fes
Etats des comres de Truchfes-\Valdbourg-5cheer–
Scheer : eile e!l: baigné:e de la riviere de Kanz.ach,
qui va du Federfée dans le Danube.
(D. G.)
DURSLEY, (
Géogr.)
ville d' Angleterre dans
Ta
province de Glocefier, fur un des bras de la Saver–
ne, & au pied d'un chatean tombé en ruines: elle a
des foires
&
des marchés c0núdérables,
&
elle ren–
ferme nombre de fabriques de draps.
Long.
z.J ,..Jo,
Lat.
..5t
•
40.
(D.G.)
DU-SECOND ÉMAIL, (
terme
d~
Blafon.
)
fe
dit lorfqn'un émail efi femblable au fecond que l'on
a nommé, pour éviter la répétirion de cet émail.
Beíiade d'Avarey' a París'
d'a{Ur
a
lafafce d'or,'
chargée de deux
étoit~s
de gueules
&
accompagnée
en
_pointe d'une coquille dufecond émail.
V.
la
pL. XIX
d~
Blafon,
dans le
Día.
raif. des Sciences,
&c. Colonel
général des dragons, Frans:ois de Franquetot, duc
de Coigny. (
G. D. L. T.)
DU-TROISlEME ÉMAIL, (
terme de BLafon.
)
fe dit pour éviter de nommer un émail femblable
au troiúeme qne l'on a nommé.
Vernon de Villerembert, en Languedoc,
d'azu'
a
u.
chevron
,
accompagné en chefd'une étoile
,
le tout
d'or
;
L'
étoile accotée de deux rofes ti'argent
;
fous le
chevron deux rofes du troijieme émai(, J¡¿rmontées
d'
une
étoile
du
fecond.
(
G.
D. L. T.
)
§
DUTTLINGEN, (
Géogr.)
vil le d' Allemagne;
dans le cere\ e de Souabe,
&
dans les Etats ·du duc
de \Virremberg, fur le Danube. C'efi le chef-lieu
d'un grand bailliage, compofé
d~
plufieurs feigneu–
ries, & dans l'enceinte duquel le Neckar prend fa
fource. L'on
y
trouve auffi les groífes forges de
Ludwigfihalt, établies par le duc Eberhard Louis
de \Vinemberg, pour la fonte & le travail du fel'"
de la contrée.
Long.
20,
27,
Lat. 48, 8. (D. G.)
*
Cette ville efi appellée mal:a-propos DusLINGE
&
DuSLINGEN, dans le
Diél.raif. desSciences, &c.:
. §
DYDIME, (
Géogr.)
dans
1
ile de Milet...
Diél.
raij: des Sciences,
&c.
tome
V.
L'oracle d'Apollort
Dydim.éen étoit, non dans une ile, mais en rerre–
ferme ' en lonie '
a
vingt fiades du rivage ' felon
Pline,
liv.
V,
chap .
30.
(.C)
DYHRENFURT, (
Géogr.)
petite ville de la baífe
Siléíie, dans le cercle de Breflau, fur l'Oder : elle
n'exifte
a
titre de ville que depuis le milieu du dix·
feptieme úecle ;.
&
elle n'efi .remarqnable
qu'a
rai..
fon de l'imprimerie que les
Jmfs
ont eu la
permiffian
d'y
fonder
& d'y
poíféder. (
G. D.)
















