
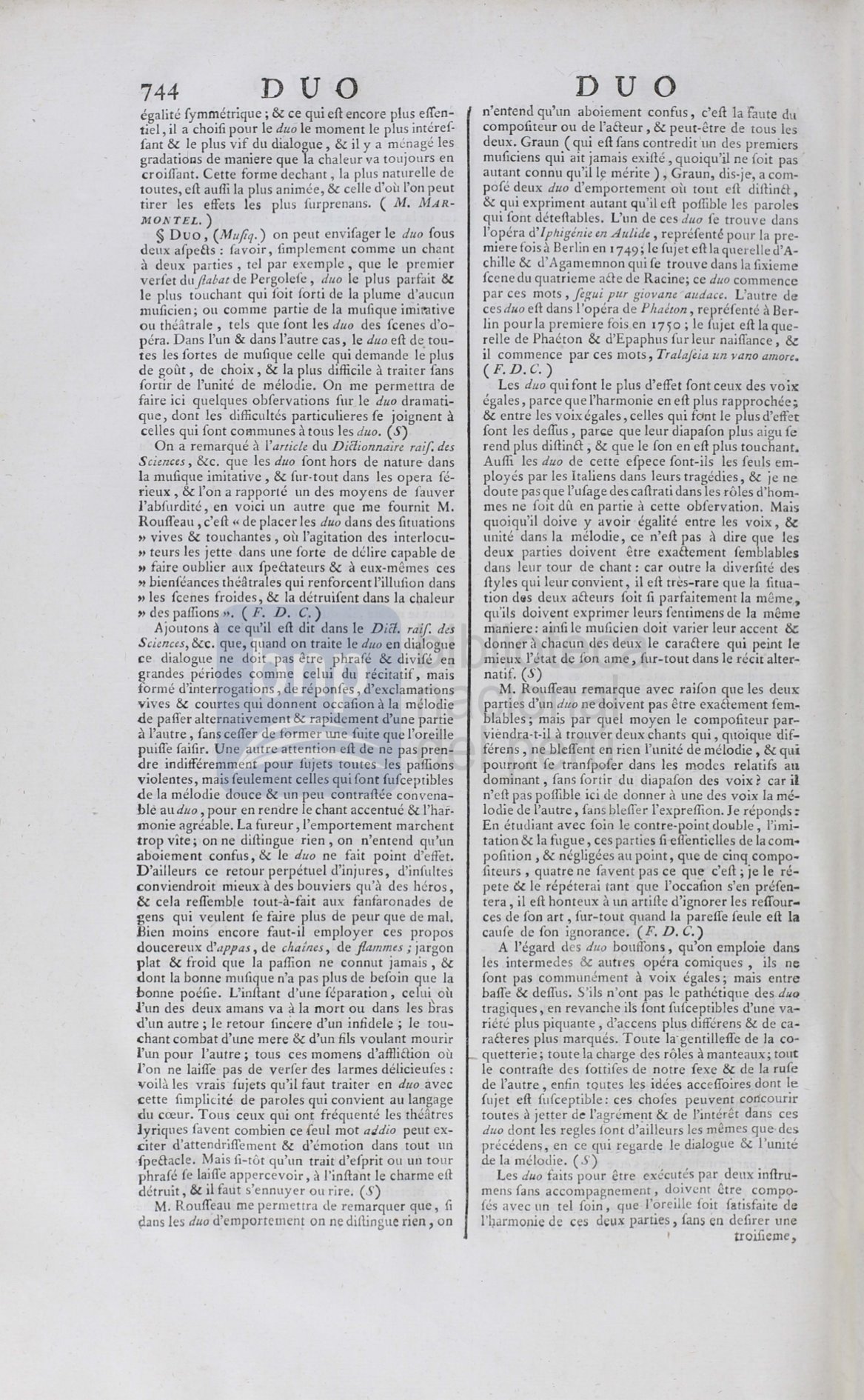
744
DUO
égalité fyrnmétrique;
&
ce qui efi encere plus eífen–
tiel, il a choifi pour le
duo
le mornent le plus intéref–
fant
&
le plus vif du dialogue,
&
il
y a ménagé les
gradatidns de maniere que la chaleur va toujours en
croiifant. Cette forme dechant , la plus naturelle de
toutes, efi auffi la plus animée,
&
celle d'oi1l'on peut
t irer les effers les plus furprenans.
e
M.
MAR–
MO.NTEL.)
§
Duo,
(lWufzq.)
on peut envifager le
duo
fous
deux afpeéls : favoir, fimplement comme un chane
a
deux parties ' tel par exemple' que le premier
verfet
dujlabat
de
Pe_rgo!~fe, ~uo
le plus parfait
&
le plus touchant qm fott fort1 de la plume d'aucun
muficien; ou cornme partie de la mufique imittative
ou théatrale, tels que font les
duo
des fcenes d'o–
péra. Dans l'un
&
dans l'autre
e
as, le
duo
efi de. ton–
tes les forres de mufique celle qui demande le plus
de gout ' de choix'
&
la plus difficile a traiter fans
forrir de l'unité de mélodie. On me permettra de
faire ici quelques obfervations fur le
duo
dra mari–
que) dont les difficultés particulieres fe joignent a
celles qui font communes a tous les
duo.
(S)
On a remarqué a l'
article
du
Diélionnaire raif. des
S ciences,
&c. que les
duo
font hors de nature- dans
la mufique imitative,
&
fur-tout dans les opera fé–
rieux,
&
l'on a rapporté un des moyens de fauver
l'abfurdité, en voici un autre que me fournit
M.
Rouífeau, c'efi
H
de placer les
duo
dans des firuations
)>
vives
&
touchantes, o1t l'agitation des interlocu–
)' teurs les jette dans une forte de délire capable de
" faire oublier aux fpeél:ateurs
&
a eux-memes ces
)!
bienféances théatrales qui renforcent l'illufion dans
" les fcenes froides,
&
la détruifent dans la chaleur
'>des paffions "·
e
F. D. C.)
Aíoutons
a
ce qu'il efi dit dans le
Diél. raif. des
Sciences,
&'C.
que, quand on traite le
drto
en dialogue
ce dialogue ne doit pas etre phrafé
&
divifé en
grandes périodes comme celui du récitatif, mais
formé d'interrogations, de réponfes, d'exclamations
vives
&
courtes qui donnent occaíion
a
la mélodie
de paífer alternativement
&
rapidement d'une partie
a
l'autre' fans ceífer de former W1e fuite que l'oreille
puiife faiíir. Une autre attention efi de ne pas pren–
dre indifféremment pour fujets toutes
les
paffions
violentes, mais feulement celles qui font fufceptibles
de la mélodie douce
&
un peu contrafiée con vena–
hle au
duo,
pour en rendre le chant accentué
&
l'haf–
monie agréable. La fureur, l'emportement marchent
trop vite; on ne difiingue rien, on n'enrend qu'un
aboiement confus,
&
le
duo
ne fait point d'effet.
D'ailleurs ce retour perpétuel d'injures, d'infultes
conviendroit mieux a des bouviers qu'a des héros'
&
cela reífemble tout-a-fait aux fanfaronades de
gens qui veulent fe faire plus de peur que de mal.
Bien moins encore faut-il employer ces propos
doucereux d'
appas,
de
chatnes,
de
flammes;
jargon
plat
&
froid que la paffion ne connut jamais ,
&
dont la bonne mufique n'a pas plus de befoin que la
bonne poéfie. L'infiant d'une féparation, celui oh
l'un des deux amans va
a
la morr ou dans les liras
d'un autre; le retour fincere d'un infidele ; le tou...
chant combar d'une mere
&
d'un fils voulant mourir
l'un pour l'autre; tous ces momens d'affiiaion ou
l'on ne laiífe pas de verfer des !armes délicieufes:
voila les vrais fujets qu'il faut traiter en
duo
avec
cette fimplicité de paroles qui convient au langage
cu creur. Tous ceux qui ont fréquenté les th latres
lyriqnes favent combien ce
[eul
mor
addio
peut ex–
citer d'attendriíl'ement
&
d'émotion dans tout un
fpeél:acle. Mais íi-tot qu'un trait d'efprit ou un tour
phrafé fe laiífe appercevoir'
a
l'infiant le charme efi
détruit,
&
il
faut s'ennuyer o u rire.
(S)
M.
Rouífeau me permetrra de remarquer que,
íi
{ians
les
duo
d'emportement
on
ne diilingtte rien, on
DUO
n'entend qu'un aboiement confus, c'efi la faute du
compofiteur ou de l'aél:eur,
&
peLtt-"tre de tous les
deux. Graun
e
qui efi fans contredit un des premiers
rnuficiens qui ait jamais exifié, quoiqu'il ne foit pas
autant connu
qu'ill~
mérite), Graun, dis-je a com–
pofé deux
duo
d'emportement
oit
tout eíl: difiinél:
&
qui expriment autant qu'il efi poffible les
parole~
qui font détefiables. L'un de ces
duo
fe trouve dans
l'opéra d'
lphigénie
en
Aulide,
repréfenté pour la pre–
mi.ere fois
~Berlín
en
1749
;_le fujet efila querelle d'
A–
chtlle
&
d Agamemnon
qm
fe trouve dans la fixieme
fcene du quatrieme aae de Racine; ce
duo
commence
par ces mots ,
fe~ui
pur giovane "audace.
L'autre de
ces
duo
efi dans
1
'opéra de
P
haéton,
repréfenté a Ber–
lin pourla premiere foi en
1750;
le fujet efi la que–
relle de Phaéron
&
d'Epaphus fur leur naiffance,
&
il commence par ces mots,
Tralajeia
un
vano amore.
e
F. D. C.)
Les
duo
qui font le plus d'effet font ceux des voix:
égales, paree que l'harmonie en efi plus rapprochée;
&
entre Ies_voixégales, celles qui fdnt le plus d'effet
font les deífus , paree que leur diapafon plus aigu fe
rend plus difiinél:,
&
que le fon en eít plus touchant.
Auffi les
duo
de certe efpece font-ils les feuls em–
ployés par les Italiens dans leurs tragédies,
&
je ne
doute pas que l'ufage des cafirati dans les roles d'hom–
mes ne foit dCt en partie
a
cette obfervation. Mais
quoiqu'il doive y avoir égalité entre les voix,
&
unité dans la mélodie' ce n'efi pas
a
dire que les
deux parties doivent etre exaél:emenc femblables
clans leur tour de chant: car outre la diverfité des
11yles qui leur convient, il efi tres-rare que
ta
fitua–
tion d&s deux aél:eurs foit fi parfaitement la meme,
qu'ils doivent exprimer leurs fenrimens de la meme
maniere: ainfi le muúcien doit varier leur accent
&
donner
a
chacun des deux le caraaere qui peint le
mieux l'état de fon ame, fur-tout dans le récir
alter~
natif.
(S)
M.
Rouífeau remarque avec raifon que les deux:
parties d'un
duo
ne doivent pas etre exaél:ement
fem~
blables; mai,s par quel moyen le cornpofiteur par–
viendra-t-il a trouver deux chants qui' qnoique dif–
férens, ne bleífent en ríen l'unité de mélodie ,
&
qui
pourront fe tranfpofer dans les modes relatifs au
dominant , fans fortir du diapafon des voix? car
il
n'efi pas poffible ici de donner a une des voix
la
mé–
lodie de l'autre, fans ble.ífer l'expreffion.
J
e
répon~s:
En érudiant avec foin le contre-point
do~>tble,
l'imi–
tation
&
la fugue, ces parties fi eífentielles de la com4
pofition ,
&
négligées a
u
point, que de cinq compo·
fiteurs , quatre ne favent pas ce
qu~
c'efi; je le ré–
pete
&
le répéterai tant que l'occafion s'en préfen...
tera, il efi honteux
a
un
artifie d'ignorer les reífour..
ces de fon art , fur-tout quand la pareífe feule efi
la
caufe
de
fon ignorance.
(F. D. C.)
A l'égard des
duo
bouffons, qu'on emploie dan.s
les intermedes
&
autres opéra comiques , ils ne
font pas commun
1
ment a voix égales; mais entre
baífe
&
deífus. S'ils n'ont pas le pathétique des
du.q
tragiques, en revanche ils font fufceptibles d'une va–
riét
1
plus piquante, d'accens plus différens
&
de ca–
raél:eres plus marqués. Toute Ia·gentilleífe de la co–
quetterie; toute la charge des roles a manteaux; tout
le comrafie des fottifes de notre fexe
&
de la rufe
de l'autre, enfin tQutes les idées acceífoires dont le
{ujet eít fufceptible: ces chofes peuvent coñcourir
tour es a jetter de l'agr
1
ment
&
de l'intéret dans ces
duo
dont les regles font d'ailleurs
les
memes que des
précédens, en ce qui regarde le dialogue
&
l'unité
de la mélodie.
(S)
Les
duo
faits pour etre exécutés par deux infiru–
mens fans accompagnement, doiv nt "tre compo–
{és
avec un tel foin, que l'orei le foit fatisfaite de
l'qarmonie de ces deux parties, fans
en
defirer une
troifieme,
















