
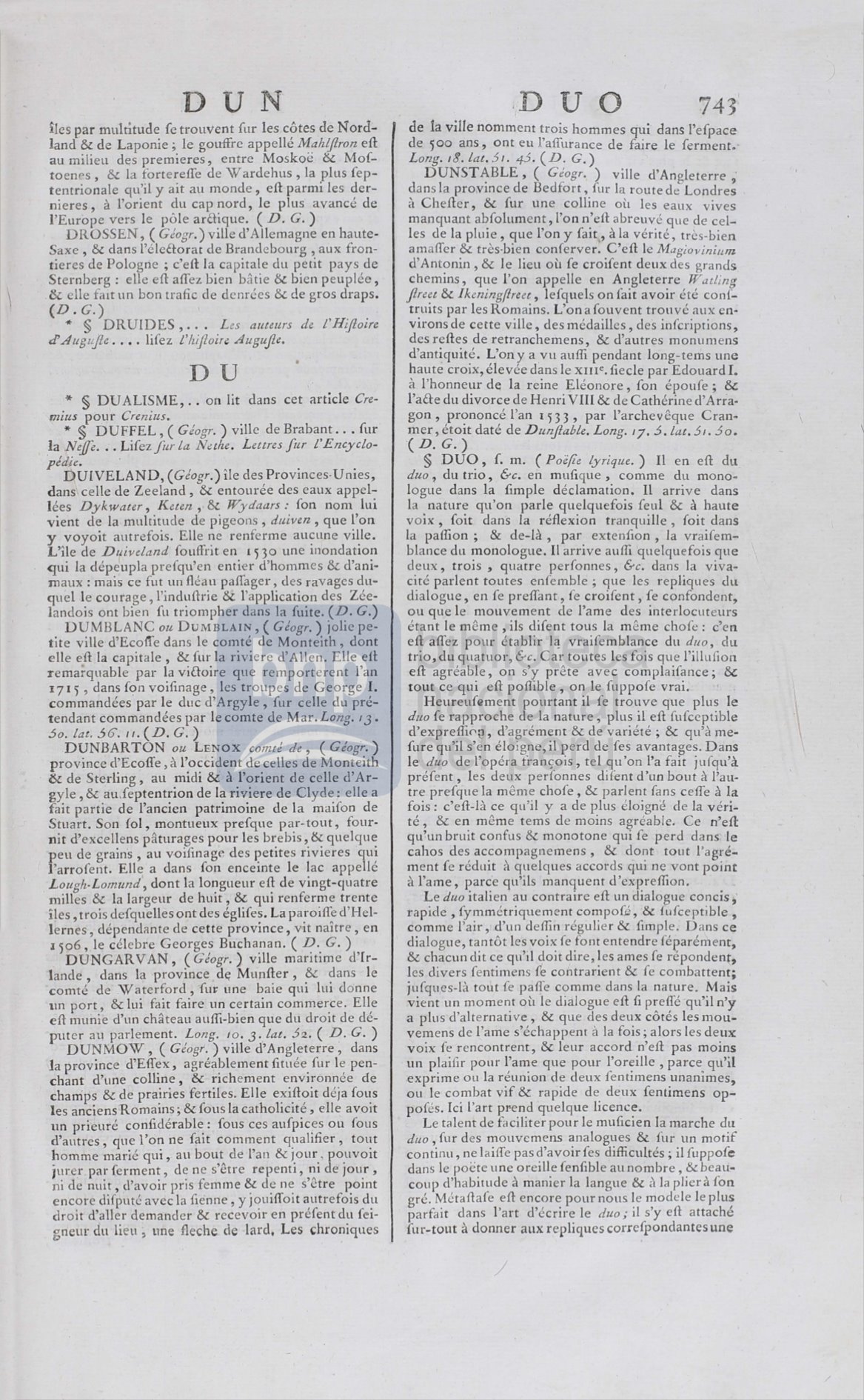
DUN
des par multitude fe tronvent fur les cotes de Nord–
land
&
de Laponie ; le goutfre appellé
Mahljlron
eft
au milieu des premieres, entre Moskoe
&
Mof–
toenPs,
&
la fortereífe de Wardehus, la plus fep–
tentrionale qu'il
y
ait au monde, eft parmi
les
der–
nieres, a l'orient du cap nord, le plus avancé de
l'Europe vers le póle arél:ique.
(D. G.)
DROSSEN, (
Géogr.)
ville d'Allemagne en haute–
Saxe,
&
daos l'éleél:orat de Brandebourg, aux fron–
tieres de Pologne ; c'eft la capitale du petit pays de
Sternberg : elle efr aífez bien batie
&
bien peuplée,
.&
elle fa1t un bon u·afic de denr
'es
&
de gros draps.
(D.G.)
• §
DRUIDES,.. .
L es auteurs de l'Hijloire
d'.Augujle .
•••
lifez
l'lzijloire Augujle.
DU
*
§
DUALISME, .. on lit dans cet article
Cre–
mius
po_ur
Crenius.
*
§
DUFFEL, (
Géogr.)
ville de Brabant. .• fur
_la,
J.!effe·
..
Lifez
fur la Nethe. Lettres fur l'Encyclo-
ped¡e.
·
DUlVELAND,
(Géogr.)
ile des Provinces-Unies,
dans .celle de Zeeland,
&
entourée des eaux appel–
lées
Dykwater, Keten
,
&
Wydaars :
fon nom luí
vient de la mulritude de pigeons,
duiven,
que l'on
y
voyoit autrefois. Elle ne renferme aucune ville.
L'ile de
Duivdand
fouffrit en r 5
30
une inondation
qui la dépeupla prefqu'en entier d'hommes
&
d'ani–
rnaux: mais ce fut un fléau paffager, des ravages du–
quelle courage, l'induílrie
&
l'application des Zée–
landois ont bien fu triompher daos la fuite.
(D.G.)
DUMBLANC
ou
DuMBLAIN, (
Géogr.)
jolie pe–
tite ville d'Ecot"fe dans le comté de Monteith, dont
elle eíl la capitale,
&
fur la riviere d'Allen. Elle eH
remarquable par la viétoire que remporterent l'an
1715, dans
f<;m
voiíinage, les troupes de George
l.
commandées par le duc d'Argyle, fur celle du pré–
tendant commandées par le comte de Mar.
Long.
'3.
.6o. lat.
.56.
11.
(D.G.)
DUNBARTON
ou
LENOX
comté de'
e
Géogr.)
province d'Ecoífe, a l'occident de celles de Monteith
&
de Sterling, au midi
&
a
l'orient de celle d'Ar–
gyle,
&
auJeptentrion de la riviere de Clyde; elle a
fait partie de l'ancien patrimoine de la maifon de
Stuart. Son {ol, montueux prefque par-tout, four–
nit d'excellens paturages pour les brebis,
&
quelque
peu de grain's, au voifinage des petites rivieres qui
farrofent. Elle a dans fon enceinte le Jac appellé
Lough-Lomund,
dont la longueur eíl de vingt-quatre
milles
&
la largeur de huit,
&
qui renferme trente
iles, trois defquelles ont des églifes. La paroiffe d'Hel–
lernes, dépendante de cette provínce, vit naitre, en
1
506, le célebre Georges Buchanan. (
D. G.
)
DUNGARVAN, (
Géogr.)
ville maritime d'fr–
lande , dans la province
d~
Munfrer ,
&
dans le
comté de Waterford,
1m=
une baie qui lui donne
un port,
&
lui fait faire un certain commerce. Elle
efi murlie d'un chatean auffi-bien que du droit de dé–
puter au parlement.
Long.
10.
3.
lat.
.52. (
D.G.
)
DUNMO\V, (
Géogr.)
ville d'Angleterre, dans
la province d'Eifex, agréablement fituée fur le pen–
chant d'une colline ,
&
richement environnée de
charrips
&
de pra_iries fertiles. Elle
e?'
i.íl~>it
déja
fot~s
les anciens Rornams;
&
fous la cathohClte, elle av01t
un prieuré confidérable: fous ces aufpices o u fous
d'autres, que l'on ne fait comment qualifier, tout
homme marié qui, au bout de l'an
&
jour , pouvoit
jure.r par ferment, de ne s'etre repenti, ni de jour,
ni de nuit,
~'avoir
pris fernme
&
de ne s'etre point
encore difputé avec la úenne,
y
jouiífoit autrefois du
droit d'aller demander
&
recevoir en préfentdu fei–
gneur du lieu ; une fleche de lard, Les chroniques
.n
u o
743
de
la
ville nomment trois homrnes qui dans l'efpace
de 500 ans, ont eu l'aífurance de faire le ferment.
Long. J8.lat.5T. 45. (D.G.)
DUNSTABLE, (
Géogr.
)
ville d'Angleterre
dans la provinee de Bedforr, fur la route de Londre;
a
Chefier'
&
fur une colline
Oll
les eaux vives
manquant abfolument, l'on n'efr abreuvé que de cel–
les de la pluie' que l'on
y
fait' a la vérité, tres-bien
amaífer
&
tres-bien conferver. C'eft le
Magiovinium
d'Ant?nin,
&
le lieu
Otl
fe croifent deux des grands
chemms, que l'on appelle en Angleterre
Watling
jlreet
&
Ikeningflreet,
lefquels on fait avoir été conf-
truits par les Romains. L'on a fouvent trou
vé
aux en–
virons de cette ville, des médailles, des infcriprions,
des refies de retranchemens,
&
d'autres monumens
d'antiquité. L'on
y
a vu auffi pendant long-tems une
haute croix, élevée dans le
XIII
e.
fiecle par Edouard I.
a
l'honneur de la reine Eléonore, fon époufe ;
&
l'aél:e du divorce de Henri VIII
&
de Cathérine d'Arra·
gon, prononcé l'an
1
53 3 , par l'archeveque Crana
mer, étoit daté de
Dunjlable. Long.
1
7·
.5.lat. 51 . .5o.
'(D.G.)
§
DUO, f. m.
(
Poefie
lyrique.
)
I1 en eíl du
duo,
du trio,
&c.
en muíique, comme du mono–
logue dans la fimple déclamation. Il arrive dans
la nature qu'on parle quelquefois feul
&
a
haute
voix , foit dans la réflexion tranquille , foit dans
la paffion ;
&
de-la , par extenfion , la vraifem–
blance du monologue.
Il
arrive auffi quelquefois que
deux, trois , quatre perfonnes,
&c.
daos la viva·
c~té
parlent toutes enfemble; que les repliques du
dtalogue, en fe preffant, fe croifent, fe cQnfondent,
ou que le mouvement de !'ame des interlocuteurs
étant le meme 'ils difent tous la meme chofe: c'en
eíl: affez pour établir lé! vraifemblance du
duo,
du
trio,du quatuor,
&c.
Car toutes les fois que l'illufion
eft agréable, on s'y prete ave e complaifance;
&
tout ce qui efi poffible , on le fuppofe vrai.
Heureufement pourtant il fe trouve que plus le
duo
fe rapproche de la nature, plus il eft fufccptible
d'expreÍÚNJ, d'agrémenr
&
de variété;
&
qu'a me·
fure qu'il s'en éloigne, il perd de fes avantages. Dans
le
duo
de l'opéra frans:ois, tel qu'on l'a fait jufqu'a
préfent' les deux perfonnes difent d 'un bout
a
l'au–
tre prefque la meme chofe'
&
parlent fans ceífe
a
la
fois: c'efi-la ce qu'il
y
a de plus éloigné de la véri–
té,
&
en meme tems de moins agréable. Ce n'eft
qu'un bruit confus
&
monotone qui fe perd dans le
cahos des accompagnemens,
&
dont tout l'agré–
ment fe réduit
a
quelques accords qui ne vont poínt
a
l'ame' paree qu'ils manquent d' xpreffion.
Le
duo
italien au contraire eft un dialogue concis;
rapide, fymmérriquemenr
compof~,
&
fufceptible,
comme l'air, d'un deffin régulier
&
Úmple. Daos ce
dialogue, tantót les voix fe font entendre féparément,
&
chacun dit ce qu'il doit dire, les ames fe
réponden~,
les divers fentimens
fe
contrarient
&
fe combattent;
jufques-la tout fe paífe comme dans la nature. Mais
vient un moment o1r le dialogue eíl fi preífé qu'il n'y
a plus d'alternative'
&
que des deux corés les mou–
vernens de l'ame s'échappenr
a
la fois; alors les deux
voix fe rencontrent,
&
leur accord n'eft pas moins
un plaifir pour l'ame que pour l'oreille , paree qu'il
exprime ou la réunion de deux fentimens unanimes,
ou le combat vif
&
rapide de deux fentimens op–
pofés. Ici l'art pr-end quelque licence.
Le talent de faciliter pour le muúcien la marche du
duo
,
fur des mouvemens analogues
&
fur un motif
contintt, ne laiífe pas d'avoir fes difficultés; il fuppofe
dans le poere une oreille fenfible au nombre,
&
beau..
conp d'habitude a manier la langue
&
a
la plieni fon
gré. Métafrafe eíl encore pour nous le modele
le
plus
parfait daos l'art d'écrire le
duo;
il s'y eíl: attaché
fur-tout a donner aux repliques correfpondantesune
/
















