
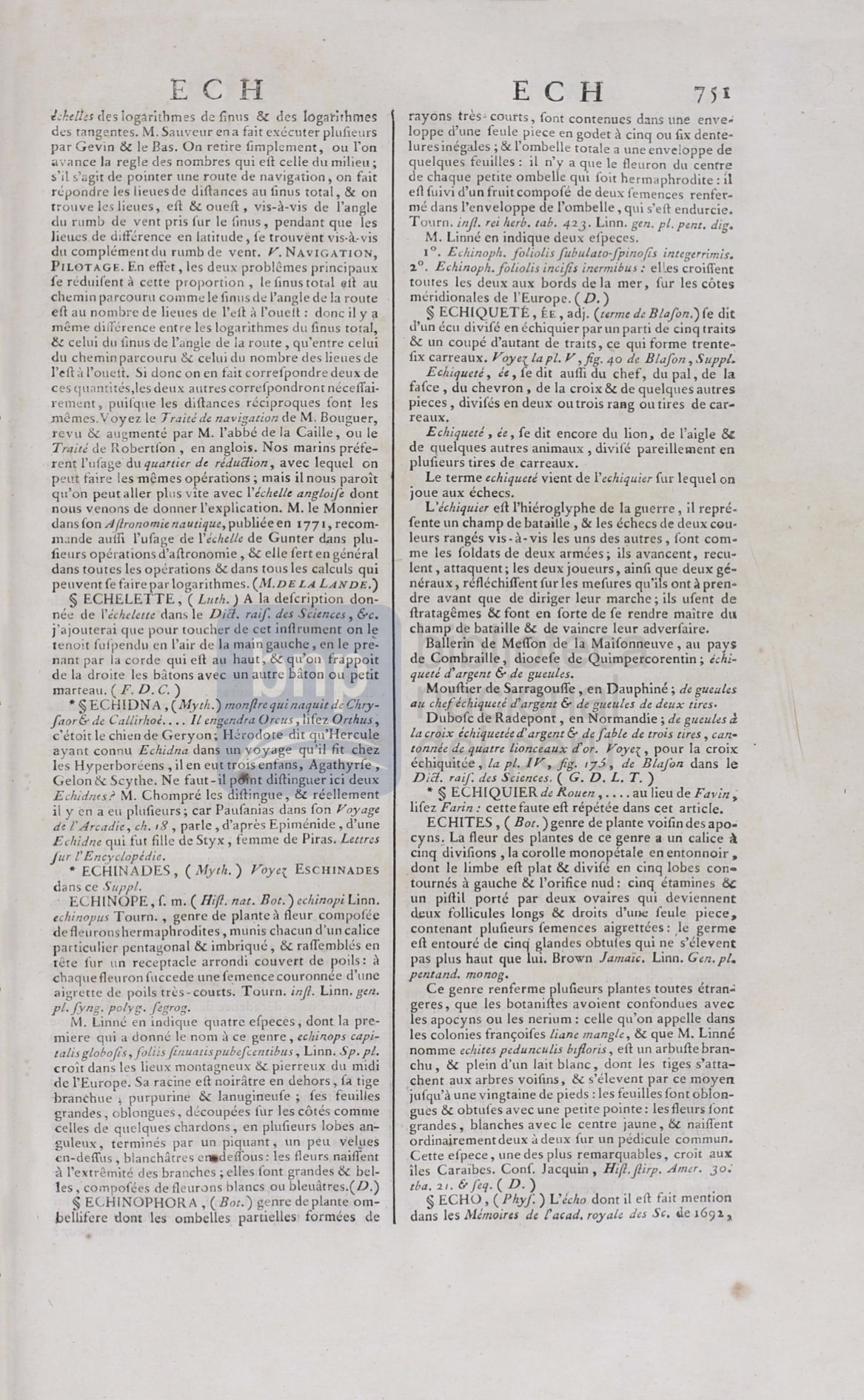
ECH
J.:hdles
des Iogarirbmes de finus
&
des Iogatirhrnes
des
tangentes.
M.
Sauveur en
a
fait exécuter plufieurs
par Gevio
&
le Bas. On retire fimplcmeot, ou l'on
a vance
la
regle des nombres qui efr celle du milieu;
s'il
s~agit
de poinrer une route de navigation; on fait
répondre les lieues de diíl:ances au finus total,
&
on
trouve les lieues, efr
&
oueft, vis-a-vis de l'aogle
du rumb de vent pris fur le finus, pendant que les
lieues de
diffi'
rence en Iatitude, fe trouvent vis-a-vis
du complérnentdu rumb de venr.
V.
NAviGATION,
PIL0TAGE. En efl"et, les deux problemes principaux
fe réduifent a cette proportion , le únus total
~H
a
u
chemin parcouru commele finus de l'angle de la route
eíl: au nombre de lienes de l'dl:
a
l'oueil; done il
y
a
meme diíférence
en~re
les logarithmes du :íinus toral,
&
celni du1inus de l'angle de la route, qu'entre celui
du chemin parcouru
&
celui du nombre des lieues de
l'eíl:
a
l'ouefl:. i done on en fait correfpondre deux de
ces qnanrités,les deux autres correfpondront néceífai–
rement, puifqne les diíl:ances réciproques font les
.me
mes. Voyez le
Traité de navigation
de
M.
Bouguer,
revu
&
augmenté par
M.
l'abbé de la Caitle, ou le
.Traité
ele Robertfon, en anglois. Nos marins préfe–
rent l'ufage·duquartier
d(. réduaion,
avec lequel on
peut faire les memes opérations; mais
il
nous paroit
qn'on peut aller plus vite avec
l'échelle angloife
dont
nous venons de donner l'explication. M. le Monnier
daos fon
A
Jlronomienautique.,
publiée en
1771,
recom–
mande aufli l'ufage de
l'échelle
de Gunter dpns plu–
fieurs opérations d'ailronomie,
&
eJle fert en général
daos toutes les opérations
&
daos tous les calculs qui
peuventfefaírepar logarithmes.
(M.DELA
LANDE.)
§
ECHELETTE, (
Luth.)
A
la defcription don–
née de
l'échelette
daos le
Dja. raif. des Sciences, &c.
j'aj outerai que pour roucher de cet inílrument on le
tenoit fufpendu en l'air de la main gauche, en le pre':.
nant par
la
corde qui efi au haut,
&
qu'on frappoit
de la droite les batons avec un autre baton ou petit
marteau.
(F. D. C.)
*
§
ECI:-HDN
A, (
lrfyth.) monflre quinaquit de Chry–
faor& de CaLLirhoé.... lL engendra Orcus,
lifez
Orihus;
c'étoit le chien de Geryon;
H~rodote
dit qu'Hercule
ayant con nu
Echidna
dans un voyage qu'il fit chez
les Hyperboréens, il en eut troís enfans, Agathyrfe,
Gelon
&
Scyrhe.
N
e faut-il p nt diíl:inguer ici deux
Ecfúdms?
M.
Chompré les diftingue,
&
réellement
il
y
en a eu pluftenrs; car Paufanias daos fon
Voyage
de
l'Arcadie, ch.
,g,
parle, d'apres Epiménide, d'une
Ecfzidne
qui fut fille de Styx, femme de Piras.
Lettres
Jur
l'
Encyclopédie.
*
ECHlNADES, (
lvfytlz.) Voyez
EscHINADES
dans ce
Suppl.
_
·
· ECHlNOPE,
(.
m. (
Híjl.
nat. Bot.) echinopi
Linn.
edzinopus
Tourn. , genre de
pla~te
a
fleur compofée
defleurons hermaphrodites, munis chacun d'un calice
particulier pentagonal
&
imbriqué,
&
raífemblés en
t ete fur un receptacle arrondi couvert de poils:
a
chaquef1euron fuccede une
f~men~e
couronnée d'une
aigrette de. poils tres -coutts-. Tourn.
infl.
Linn.
gen.
pl.fyng. polyg. .fegrog.
M.
Linné
en
indique quatre efpeces, dont la pre–
miere qpi
a
donné le noma ce genre'
echinops capi–
talis glohojis, foliis jinuatispubefcentibus,
Linn.
S
p. pl.
croit dan les líeux montagneux
&
pierreux du midi
de l'Europe. Sa racine eft noiratre en dehors, fa tige
hr:anthue , purpurine
&
lanugineufe ; fes feuilles
grandes' oblongues' découpées fur les cotés comme
celles de quelques chardons, en plufteurs lobes an–
guleux, terminés par un piquant, un pe
u.
velues
en-deífus, blanchatres e deífous: les fleurs naiífent
a
l'exrremité des branches; elles font grandes
&
bel–
les; compofées de f1eur0ns blancs ou bleuatres.e
D.)
§ EC..HTNOPHORA , e
Bot.)
genre de plante om–
bellifcre dont les ombelles partielles formées de
ECH
7
5
t
rayons tres : courts, font contenues dans une enve•
lopp~
d:une fe ule,piece en godet
a
cinq ou íix dente..
luresiOegales_;
&
1
o~b~lle
totale a une enve!oppe
de
quelques femlles: 1l n
y
a que le fleuron du cenrre
de chaque petite ombelle qui foit hermaphrodite:
a
eíl fuivi d'un fruit compofé de deux femences renfer–
mé daos l'enveloppe de l'ombelle, qui s eíl: endurcie..
T ourn.
injl. rei herb. tab.
423.
Linn.
gen. pl. pent. dig..
M. Linné en indique deux efpeces.
I
0
•
Echinoph. foliolis fubulato·fpinojis integerrimis.
2
°.
Echinoph. foliolis incijis inermibus:
elles croiffent
toures les deux aux bords de la mer' fur les cotes
méridionales de l'Europe. e
D.)
§
ECHlQUETÉ,
ÉE,
adj.
(urme de Blafon.)
Ce
dit
d'un écu divifé en échiquier par
un
parti de cinq traits
&
un coupé d'autant de traits,
~e
qui forme trente..
flx carreaux.
Voyez la
pl. Y ,fig.
40
de Blafon, Suppl.
Echiqueté, ée,
fe dit auffi du chef, du pal, de
la
fafce, du chevron, de la croix
&
de quelques atltres
pieces , divifés en deux o
u
trois raag o
u
tires de car–
reaux,
Echiqueté, ée,
fe dit encore du lion, de l'aigle
&
de qnelques autres animanx, divifé pareillement en
plufleurs tires de carreaux.
Le terme
echiqueté
vient de
l'e,hiquier
fur lequel on
joue aux échecs.
L'échiquier
eft l'hiéroglyphe de la guerre,
il
repré–
fente un champ de batai1le,
&
les échecs de deux cGu·
leurs rangés vis-
a-
vis les uns des a
u
tres, font com–
me les foldats de deux armées; ils avancent, recu–
lent, attaquent; les deux joueurs, ain:íi que deux
gé–
néraux' réfléchiífentfur les mefures qu'ils ont
a
pren–
dre avant que de diriger leur marche; ils ufent
de
ftratagemes
&
font en forte de fe rendre maitre dtl
champ de bataille
&
de vaincre leur adverfaire.
Ballerin de Meífon de la Maifonneuve , au pays
de Combraille, diocefe de Quimpercorentin;
échi–
queté d'argent
&
de gueules.
Moufiier de Sarragouífe, en Dauphiné;
de gueu.les
au
cheféchiqueté
d!
argent
&
de gueules de deux tires.
Dubofc de Radepont, en Normandie;
de gueules
J
la
croix échiquetée d'argent
&
de fahü de trois tires, can•
tonnée de quatre lionceaux d'or. Yoye'{,
pour la croix:
éc hiquitée ,
la pl. 1
Y,
fig. '7
.5
,
de
B lafon
dans
le
DiCl.
raij: des Sciences.
(
G.
D.
L. T.
)
*
§
ECHlQUIER
de Roum, •••.
au lieu de
Favin;
lifez
Farin:
cette faute eft répétée daos cet article.
ECHITES, (
Bot.)
genre de plante voifin des apo•
cyns: La fleur des plantes de ce genre
a
un calice
e\
cinq diviftons, la corolle monopétale en entonnoir,
dont le limbe efr plat
&
divifé en cinq lobes con•
tournés a gauche
&
l'orifice nud: cinq étamines
&
un pifiil porté par deux ovaires qui deviennent
d.eux follicules longs
&
droits d'une feule pie
ce,
contenant plufieurs femences aigrettées:
)e
germe
efi entouré de cinc¡ glandes obtufes qui ne s'élevent
pas plus haut que lui. Brown
Jamaic.
Linn.
Gen. pl.
pentand. monog.
Ce genre renferme plufi.eurs plantes toutes étran.;
geres, que les botaniíl:es avoient confondues avec
les apocyns ou les nerium: celle qu'on appelle dans
les colonies frans:oifes
liane mangLe,
&
que
M.
Linné
nornme
echites pedunculis hifloris,
eíl: un arbuile bran–
chu,
&
plein d•un lait blanc, dont les tiges s'atta–
chent aux arbres voiíins,
&
s'élevent par ce moyen
jufqu'a une vingtaine de pieds: les feuilles font oblon–
gues
&
obtufes avec une perite pointe: lesfleurs font
grandes, blanches avec le centre jaune,
&
naiffent
ordinairementdeux
a
deux fur un pédicule commun.
Cette efpece, une des plus remarquables, croit aux
iles Cara1bes. Conf. Jacquin,
Hifl.Jlirp. Amer.
Jo-.:
tba.
21.
&
feq. (D.)
§ECHO, e
Phyf) L'écho
dont il eíl: fait mention
dans les
IY!émoires
de
tacad, royale des Se.
de
1691.,
















