
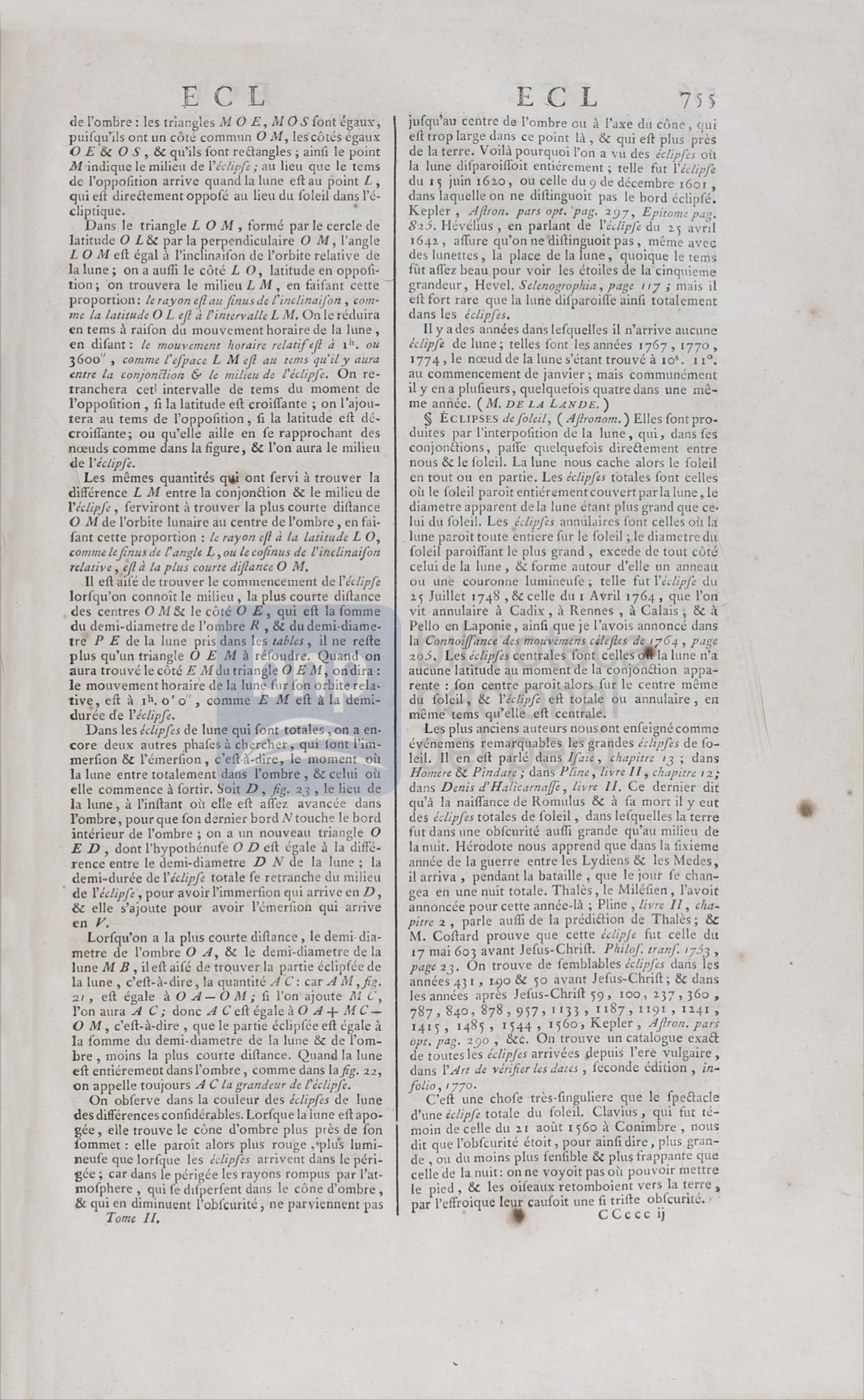
ECL
de l'ombre: les triangles
M O E,
!vi
O S
font égaux,
puifqu'ils ont un coté commun
O M,
les cotés égaux
O E
&
O
S
,
&
qu'ils font reél:angles; ainfi le point
M
indique le milieu de
l'éclipfe;
au lieu que le tems
de l'oppofition arrive quand la lune efr au point
L,
qui efi direél:ement oppofé au lieu du foleil dans l'é–
diptique.
Dans le triangle
L O
M:~
formé par le cercle de
latitude
O L
&
par la perpendiculaire
O M,
l'angle
LO M
eft égal a l'inclinaifon de l'orbitc relative de
la lune; on a auili le coté
L O,
latitude en oppoíi–
tion; on trouvera le milieu
L M,
en faifant cette
proportion:
le rayon
eJl
au jimts de L'inclinaifon, com–
me la latitude
O L
ejl
a
l'
interyalle
L M .
On le réduira
en tems
a
raifon du rnouvement horaire de la !une,
en difanr:
le mouyement horaire relatif
eft
a
1h.
ou
36oo"
:~
comme tifpace
L M
ejl
au tems qu'il
y
aura
entre la conjonaion
&
le milieu de L'éclipfe.
On re–
tranchera cetl intervalle de tems du rnoment de
l'oppofition, fila latitucle efr croiífante ; on l'ajou–
tera au tems de l'oppoíition, fi la latitude efi
dé~
croiífante; ou qu'elle aille en fe rapprochant des
nreuds comme dans
la
figure,
&
l'on aura le rnilieu
de
l'éclipfe.
Les memes quantités q
i
ont fervi a trouver 1a
cifférence
L M
entre la conjonél:ion
&
le rnilieu de
l'éclipfe'
fervitont a trouver la plus courte diílance
O M
de l'orbite lunaire au centre de l'ornbre, en fai–
fant cette proportion :
le rayon efl
a
la latitude
L
O,
comme lejinus de l'angle
~,
ou le cojinus de
l'
itzclinaifon
l'elatiye,
eJ!
a
la plus courte diflance
O M.
Il
efi aifé de trouver le commencernent de
1'
éclipfe
lorfqu'on connoit le milieu, la plus courte difiance
des centres
O M
&
le
coté
O E,
qui efi la fomme
du demi-diametre de l'ombre
R
,
&
du demi-diame–
tre
P E
de la lune pris dans les
tables,
il ne refie
plus qu'un triangle
O E M
a
réfoudre. Quand on
aura tronvé le coté
E M
du triangle
O E
M,
on dira:
le mouvement horair'e de la !une fur fon orbite rela–
tive, eft
a
¡h.
o'
0
11
,
comme
E M
efr
a
la. demi–
durée de
l'éclipfe.
Dans les
éclipfes
de lune qui font totales, on a en–
core deux autres ,phafes
a
chercher' qui font l'im–
merfion
&
l'émerfion, c'efi-a-dire, le moment ol.t
la lune entre totalement dans l'ombre ,
&
celui
Otl
elle commence
a
forrir. Soit
D, jig.
23
,
le lieu de
la !une,
a
l'infiant
Olt
elle efi aífez avancée dans
l'ombre, pour que fon dernier bord
N
touche le bord
intérieur de l'ombre ; on a un nouveau triangle
O
E D
,
dont l'hypothénufe
O D
efi égale
a
la diffé-
- rence entre le demi-diametre
D N
de la lune ;
la
demi~durée
de
1'
éclipfe
totale fe retranche
du
mili
en
' de
l'éclipfe,
pour avoir l'immeríion qui arrive en
D,
&
elle s'ajoute pour avoir l'émeríion qui arrive
en
r.
Lorfqu'on a la plus courte diílance , le demi-dia–
metre de l'ombre
O A
, & le demi'-diametre de la
lune
M B,
il eft aifé de
trquver.laP.artie éclipfée de
la lune, _c'efi-a-dire,
"la
quantité
A'e:
carA
M
,jig.
21,
eft égale
a
O A- O M;
íi l'on ajoute
M
C,
l'on aura
A
e;
done
.A
e
efi égale
a
O
A+ M
e–
O M-,
c'efi-a-dire , que le partie éclipfée efi égale a
la fomme du demi-diametre de la lune
&
de l'om–
bre, moins la plus courte diílance. Quand la lune
eft entiéremeot dans l'ombre, comme dans
lajig.
22,
9n appelle toujours
A
C
la grandeur de l'éclipfe.
On obferve dans la couleur des
écLipfes
de lune
des différcmces coníidérables. Lotfque la lune efr apo–
gée' elle trouve le cone d'ombre plus pres de fon
fomrnet : elle paroit alors plus rouge , ·plus lumi–
neufe que lorfque les
éclipfes
arrivent dans le péri–
gée; car dans le périgée les rayons rompus par l'at–
mofphere·' gui fe dtfpérfent dans le cone d'ombre'
&
quien dtrninuent l'ob[,urité, ne parviennent pas
.Tome
11.
7
55
jufqu'au centre de l'omb_re
Oll
a ['axe du
COne, qui
eíl: rrop large
d~ns
ce
pom~
la,
&
qui efi plus pres
de la terre.
V
01la
pourquo1l'on a vu des
éclipfes
oh
la
lun~ ~ifparoiífoit
entiérement; telle fut
l'éclipfo
du
15
JUlO
1620, ou celie du 9 de décembre 16o
1
dans laquelle on ne diftinguoit pas le bord éclipfé:
Kepler
?
fijlron. pars opt. pag.
,~9!,
Epítome p ag.
82i.
Hevelms, en parlant de
lecüpfe
du 25 avril
1642, aífure qu'on ne diftinguoit pas, meme avec
des Iunettes, la place de la lune, quoique le tems
fut aífez beau pour voir les étoiles de la cinquieme
grandenr, Hevel.
Selenogrophia, page
117
_;
mais
il
efi fort rare que la lune difparoiífe ainíi totalement
dans les
éclipfes.
Il
y a des années dans Iefquelles
il
n'arrive aucune
é.clipfe
de lune; telles font
les
années 1767 , 1770 ,
1774, le nreuddelalunes'étanttrouvéa 10
5 •
11°.
au commencement de janvier ; rnais communément
il
y
en a plufieurs' quelquefois quatre dans une me–
me année.
(M.
DE LA
LANDE.)
§
ÉCLIPSES
defoleil, (Ajlronom.)
Ellesfontpro–
duites par l'interpofition de la lune,
qni,
dans fes
conjonél:ions, paífe quelquefois direél:ement entre
nous
&
le foleiL La lune nous cache alors le foleil
en tout on en partie. Les
éclipfes
totales font celles
o\1 le foleil paroit entiéremenr couverr par la lune, le
diametre apparent de Ia-lune étant plus grand que ce·
Iui du foleil. Les
éclipfes
annúlaires font celles ortla
lune paroit toute entiere fur le foleil; le diametre dtt
folejl paroiífant le plus grand ' excede de tout coté \
celui de la
lun~,
&
forme autour d'elle un anneau
ou une couronne· lumineufe; telle fut
l'éclipfe
du
25 Juillet 1748,
&
celle du
1
Avril 1764, que l'on
vit annulaire
a
Cadix , a Rennes , a Calais ,
&
a
Pello en Laponie, ainfi queje l'avois annoncé dans
'
la
eonnoi./Jance des mouyemens célefles de
1764,
page
2oi .
Les
éclipfes
centrales font celles o
la lune n'a
aucune latitud,e au moment de la conjonél:ion appa–
rente : fon centre paroit alors fur
le
centre meme
du foleil,
&
l'éclipfe
efi totale ou annulaire,
e11
meme tems qn'elte eft centrale.
Les plus anciens auteurs nous ont enfeigné cornrne
événemens remarquables les grandes
éclipfes
de fo–
leil.
Il
en efi parlé dans
Ifai"e, chapitre
13
;
dans
Homere
&
Pindare;
dans
Ptine,
fiyr~
11,
ch.apitre
12;
dans
Denis d'Halicarnaffi, liyre
11.
Ce dernier dit
qu'a la naiífance de Romulus
&
a fa mort il y eut
des
éclipfes
totales de foleil , dans lefquelles la terre
fut dans une obfcurité auffi grande qu'au rnilieu de
la nuit. Hérodote nous apprend que dans la fixieme
année de la guerre entre les Lydiens & les Medes,
il arriva , pendant la bataille , que le jour fe chan–
gea en une nuit totale. Thales, le Miléíien, l'avoit
annoncée pour cette année-Ia; Pline,
liYre
JI,
cha–
pitre
2,
parle auffi de la prédiél:ion de Thales;
&
M. Coftard prouve que cette
éclipje
fut celle du
17 mai 603 avant Jefus-Chrifi.
Philof tranf
17i3,
page
.2J.
On trouve de femblables
é.clipfes
dans les
années 431, 190
&
50 avant Jefus-Chriíl;
&
dans
les années apres Jefus-Chrifi 59, 100, 237, 360,
787,840,878, 9)7, IIJ3, II87, 1191,1241,
141
5,
148
5 ,
1544 ,
1
5
6o, Kepler ,
Ajlron. pars
opt. pag.
290 ,
&c. On trouve un catalogue exaél:
de toutes les
éclipfes
arrivées depuis l'ere vulgaire,
dans 1'
.A
rt de Yérifier les dates
,
feconde édition ,
in–
folio
,
1770.
C'eíl: une chofe tres-íinguliere que le fpeél:acle
d'une
éclipfe
totale du foleil. Clavius , qui fut
té–
rnoin de celle du 21 aout
I
560 a Conimbre '
nou~
dit que l'obfcurité étoit, pour ainfi di re, plus gran–
de on dn moins plus feníible
&
plus frappante que
'
-
'
.
celle de la nuit: on ne voyott pasou pouvo1r mettre
ie pied ,
&
les oifeaux
~etomboie!lt
vers la
t.e~re
,.
par l'effroique leur 'aufo1t une
fi
tníl:e
o~_fcunte.
·
e e
e e e
lJ
















