
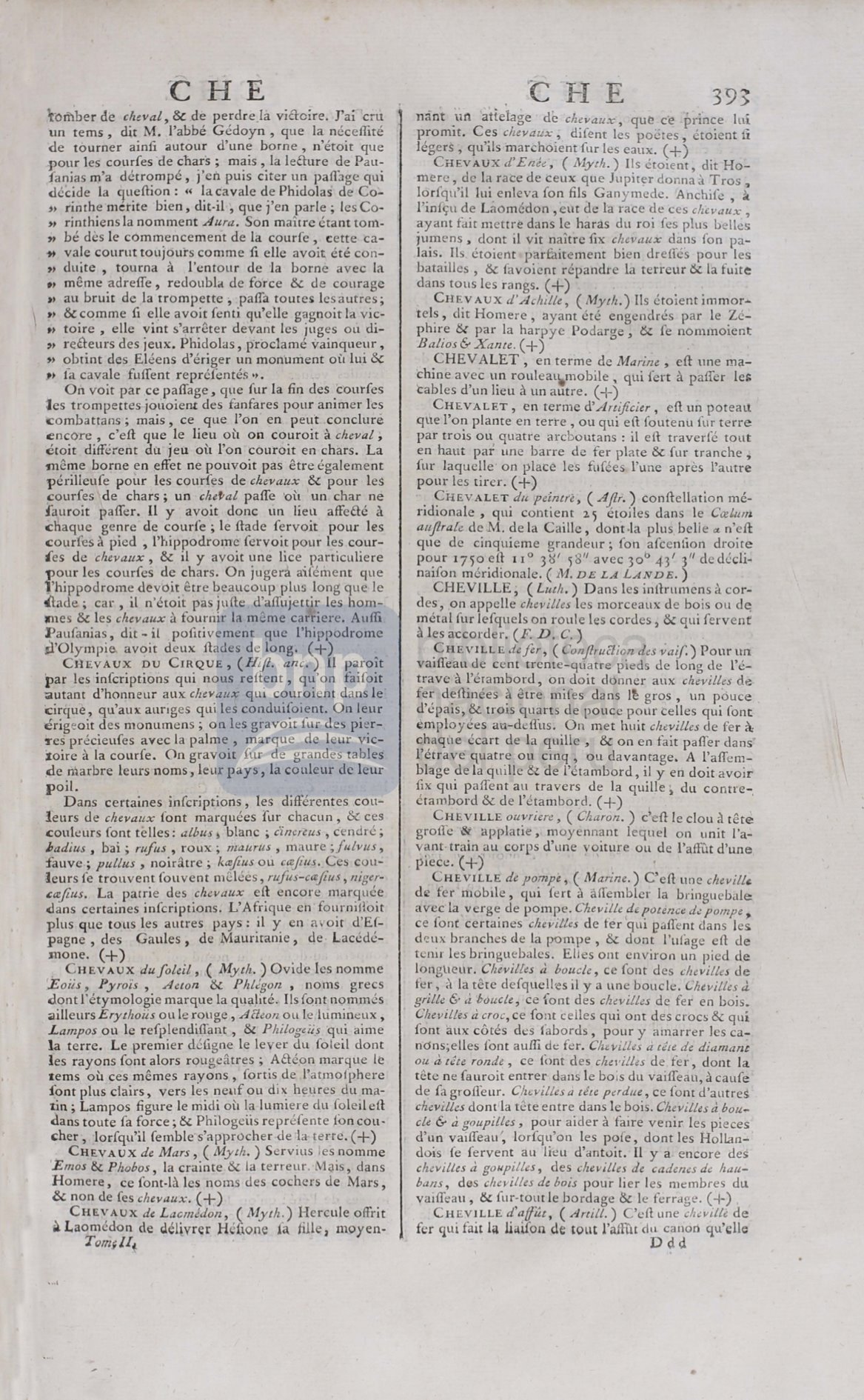
CHE
omber
de
cheval,
&
de perdre_la viél::oire. J'ai cru
un tems , dit M. l'abbé Gédoyn , que la néceffité
de tourner ainíi autour d'une borne, n'étoit que
pour les cou:fes de
~ha:,s ~
mc?s '.la leél:ure de Pau:
fanias rn'a detrompe,
J
en pUls c1ter
un
paífage qu1
decide la quefiion:
«
lacavale de Phido1as de Co–
j>
rinrhe métite bien, dit-il , que j'en parle; les Co–
,,
rinthiens la nomment
Aura.
Son ma1tre étant tom–
,, bé des le commencement de la courfe , cette ca–
~
vale courut toujours comme
ii
elle avoit été con–
'' duite ' tourna
a
l'entour de 1a borne avec la
., meme adreífe' redoubla de fo'rce
&
de courage
,, au bruit de la trompette , paffa tour es les áutres;
,,
&
comme
fi
e~le
avoit fenti qu'elle gagnoit
la
vic–
,, toire , elle vint s'arreter devant les juges ou
di–
'' rE!!i:eurs des jeux. Phidolas, p·roc1amé vainqueur,
" obtint des Eléens d'ériger un monument oú lui
&
•• fa
cavale fuífent repréfentés ., .
.
On voit par ce paífage, que fur la
fin
des courfes
les trompettes jouoient des fanfares pour animer les
ombattans; mais, ce que l'on en peut concluré
cncOre , c'eft qtele le lieu Otl On COuroit
a
cheval,
écoit différent du jeu ott l'on couroit en chars. La
roeme borne en effet ne pouvoit pas etre également
périlleufe pour les courfes de
che11aux
&
pour les
courfes de chars ; un
ckeflal
paífe 'oú un char ne
{auroit paífer.
11
y
avoit done un líen affeél:é
a
chaque genre de courfe ; le fiade fervoit pour les
courfes
a
pied ' l'hippodrome fervoit pour les cour–
{es
de
che11aJtx,
&
il
y
avoit une lice particuliere
pour les courfes de chars. On jugerá a'ifément que
1'hippodrome clevóit erre beaucoup plus long que le
fude; car,
il
n'étoit pas jufie d'aífujettir les hom- –
JneS
&
les
chevaux
a
fournir
la
meme carriere. Auffi
l?aufanias, dit-
il
pofirivement que l'hippodrome
il'Olympie avoit deux ftades de long. (
+)
CHEVAUX DU CIRQUE, (
Hijl.
anc.)
Il
p<lroit
par les infcripti0ns qui nous reítent, qu'on faifoit
-autanc d'honneur aux
cheYaux
quí couroient dans le
cirque, qu'aux aurtges qui les
condui~oient.
On l.eur
érígeoir des monumens; on les grav01t
fur
des
pi~r
Tes
précieufes avec la palme., marque de leur
VJC–
toire
a
la courfe. On graVOlt fur de grandes tables
,d.e marbre leurs noms, leur
pays,
la conleur de leur
poil.
.
.
r
•
.
1
d.ff'
Dans certames in1cnpt10ns, es
1 erentes cou-
leurs de
chevaux
font marquées fur chacun,
&
ces
~ouleurs
font telles:
albus
j
blanc ;
c'increus
,
cendré;
Jadius,
bai;
rufus
,
roux;
maurtts
,
maure
;julvus,
f-auve;
pullus,
noidhre;
ka?.jius
ou
ca?.jius.
Ces con–
leurs fe trouvent fouvent mel ' es'
rufus-ca?.jius' niger–
&ajius.
La parrie
d~s
_chevau:;
e~
encore
mar9.~1é.e
<lans certaines infcnpuons.
L
Afnque en
fourm1~o1t
plus que tous les auu·es pays: il
y
en
a
oit d'Ef–
pagne , des Gaules , de Mauritanie, de Lacédé–
mone.
(+)
. CHEVAUX
dufoleil,
(
Myt!t.)
Ovide les nomme
:Eoiis, Pyroi's
,
Aeton
&
Phügon
,
noms grecs
dont l'étymologie marque la qualité. Ils font nomm
' s
ailleursErythoüs
o u le rouge,
AReon
o
u
le lumineux,
Lampos
ou le refplendiífant ,
&
Philogeüs
qui aime
la
terre. Le premier défigne le
leve~.:
du foleil dont
les rayons font alors rougea tres; Aétéon marque le
tems ou ces memes rayons' fortis de l'atrnoíphere
font plus dairs, vers
le~ I?et~f
o u
di~
heu res du _ma–
tin; Lampos figure le m1d1 ou la lum1ere du folell efi
dans toute fa force;
&
Philogeiis repréfente ion cou,
cher, lorfqu'il femble s'approcher de
la
terre . (
+)
CREVAUX
de Mars,
(
Myth.)
Servius .es nomme
'.Emos
&
Phobos,
la crainte
&
la terreur. Mais, dans
Homere, ce font-la les noms des cochers de Mars,
&
non de fes
chevaux.
(
+)
CREVAUX
de Lacm 'don ,
(
Myth.)
Hereule offrit
Laomédon de
délivn:r
Ji
'í.ione
fa fill
1
moyen–
Tom;ll
C
I-I E
39>
nánt .
trl
att lage
de
chevaux,
qu~
ce prince lni
promlt. Ces
chevaux,
difent les po"res
'toíent
u
légers , qu'ils mar hoient fur les eaux. (
+)
HEVAUX
d' Enée, ( lv1yth.)
1;s
étoient, dit He–
mere, de la race de ceux que
Jupu~r
donna
a
Tros,
lórfqu'il lui enleva fon fils Ganymede. Anchife ,
a
l'iofsu
de Laomédon , eut de la raee de ces
clu:.vaux,
ayant fair mettre dans le haras du roi fes plus belles
jumens, dont il vit naitre fix
chevaux
dans fon pa–
lais.
Il
étoient parfaitement bien dreítés pour les
batailles ,
&
favoienr répandte la terr ur
&
la fuite
dans tons les rangs. (
+)
CHf:V
AUX
d'A hille ,
(
Myt!t.)
Ils étoient immor...
tels, d1t Homere, ayant été engendrés par le
Zé–
phire
&
par la harpye Podar¡ye ,
&
fe nommoient
Balios& Xante.
(
+)
0
CHEVALET, en terme de
Marine,
efi une ma–
chine a ec un rouleau mobile
qui fert
a
paíii r les
'cables d'un lieu
a
un
autre. (
+)
CHEVALET, en terme
d'Arújicier ,
efi un poteaLt
que l'on plante en terte, ou qui eft foutenu fur terre
par trois ou quatre arcboutans : il efi traverfé tout
en haut par une barre de fer plate
&
fur tranche,
fur laquelle on plate les fufées l'une apres l'autre
pour les rirer. (
+)
CHEV
ALET
du peintte,
e
Ajlr.)
confiellation mé–
ridionale , qui contient
2
5
étoiles dans le
CceLum
aujlra[e
de
M.
de la Caille, doht ·la plus bell e
a.
n'eft
que de cinquieme grandeur; fon afcention droite
pour 1750 efr
II
0
3g'
)8''
avec 30b 43'
3
11
dedécli~
naifon méridionale.
(M.
DE LA
LA
N DE.)
CHEV!LLE, (
Luth.)
Dans les inil:rumens
a
cor–
des, on appelle
chevilles
les morceaux de bois o
u
d~
méral fur lefquels on roule les cordes,
&
qui
fervenf
a
les a-cc01·der.
(F.
D.
C.)
-
~HE
VIL
LE
de fer,
(
Conjlruélion
des
~aif.)
Pour
un
va1ífeau de cent trente-qüatre pieds de long de l'é–
trave
a
l'érambord' on doit donner aux
chevilles
de
fer defiinées a eere mifes da ns
l~
gros '
un
póuce .
d'épais,
&
rrois quans de pouce pour celles qui font
employées au-d ífus. On met huit
chevilles
de fer
<\
chaque écart de la quille
,
&
on en fait paífer dans
l'étrave quat1•e
ou
cinq , ou davantage. A l'aífem–
blage de la quille
&
de l'étambord,
il
y
en doit avoir
fix qui paifent a
u
travers de la quille, du contre–
érambord
&
de l'étambord.
e+)
.
CHEVILLE
ouvriere,
(
Cltaron.
)
c~efi
le clou
atete
groífe & applatie, moyennant lequel on unit l'a–
vant-train au corps d'une voiture ou de l'affut d'une
, piece.
(+)
CREVILLE
de pompe'
e
Marine.)
Ceít une
cheville.
d~
fer mobile' qui fert
a
aífembler la bringuebale
a
vec la verge de pompe.
Ch.eville de potence de pompe,
ce font cerraines
chevitles
de fer qui paífent aans les
deux branches de la pompe,
&
dont l'ufage efi de
t nir les bringuebales. Elles ont environ un pied de
longt1ettr.
Che'Yilles
a
boucle,
ce font des
clzevilles
de
fer,
a
la tete
defquell~s
il
y
a une boucle.
Chevilles
a
grille
6·
a
hóucle,
ce font des
chcvilles
de fer en bois.
Clzevilles
a
croe,
ce font
e
elles qui onr des croes
&
quí
font aux c6tés des fabords, pour
y
amarrer les ca–
nons;elles íont auffi
de
fer.
Ckevilüs
a
téte de diamant
ou
a
téte ronde'
ce
font
des
ch~t·illes
de fer' dont la
tete ne fauroit entrer dans le bois du vaiifeau,
a
caufe
de fa groffeur.
Clu:.villes a tét.c pudue,
ce font d'autres
chevilles
dont la tete entre dans le bois.
Chevillas
a
bou–
cü
&
a
goupilles,
pour aider
a
faire venir les pieces
d'un vailfeau ', lorfqu'on les pofe, dont les Hollan–
dois fe fervent au lieu d'antoic.
Il
y a encore
des
chevilles
a
goupilles,
des
clzeviLLes de cadenes de hau–
bans,
des
chevilles de bois
pour lier les membres du
vaiffi au,
&
fur-tour le bordage
&
le ferrage. (
+)
CHEV1LLE
d'ajflu,
(
Artill.)
C'efi une
clzeville
de
fer qui fait
la
liaifon de
tout
l'affil.t
dtt canon qu'elle
Ddd
















