
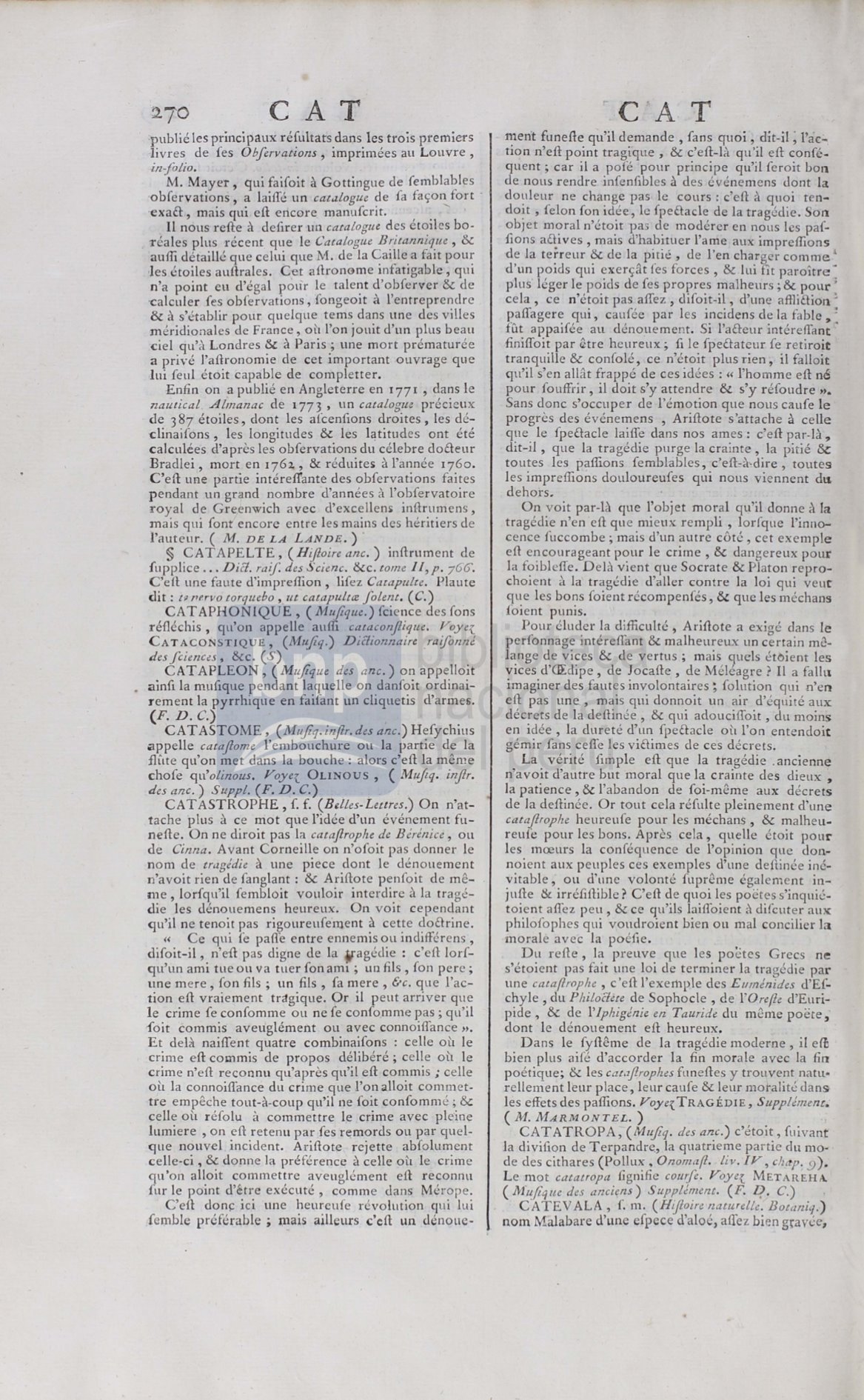
CAT
·pnblié les principaux réfultats dans les trois prerniers
livres de {es
Obfervations,
imprimées au Louvre,
in-foLio.
M. Mayer, qui faifoit a Gottingue de femblables
obfervations, a laiífé un
catalogue
de {a fa'Ton fort "
-exaél:, rnais qui efi encore rnanufcrit.
'
I1
nous refre
a
deíirer
un
catalogue
des étoiles be–
réales plus récent que le
Catalogue B:itanniq_tt.e,
&
auffi détaillé que celui que
M.
de la
~allle.
a faa
pou~
·les étoiles aufirales. Cet a:ílron0me Infatigable, qut
n'a
point eu d'égal potir le talent d'obferver
&
de
-calculer fes obfervations, foAgeoit
a
l'entreprenclre
&
a
s'établir pour quelque tems dans une des villes
méridionales de France, oü l'on jouit d'un plus beau
ciel qu'a Londres
&
a París ; une mort prématurée
a
privé J'afironomie de cet important ouvrage que
luí
{eul étoit capable
de
completter.
-Enfin on a publié en Angleterre en
1771 ,
dans le
nautical Almanac
de
1773,
un
catalogue
précieux
de
387
étoiles, dont les afcenfions droites, les dé–
dinaifons, les longitudes
&
les l(!titudes ont été
calculées d'apres les obfervations du célebre doéleur
Bradlei' mort en
I762'
&
réduites
a
l'année
1760.
C'eíl: une partie intérefi'ante des obfervations faites
pendant un gund nombre d'années a l'obfervatoire
royal de Greenwich avec d'excellens infirumens,
mais qui font encore entre les mains des héritiers de
l'auteur. (
M.
DE LA
LANDE.)
§
CATAPE
L
TE , (
Hijloire anc.
)
infirument de
fupplice . .•
Diél. raif. desScienc,
&c.
tome II,p. 766.
C'efr une faute d'impreffion, lifez
~atapulte.
Plaute
dit :
t?
neryo torquebo, ut catapultte folent. (C.)
CATAPHONIQUE, (
Mujique.)
fcience des fons
réfléchis , qu'on appelle auffi
cataconjlique. Voye{
CAT
ACONSTIQUE,
(Mujiq.) Diélionnaire _ralfonné
des fciences,
&c.
(S)
CATAPLEON, (
Mu.fzque des anc.)
on appelloit
ainfi. la muíique pendant laquelle on danfoit ordinai–
rement la pyrrhique en faifant
un
cliquetis d'armes.
(F. D.
C.)
CATASTOME,
(Mu.fzq.injlr.des anc.)
Hefychius
.appelle
catajlome
l'ernbouchure ou la partie de la
flfLte qu'on met danS la bouche: alors c'efr la meme
chofe
qu'olinous. Voyet
ÜLINOUS , (
.nJ.uju¡. injlr.
des anc.) Suppl.
(F.
D.
C.)
.
CATASTROPHE,
{.f.
(Belles-Lettres.)
On n'at–
tache plus a ce mot que l'idée d'un événement fu–
nefie. On ne diroit pas
la
cataflrophe de Bérénice,
on
de
Cinna.
Avant Corneille on n'ofoit pas donner le
nom de
tragédie
a
une piece dont le dénouement
n'avoit rien de fanglant :
&
Arifiote penfoit de me–
me ' loríqu'il fembloit vouloir interdire
a
la tragé–
clie les dénouemens heureux. On voit cependant
qu'il ne tenoit pas rigoureufefllent
a
cette doél:rine.
((
Ce qui fe paífe entre ennemis o
u
indifférens ,
difoit-il, n'eil: pas digne de la agédie : c'efi lorf–
qu'un ami tue on va tuer fon ami ; un fils , fon pere;
une mere, fon fils ; un fils , fa mere,
&c.
que l'ac–
tion eft vraiement trctgique. Or il peut arriver que
le crime fe confomme ou ne fe confomme pas; qu'il
-foit commis aveuglément ou
avec
connoiífance "·
Et
del~
naiífent quatre combinaifons : celle ou le
crirne
eft
commis de propos délibéré ; celle o1t le
crime n'efi reconnn qu'apres qu'il efi commis; celle
oú
la connoiífance du crime que l'on alloit commet–
tre empeche tout-a-coup qu'il ne foit confommé ;
&
celle
oi1
réfolu
a
commettre le crime
avec
pleine
lumiere , on eft retenu par fes remords ou par quel–
que nouvel incident. Arifiote rejette abfolument
celle-ci '
&
donne la préférence a celle
ott
le crime
qu'on alloit commettre aveuglément efi reconnn
fur le point d'&tre exécuté, comme dans Mérope.
C'eít
don~
ici une heureufe révolution qui lui
femble préférable ;
~ais
ailleurs c,efr un dénoue-
CAT
ment funefie q-u'il demande , fans quoi , dit-il ; l'ac...
tion n'efi point tragique ,
&
c'efi-la qu'il eft confé..
qu ent; car il a poíe pour príncipe qu'il feroit bon
de nous rendre infeníibles a des événemens dont
la
do~tleur
ne
cha?g~
pas le cours : c'eft
a
quoi ten–
do~t,
felon fon 1dee, le {peélacle de la tragédie. Son
ob)et moral n'étoit pas de modérer en nous les paf..
íions aé!ives, rnais d'habituer l'ame aux impreffions
·de la terreur
&
de la pítié, de l'en charger comme
d'un poids qui exer'Tat fes forces,
&
lui fit paroitre ..
plus léger le poids de fes propres rnalheurs;
&
pour ;
cela, ce n'étoit pas aifez , difoit-il, d'une affiiélion ..
paífagere qui, caufée par les incidens de la fable ,.
!
fut appaifée au dénouement. Si l'aél:eur intéreffant
nniífoit par &tre heureux; íi le fpeél:ateur fe retiroit
tranquille
&
confolé, ce n'étoit plus rien,
il
falloit
qu'il s'en allat frappé de ces idées :
H
l'homme efi
né
pour fouffrir, il doit s'y attendre
&
s'y réfoudre , ..
Sans done s'occuper de l'émotion que nous caufe le
progres des événemens , Ariftote s'attache
a
celle
que le fpeébcle laiífe dans nos ames: c'efi par-la,
dit-il , que la tragédie purge la crainte , la pitié
&
toutes les paffions femblables, c'eft-a·dire, toutes
les impreffions douloureufes qui nous viennent d1.1.
dehors.
On voit par-Ia que l'objet moral qu'il donne
a
Ia
tragédie n'en efr que rnieux rempli , lorfque l'inno–
cence fuccombe; rnais d'un autre coté, cet exemple
efi encourageant pour le crime,
&
dangereux poll.l'
la foibleffe. Dela vient que Socrate
&
Platon repro–
choient a la tragédie d'aller centre la loi qui veut
que les bons foient récompenfés,
&
que les méchans
foient punis.
Pour éluder la difficulté , Ariílote a exigé dans
le
perfonnage intéreífant
&
malheureux un certain me..
lange de vices
&
de vertus ; mais quels étoient les
vices d'C!Edipe, de Jocafie
~
de Méléagre ?
Il
a
falltt
imaginer des fautes involontaires; folution qui n'en
eft pas une., mais qui donnoit un air d' ' quité aux
décrets de la deíl:inée,
&
qui adouciífoit, du moins
en idée , la dureté d'un fj)eétacle o1t l'on entendoit
gémir fans ceífe les viétimes de ces décrets.
La vérité fimple eft que la tragédie .ancienne
n'a voit d'autre but moral que la crainte des dieux ,
la patience,
&
l'abandon de foi-meme aux décrets
de Ja deíl:inée. Or tout cela réfulte pleinement d'une
catajlrophe
heureufe pour les méchans ,
&
rnalheu..
reufe pour les bons. Apres cela, quelle étoit pour
les mceurs la conféquence de l'opinion que don..
noient aux peuples ces exemples d'une deíl:inée iné–
vitable, o u d'une volonté fupreme également in–
jufte
&
irréfifiible? C'efi de quoi les poetes s'inquié–
toient aífez peu'
&
ce qu'ils laiífoient
a
difcuter aux:
philofophes qui voudroient bien ou mal concilier la
morale avec la poéfie.
Du
re:fie , la preuve que les poetes Grecs ne
s'étoient pas fait une loi de terminer la tragédie par
une
cataflrophe,
c'eft l'exetilple des
Evménides
d'Ef ..
chyle,
du
Philoélete
de Sophocle , de
1
Orefle
d'Euri–
pide,
&
de
l'Iphigénie en Tauride
du meme poere,
dont le dénouement efi heureux.
Dans le fyíl:eme de la tragédie moderne, il effi
bien plus aifé d'accorder la fin morale avec la fin
poétique;
&
les
cat.:zjlrophes
funeftes
y
trouvent natu•
reHement leur place, leur ca
u
fe
&
leur mo alitt! dans
les effets des paffions.
Voyez:TRAGÉDIE,
SuppUment;
(M.
MARMONTEL.)
CAT ATROPA, (
Mujiq.
des anc.)
c'étoit, fuivant
la divifion de
Terpandr~,
la quatrieme partie
du
rno•
de des cithares (Pollux.
Onomafl. liv. IV,
clu~p.
9 ).
Le mot
catatropa
fignifie
coUTfe. Voye{
METAREHA.
(
.lt4ujique des anciens) SuppUment. (F. D. C.)
.
CATEVALA,
f.
m. (
Hijloire natzuelle. Botaniq.)
no~
Malabare d'une efpece d'aloé, aífez bien
g~av
' e,
















