
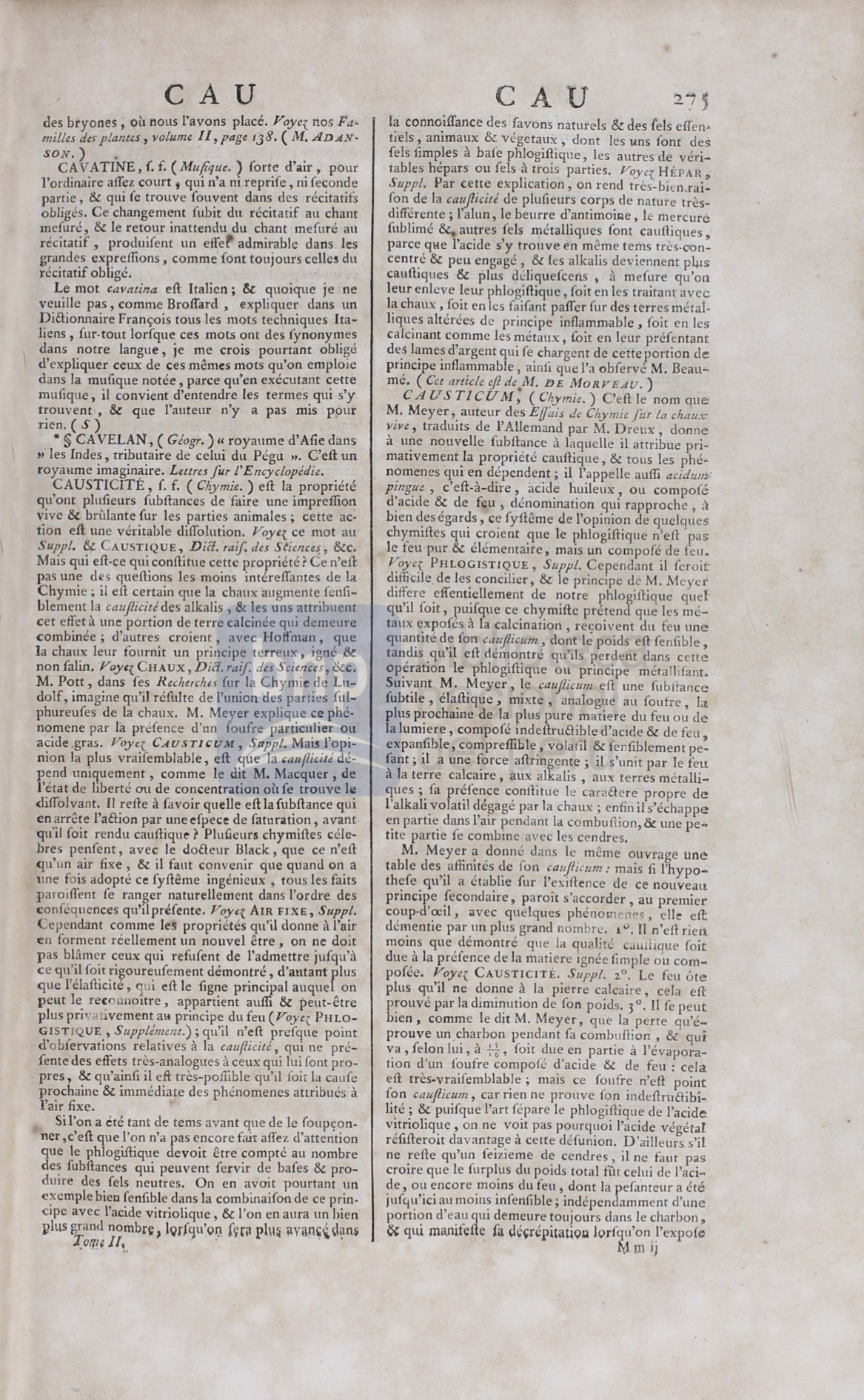
CAU
des bryones; oh nous ravons placé.
Y'oyez
nos
Par.
milles
des
plantes,
volume Il,page
tj8. (M.
ADAN-
SON.)
.
CA
V
ATINE,
{.
f. (
Mujique.
)
forte d'air , pour
l'ordinaire aífez court
f
qui n'a ni reprife, ni feconde
partie,
&
qui fe trouve fouyent
da,n~ d~s
récitatifs
obligés. Ce changement fubtt du recttattf au chant
mefuré,
&
le retour inattendu du chant mefuré au
réciratif , produifent un effe
admirable dans les
grandes expreffions, comme {ont toujours celles du
récitatif obligé.
Le
mot
cavatina
e.íl:Italien;
&
quoique je ne
veuille pas, comme
Broífard , expliquer clans un
Diétionnaire Fran<;ois tous les mots techniques lta–
liens , fur-tout lorfque ces mots ont des fynonymes
dans notre langue, je me crois pourtant obli!?é
d'expliquer ceux de ces memcs mots qu'on empl01e
dans la mufique notée, paree qu'en exécutant
~ette
mufique, il convient d'entendre les termes qm s'y
trouvent ,
&
que l'auteur n'y a pas mis pour
rien.
(S)
*
§
CA
VELAN, (
G!ogr.)
(<
royaume d'Afie dans
,>. les Indes, rributaire de celui du Pégu
»·
C'eft un
royaurne imaginaire.
Lettres fur l'Encyclopédie.
CAUSTICITÉ, f. f. (
Chymie.
)
eft la propriété
qu'ont phúieurs fubftances de faire une impreffion
vive
&brúlante fur les parties animales ; cette ac–
tion
e.llune véritable
diffolution~
Voyez
ce mot au
Sup
pl. 8{.
CAUSTIQVE,
Diél.
raif. des Stiences,
&c.
Mais qui eft-ce quiconftitue cette propriété? Ce n'eft
pas une
d~s
quefiions les moins intéreífantes de la
Chymie ; il eft certain que la chaux augmente fenfi–
blement la
caujlicité
des alkalis , & les uns attribuent
cet effet
a
une portien de terre calcinée qui demeure
combinée ; d'autres croient , avec Hoffman, que
la chaux leur fournit un príncipe terreux, igné
&
non falin.
royez.
CHAUX'
Dia.
raif. des Sciences'
&c.
M. Pott , dans fes
Recherclzes
fur la Chymie de Lu–
dolf, imagine qu'il réfulte de l'union des par
ti
es ful–
phureufes de la chaux. M. Meyer explique ce phé–
nomene par la préfence d'L1n foufre particulier ou
acide .gras.
Voye{ CAUSTICUM, Srrppl.
Maisl'opi–
nion la plus vraifemblable, eft que la
caufticité
dé–
pend uniquement , comme le dit M. Macquer , de
l'état de liberté
OU
de concentration
O~l
fe trouve le
.diífolvant.
Il
refte
a
favoir quelle efi la fubftance qui
en arrete l'aétion par une efpece de faturation' avant
qu'il foit rendu cauftique? Pluíieurs chymiftes céle–
bres penfent, avee le doél.eur Black, que ce n'eft
qu'un air fixe ,
&
il faut {;Onvenir que quand on a
une fois adopté ce fyfteme ingénieux, tous les faits
paroiffent fe ranger naturellement dans l'ordre des
conféquences qu'il préfente.
Voy
e{ AIR FIXE,
Suppl.
Cependant comme les propriétés qu'il donne
a
l'air
en forment réellement un nouvel etre ' on ne doit
pas blamer ceux qui refufent de l'admettre jufqu'a
ce qu'il foit ri9oureufement démontré' d'autant rlus
que l'éla:íl:icite,
ti
e:íl: le figne principal auque on
peut le rec
ottre , appartient auffi
&
peut-etre
plus priva ·vement att príncipe du fe u
(Voyez
PHLO–
GISTIQUE,
Supplément.) ;
qu'il n'e:íl: prefque point
d'obfervations relatives
a
la
caufiicité'
qui ne pré–
fente des effets
tn~s-analogues
a ceux qui luí font pro–
pres,
&
qu'ainfi il eft tres-poffible qu\1 foit la caufe
prochaine
&
immédiate des phénomenes attribués
a
l'air fixe.
Sil'on a été tant
de
tems avant que de le foup9on-
1-1er ,c'efi que l'on n'a pas encare fait affez d'attention
que le phlogiftique devoit etre compté au nombre
des fubftances qui peuvent fervir de bafes
&
pro–
duire des fels neutres. On en avoit pourtant un
e:'emple bien fenfible dans la combinaifon de ce prin–
ctpe avec l'acide vitriolique,
&
l'on en aura un bien
¡:?hts grand
nombre~ 1Qr~qu'9Q
ÍHft
plu.~
flYID1ké
~ans
I
om; IJ.
'
·
·
· -,
·
.....
--
t...
CAU
ia connoiífance des favons naturels
&
des
fels
eífen::.
tiels, animaux
&
végetaux , dont les uns font des
fels fimples
a
bafe phlogifiíque, les autres de véri–
tables hépars ou fels
~
tr<?is parties.
Voye{
HÉ:.PAR,.
Suppl.
Par cette exphcatwn, on rend tres-bien,rai–
fon de
la
caujlicité
de plufieurs corps de nature tres–
différente ; l'alun, le beurre d'antimoi'le, le mercure
fublimé
&
autres fels métalliques font caufiiques
~·
paree qlie l'acide s'y trouve eh meme tems tres-Cion–
centré
&
peu engagé , &
Ies
alkalis deviennent p4¡s
caafiiques
&
plus déliquefceris '
a
mefure qu'on
leur enleve leur phlogiftique, foit en les traitant ave
e
la chaux, foit en les faifant paífer fur des terres
méta1~
liqu~s
altérées de príncipe inflammable , foit en les
calcmant comme les métaux, foit en leur préfentant
de.s
l~me~
d'argent qui fe. chargent de cetteportion de
pnnc1pe mflammable, amfi que l'a obfervé M. Beau–
mé. (
Cet article
efl
de.M.
DE MoRVEAU.)
CA
U STJCU
M,
(
Chymie.)
C'eft le nom
que
M. Meyer, auteur des
Effais de Chymie far la. chaux
'YiYe,
traduits de 1'Allemand par M. Dreux, donne
a
une nouvelle fubftance
a
laquelle il attribue pri–
mativement la propriété caufiique,
&
tous les phé–
nomenes qui en dépendent; il l'appelle auffi
acidum:
pingue
'
c'eft-a-dire' acide huileux' ou compofé
d'acide
&
de feu ; dénornination qui rapproche '
a
bien des égards, ce fyfieme de l'opinion de quelques
chymifies qui croient que le phlogifiique
n~eft
pas
le feu pur
&
élémentaite, mais un compofé de feu ..
Voyez
PHLüGISTIQUE,
Suppl.
Cependant il feroit
difficile_de les concilier,
&
le principe de M. Meyer
differe eífentiellement de notre phlogifiíque quef
qu'il foit, puifque ce chymifte prétend que les mé–
tattx expofés
a
la calcination ' re9oivent du feu une
quantité de fon
caujlicum,
dont le poids efi fe nfi1>le,
tandis qu'il e:íl: démontré qu'ils perdent dans cette
opération le phlogifiique ou príncipe méta hfanto
Suivant M. Meyer, le
caujlicum
eft une fubftance
fubtile , éla.ftique
~
mixte , analogue au foufre ,
la
plus prochame de la plus pure matiere du feu ou de
la lumiere, compofé indeftruétible d'acide
&
de fe u
expanfible, compreffible, volaril
&
feníiblement
pe~
fant; il a une force a:íl:ringente ; il s'unit par le feu
a
la terre calcaire' aux alkalis ' aux terres métalli–
ques ; fa préfence conftitue le caraétere propre de
l'alkali volatil dégagé par la chaux; enfin il s'échappe
en partie dans l'air pendant la combufiion,
&
une pe.¡,
tite partie fe combine avec les cendres.
M. Meyer a donné dans le tneme ouvrage
une
table des affinités de fon
caufiicum:
mais íi l'hypo–
thefe qu'il a établie {ur l'exiíl:ence de ce nouveau
principe fecondaire, paroit s'accorder , au premier
coup-d'reil, avec quelques phéno
f'
PS,
elle eft
démentie par un plus grand nombr .
1°.
ll
n'eft ríen
moins que démontré que la qualit'
au1-1que foit
due a la préfence de la matiere ignée fimple ou com–
pofée.
royez
CAUSTICITÉ.
Suppl.
2°.
Le feu óte
plus qu'il ne donne a la pierre calcaire' cela eft
prouvé par la diminution de fon poids. 3
°.
I1 fe peut
bien, comme le djt M. Meyer, que la perte qu'é–
prouve un _ charbon pendant fa combufiion ,
&
qui
va'felon lui'
a :
~
'
foir due en partie
a
l'évapora–
ti.ond'un foufre compofé d'acide
&
de feu : cela
eft tres-vraifemblaa_le ; mais ce fou fre n'efi poirtt
fon
caujlicum,
car nen ne prouve fon indeftruétibi–
lité ;
&
puifque l'art fépare le phlogifiique de l'acide
vitriolique , on ne voit pas pourquoi l'acide végétal.
réfiíl:eroit davantage
a
cette défunion. D'ailleurs s'il
ne refte qu'un feizieme de cendres, il ne faut pas
croire que le furplus du poids toral fut celui de l'aci–
de, ou encere moins du feu
1
dont la pefanreur a
été
juf'lu'ici au moins infeníible; indépendamment d'une
portien d'eau qui demeure toujours dans le charbon
~
~
qui
ma.nifefi~
fa
~é~rép~tatio~
lo.rfgu'on}'expofe
Mm
lJ
















