
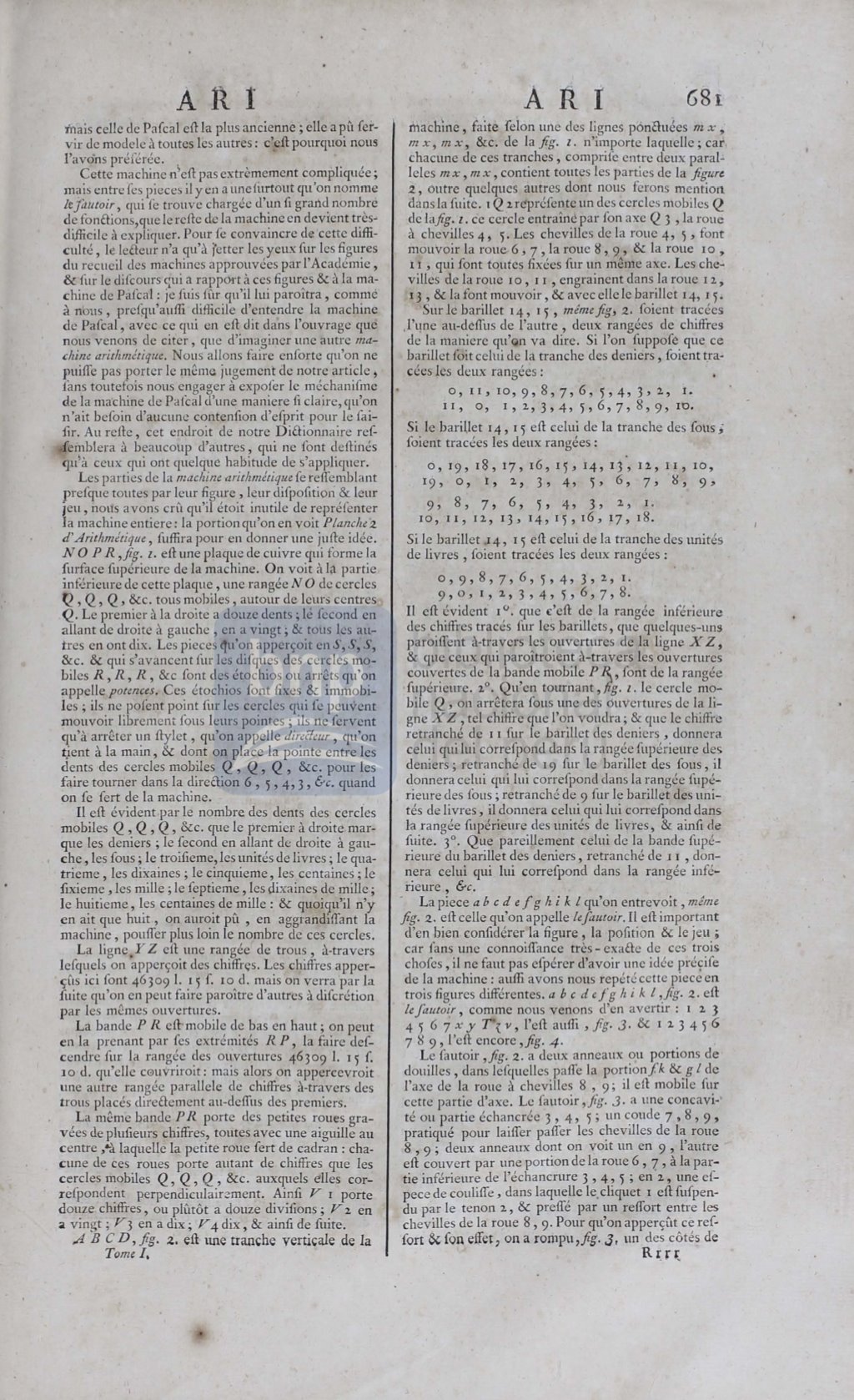
A
R 1
inais celle de Pafcal efr la plus ancienne ; elle a pft (er–
vir d_e
mo~el,e ~
toutes les alltreS: c'efr pourquoi nous
l'avons preferee. .
Cette machinen'ea pas extr€mement compliquée;
mais entre (es pieces il yen aunefilrtout qu'on nomme
le
Jiwloir,
qui fe trouve chargée d'un fi grand nombre
de fonétions,que le reae de la machine en devient tres–
di.fficile
a
expliquer. Pour fe convaincre de cette difli–
culté,
1
leéteur n'a qu'a rerter les yeux (ur les figures
du recueil des machines approuvées par l'Académie ,
&
fur le di(cours qui a rappon
it
ces figures & a la ma–
chine de Pa(cal : je fuis {ftr qu'il lui paroltra, comme
a
nollS,
pre(qu'aufli diflicile d'entendre la machine
de Pafcal, avec ce qui en
ea
dit dans l'ouvrage que
nous venons de citer, que d'imaginer une aun'e
ma–
chine
aric/ul2éúqlle.
Nous aIlons faire enforte qu'on ne
puilfe pas porter le m&mc jugement de norre article ;
:l1I11S
toutefois nous engager
a
expofer le méchanifme
de la machine de Palcal d'une maniere fi claire, 'Iu'on
n'ait be(oin d'aucune contenfion d'efprit pour le fai–
fir. Au reae, cet endl"Oit de notre Diétionnaire ref–
femblera a beaucoup d'autres, qui ne font deainés
<lUla
ceux qui ont c¡uelque habitude de s'appliquer.
Les parties de la
maclzine arithmétique
(e relfemblant
prefque toutes par leur figure, leur difpofition & leur
¡eu, nous avons crll qu'i1 étoit inutile de repréfenter
la machine entiere: la portion qu'on en voit
Plal2c1te
2-
d'Aritlzmétique,
(uflira pour en donner une julte idée.
N
O
P R ,jig.
l.
elt une plaque de cuivre qui forme la
furface fupérieure de la machine. On voit
a
l¡t parrie
inférieure de cette plaque, une raJolgée
N
O de cercIes
Q ,
Q, Q,
&c. tous mobiles, autour de leurs centres
Q.
Le premier a la droite a dome dents ; le fecond en
allant de droite agauche, en a vingt; & tous les au–
tres en ont dix. Les pieces qu'on apperc;oit en
S, S, S,
&c. & qui s'avancent (ur les difques des cercles mo–
biles
R, R, R,
&c (ont des étochios ou arr&ts qu'on
appelle
potences.
Ces étochios font fixes & immobi–
les; ils ne pofent point fitr les cercIes qui fe peuvent
mouvoir librement fous leurs pointes ; ils !le fervent
qu'<'t arr&ter un ílylet , qu'on appelle
dinéleur,
qu'on
t.ient a la main, & dont on place la pointe entre les
dents des cercles mobiles
Q
,
Q, Q,
&c. pour les
faire toumer dans la direél;ion 6 , 5, 4,3,
&c.
c¡uand
on fe fert de la machine.
Il ea évident par le nombre des dents des cercles
mobiles
Q, Q
,
Q,
&c. que le premie¡'
a
droite mar–
que les deniers ; le fecond en allant de droite
a
gau–
che, les fous; le troifieme, les unitésde livres ; le c¡ua–
trieme, les dixaines ; le cinquieme, les centaines ; le
fIXieme , les mille ; le feptieme , les dixaines de mille;
le huitieme, les centaines de mille : & quoiqu'il n'y
en ait que huit, on auroit pu , en aggrandilfant la
machine, poulfer plus loin le nombre de ces cercles.
La ligne.
Y Z
ea une rangée de trous, a-travers
lefquels on apperc;oit des
chiffr~s.
Les chiffres apper–
c;:tlS ici font 46309
I.
15 f.
lO
d. mais on yerra par la
{uite qu'on en peut faire paroitre d'autres a di(cretion
par les mcmes ouvertmes.
La bande
P R
elt-mobile de bas en haut; on peut
en la prenant par fes extrémités
R P,
la faire de(–
cendre fur la rangée des ouvertures 46309
1.
1)
f.
10 d. qu'elle C0uVriroit: mais alors on appercevroit
une autre rangée parallele de chiffres a-travers des
trous placés direétement au-deffus des premiers.
La m&me bande
PR
porte des petites roues gra–
vées de plufieurs chiffres, toutes avec une aiguille au
centre
,"<l
laquelle la petite roue fert de cadran : cha–
cune de ces roues porte autant de chifFres que les
cercIes mobiles
Q, Q,
Q
,
&c. auxquels elles co1'–
Iefponde~t perpendiculair~ment.
Ainfi
V
I
porte
aouze chlffres, ou pllltot a douze divifions;
V
2 en
a vingt ;
V3
en a dix;
V
4 dix, & ainfi de fuite.
.A BCD, jig.
.2.
ea une tranche verticale de
la
Tome/,
A
ti
1
machlne, faite felon 1II1e des lignes póncruées
m x ,
m x, m x,
&c. de la
jig.
l.
n'importe laquelle ; car
chacune de ces tranches, comprife entre deux paral–
leles
mx, mx,
contient toutes les parties de la
jigure
2,
outre quelques autres dont nous ferons mention
dansla fuite. 1
Q
1.
repréfellte un des cercIes mobiles
Q
de
lajig.
l.
ce cercIe entxalne par fon axe
Q
3 , la roue
a
chevilles 4, 5. Les chevilles de la roue 4,
~,
font
mouvoix la roue 6, 7, la roue 8, 9, & la roue 10,
11 , qui font toures fixées fur un m&me axe. Les che–
villes de la roue 10,
II ,
engrainent dans la roue 12,
13 ,
& la font mouvoir , & avec elle le barillet 14,
I
5.
Sur le barillet 14, 15 ,
meme
jig,
2.
foient tracées
)'une au-defrus de I'auu'e , deux rangées de chiffres
de la mahiere qu'Qn va dire. Si 1'0n filppo(e que ce
barillet (oit celui de la tranche des deniers, (oient (J"a–
cées les deux rangées :
0,1l,IO,9,8,7,6,5,4,3,1,
l.
I!,
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Si
le
bari(let 14, I 5 ea celui de la tranche des fous ;
foient tracées les deux rangées :
0,19,18,17,16,15,14,13',
ll, 1I, 10,
19,
0,
i,
2, 3,4, 5, 6, 7, H, 9'
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, l .
10,11,12,13,14,15,16,17,18.
Si
le
barillet .14, 15
ea
celui de la tranche des unités
de livres , (oient tracées les deux rangées :
0,9,8,7,6, ),4, 3,2,
1.
9,
o,
1, 2,
3 , 4, 5, 6, 7, 8.
Il
ea
evident
I ().
que
,'elt
de la rangée inférieure
des chiffres tracés {llr les barillets, que quelques-uns
paroilfent a-travers les ouvermres de la ligne
X Z ,
& que ceux qui paroltroient a-travers les ouvertures
couvertes de la bande mobile
P
R.,
font de la rangée
fupérieure. 2°. Qu'en tomnant,fi'g.
l.
le cercIe mo–
bile
Q,
011 arr&tera (ous une des óuvertures de la li–
gne
X Z
,
tel chiffre que I'on voudra; & que le chiffre
retranché de
I
1 fur le bariUet des deniers , donnera
celui qui lui correfpond dans la 1'angée fupérieure des
delliers; ret1'ancbé ele 19 fm le barillet des (ous, il
donnera celui qui lui correfpond dans la rangée fupé–
rieure des (ous ; retranché de 9 (m le barillet des nni–
tés de livres, il donnera celui qui lui corref¡)ond dans
la rangée fupérieure des unités de livres ,
&
ain{¡ de
ftúte. 3°. Que pareilIement celui de la bande fupé–
rieme du barillet des deniers, retranché de
1
1 , don–
nera celui qui lui corre(pond dans la rangée infé–
rieure,
&c.
. La piece
a bcd
e
f
g
A
i
k l
qu'on entrevoit ,
meme
jig.
2.
eacelle qu'on appelle
leJautoir.
Il elt important
d'en bien confidérer la figure, la pofition & le jeu ;
car fans une connoiffance tres - exaéte de ces tI'ois
cho(es ,il ne faut pas e(pérer d'avoir une idée
pré~i(e
de la machine: auffi avons nous repérécette pieceen
trois figures différentes.
a
bcd
e
fg
¡,
i k l
,jig.
2.
ea
leJautoir,
comme nous venons d'en avertir:
I
2 3
4 5 6 7
x
Y T{
v,
l'ea aufli
,jig.
3·
& 12 345 6
7 8 9,
['elt
encore
,jig.
4·
Le fautoir
,jig.
2.
a deux anneaux ou portions de
douilles, dans lefquelles palfe la portionfk &
g
l
de
l'axe de la r0ue a chevilles 8 , 9; il ea mobile (ur
cette partie d'axe. Le (autoir
,jig.
3.
a une concavi–
té ou partie échancrée 3 , 4, 5; un
~oude
7 , 8 , 9 ,
pratiqué pour lailfer palfer les chevllles de la roue
8 , 9 ; deux anneaux dont on voit un en 9 , l'autre
elt couvert par une portion de la roue 6 ,
7. '
a
la par–
tie inf¿rieure de l'échancrure 3 , 4, 5 ; en 2, une e(–
pece de coulilfe, dans laquelle le.c1iquet 1
ea
fu(pen–
du par le tenon 2, & prelfé par un relfort entre les
chevilles de la roue 8,9' Pour c¡u'on apperC;llt ce re(–
fort
&
fon effct, on a rompu
,jig.
J,
un des cotés de
R
t:n:.
















