
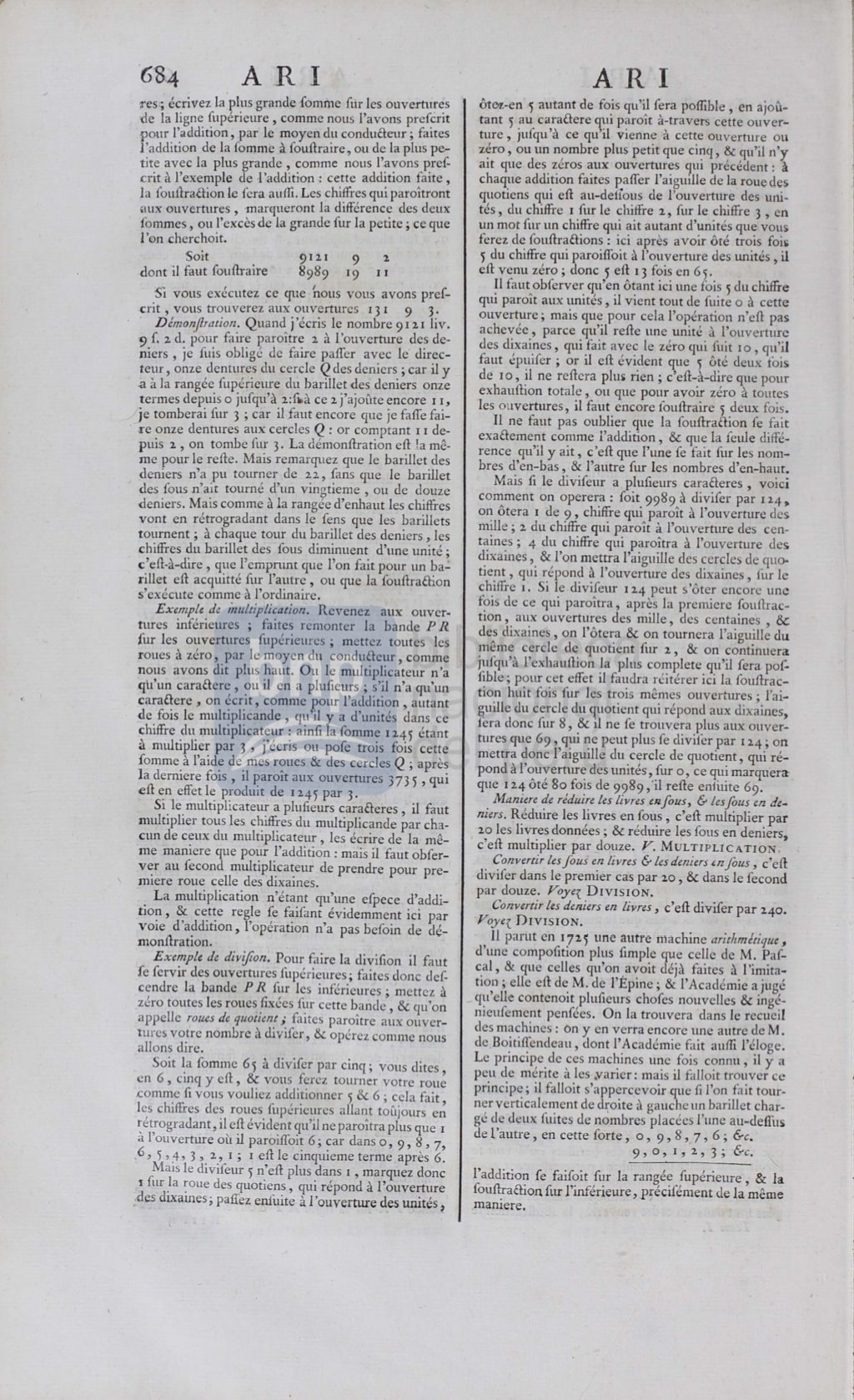
A R 1
Tes:
écrivez
la
plus grande {omme fur les
ouvertur~s
de ia ligne fupérieure , comme nous I'avons pre(cnt
pour I'addition, par le moyen
d~1
conduéteur ; faltes
l'addition de la fomme a foufiralre, ou de la plus pe–
tite avec la plus grande, comme nous
l'~yons ~ref
crit il l'exemple de l'addition: ce.tte
ad~tlOn ~alte,
la foufira8:ion le fera aufli. Les chl/fres qUl paroltront
aux ouvertures , ·marc:¡ueront la
di/férenc~
des deux
fommes, ou
!'exd~s
de la grande fur la peme; ce que
I'(j)n cherchOlt.
Soit
9 121
9
dont il faut foufuaire
8989 19 11
Si
vous exécutez ce que rtous vous avons pref–
erit vous trouverez ame ouverturcs
13 1
9
3·
Démonj!ratÍon.
Quand j'écris le nombre
9121
Iiv.
'9.
f.
2
d: POU!
fai.r~ ~aroltn::
2
a
l'ouverture
de~
de–
mers , Je fUlS obhge de falre pa/fer
av.ecle
dlr~c
teur onze dentures du cercle
Q
des demers ; car
iI
y
.a
a
I~
rangée fupérienre du barillet des den.iers onze
termes depuis o jufqu'a.2:fl.a ce 2j'ajollte
~ncore
1
~,
je tomberai fur 3 ; car
iI
faut encore que Je fa/fe fal-
. re onze dentures aux cercles
8- :
01'
co~ptant ~
1
d;–
puis
2
on tombe fur 3. La aemonfuatlon efi ·a me–
me
po~r
le refie. Mais remarquez que le barillet.des
deniers n'a pu tonrner de
22,
fans que le banllet
des (ous n'ait tourné d'un vin
9
tieme , ou de douze
¿eniers. Mais comme
a
la rangee d'enhaut les chiffres
vont en rétrogradant dans le fens que les barillets
tournent ·
a
chaque tour du bar.illet des deniers , les
ehiffres
~
barillet des fous diminuent d'une unité ;
c'efi-a-dire , que I'empmnt que I'on fait pour un
~a
rillet efi acc¡uitté [ur I'alltre, ou que la foufira&on
s'exécute comme a I'ordinaire.
ExempLe de inultiplication.
Revenez aux ouver–
tures inférieures ; faites remonter la bande
P R
fur les ouvertures fupérieures; mettez toutes les
roues
a
zéro, par le moyen du conduéteur, comme
nous avons dit plus haut. Ou le multiplicateur n'a
qlúm caraétere , ou
iI
en a pluiieurs ; s'il n'a qu'un
caraétere, on écrit, comme pour l'addition, autant
de fois le multiplicande , Cju'i1 y a d'unités dans ce
ehi/fre du multiplicateur : ainíi la fomme 1245 étant
il multiplier par 3, j'écris ou po(e trois fois cette
fomme a I'aide de mes roues
&
des cercles
Q
; apres
la derniere fois , il paroit aux ouvertures 3735 , qui
efien e/fetle produit de 1245 par 3.
Si le multiplicateur a plufieurs caraéteres , il faut
mnltiplier tous les chi/fres du IDlútiplieande par cha–
Clm de eeux du multiplieateur, les écrire de la me–
me maniere que pour I'addition : mais il fant obfer–
ver au feeond mnltiplicatenr de prendre pour pre–
miere roue celle des dixaines.
La multiplication n'étant qu'une efpece d'addi–
tion,
&
cette regle fe faifant évidemment ici par
voie d'addition, I'opération n'a pas befoin de dé–
monfuation.
Exemple de divijion.
Pour faire la diviíion il faut
fe fervir des ouvertures fupérieures; faites donc def–
cendre la bande
P R
fur les inférieures; mettez a
zéro tOtltes les roues fixées fur ceUe bande ,
&
qu'on
appelle
roues de qllotient;
faites paroltre aux ouver–
tures votre nombre a divifer,
&
opérez comme nous
allons dire.
Soit la fomme 65
a
divifer par cinq ; vous dites,
en 6 , cinq y eft,
&
vous ferez tourner votre roue
.comme fi vous vouliez additionner 5
&
6 ; cela fait,
les chilfres des roues fupérienres allant tofljours en
rétrogradant, il eft évident Cju'il neparoltra plus que
1
a
I'ouverture oll
.iI
paroi/foit 6; car dans o, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3 ,
2, 1; 1
eft le cinquieme terme apres 6.
Mais le divifeur 5n'eft plus dans
1,
marquez donc
1
fur la roue des quotiens , qui répond a I'ouverture
des dixaines; pa/fez enfuite
a
J
'ouverture des unités?
A R 1
otez-en 5 autant de fois qu'il fera po/ftble, en ajo(l–
tant 5 au earallere qui paro!t a-travers cette ouver–
ture, jufqu ';). ce Cju'il
vieon~
a
ce~e
ouvertu::e
~11
'Zéro,
011
un nombre plus petlt qlle
ClOq,
&
qu
iI
n
y
ait que des zéros aux ouvertures qui précédent:
a
chaque addition faites pa/fer I'aiguille de la
roued~s
quotiens 'luí eft au-deftous de I'ouvertur.e des um–
tés du chi./fre
1
fur le chilfre
2,
fur le clufTre 3 , en
un :Oot fur un chilfre qtú ait autant d'unités que vous
ferez de (ollftra&ons : ici apres avoir oté trois foi,
5 du chi/fre qtlÍ paroi/foit il l'ouverture des unités ,
il
efi venu zéro ; donc 5 eft
1
3 fois en 65.
II faut obferver Cju'en otant ici une fois 5du chiffi-e
qtti parolt aux un.ités , il vient tout de fuite o a cette
ouverture; mais que pour cela l'opération n'efi pas
achevée, paree qu'il refte une unité
a
l'ouvertur.e
des dixaines, qtti fait avec le zéro qlti Cuit
10,
ql¡'¡l
faut épuifer ;
01'
iI
eft évident que 5 oté deux fois
de
10,
il ne reftera piu, rien ; c'eft-.a-di,re que pour
exhauftion totale , on que pour avoll' zero atontes
les ouvertnres, il faut encore foufuaire 5 deux fois.
Il ne faut pas oublier que la fouftraélion fe .rait
exaétement comme l'addition,
&
que la feule dl/fé–
rence qu'i1 y ait, c'eft que l'tme fe fait fur les nom–
bres d'en-bas
&
l'autre fur les nombres d'en-haut.
Mais
fi
le clivifeur a pluueurs caraéteres , voici
comment on operera : [oit 9989 a divi[er par
124.
on otera
1
de 9, chilfre qui parolt
a
I'ouvertllre des
rn.ille ;
2
du chilfre qui parolt
a
l'ouvertllre des cen–
taines ; 4 du chilfre qui paroltra a l'ouverture des
dixaines,
&
I'on mettra I'aiguille des cercle de que–
tient, qui répond a I'ouvertlll'e des dixaines, fur le
chifTre
I.
Si le divifeur 124 peut
~
'oter encore une
fois de ee qui paroltra, apres la prern.iere foufuac–
rion, aux ouvertures des mille, des centaines ,
&
des dixaines, on l'otera
&
on tournera l'aiguille du
meme cercle de quotient {m
2,
&
on continuera
jufqu'a l'exhaufiion la plus complete qu'i1 fera pof.
fible; pOlll' cet e/fet
iI
faudra réitérer ici la fouftrac–
rion huit fois fm les trois memes ouvertmes ; l'ai–
guille du cercle du quotient qui répond aux dixaines,
lera donc fur 8,
&
il ne fe trouvera plus aux ouver–
tllres qtle 69,
qui
oe peut plus fe diviler par
114;
on
mettra donc I'aiguille du cercle de qtlotient, qui ré–
pond ill'ouvertme des unités, fur o, ce qtlÍ marquera–
que
124
oté 80 fois de
9989,'il
refte enli.tite 69.
Maniere de rédllire les
livr~s
t1zJous,
&
lesJous en de–
niers.
Réduire les livres en fOllS , c'eft multiplier par
20
les livres données ;
&
réduire les fous en deniers,
c'eft multiplier par douze.
r.
MULTIPLICATION
Convertir lesjóus en Livres
&
lesdeniers cnJous,
c'efi
divifer dans le premier cas par
20,
&
dans le fecond
par douze.
Voye{
DIVISION.
ConvertÍr les deniers en livres,
c'eft divifer par 24
0 •
Voye{
DIVISlON.
11 parut en 1725 une autre machine
arithmétiqllt,
d'tme compofition plus fimple que celle de M. Paf–
cal,
&
qtle celles qu'on avoit déja faites a l'imita–
tion; elle eft de M. de l'Épine;
&
l'Académie a jugé
qu'elle contenoit pluíiems chofes nouvelles
&
ing~nieufement penfées. On la trOllvera dans le recuel(
des machines : on y en yerra encore une autre de M.
de BoitiíI'endeau, dont l'Académie fait aufli I'éloge.
Le principe de ces machines une fois connu, il Y a
peu de mérite
a
les yarier: mais
il
falloit trouver ce
príncipe; il falloit s'appercevoir qtle fi I'on.fait tour–
nerverticalement de droite a aaucheun banllet char–
gé de deux (uites de nombres"plaeées l'llne au-deífus
de l'autl'e , en cetre forte, o, 9, 8 , 7, 6;
&c.
~2,3;&c.
I'addition fe faifoit
(lIT
la rangée fupérieure,
&
la
foufuailion fur J'inférieure,p,écifément de la
me
me
maniere.
















