
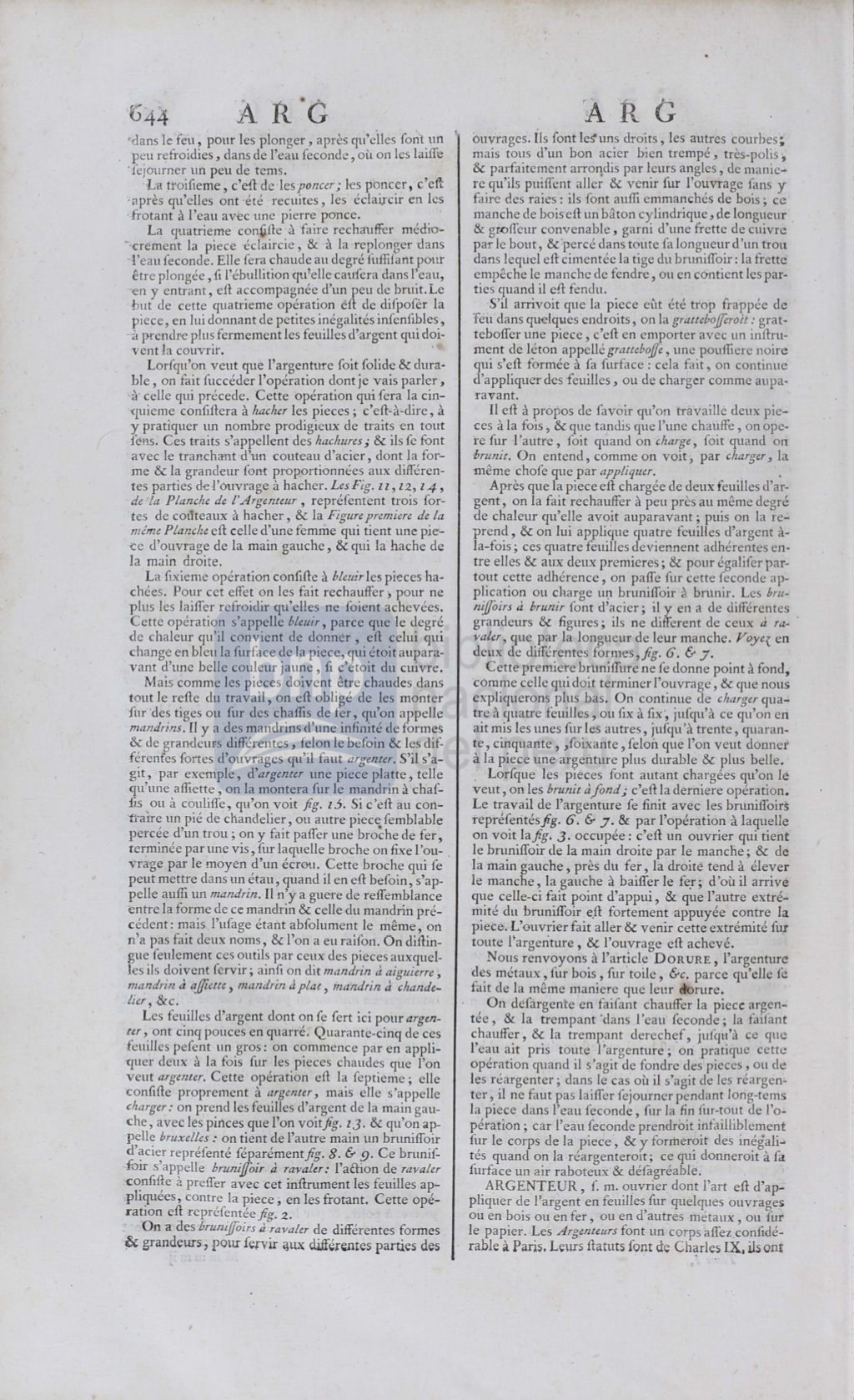
'dans le fen, pour les plonger , apres qu'eiles fonl: un
peu refroidies , dans de l'eau feconde, Ol! on les laiffe
.ú!journer un peu de tems.
La t1'Oifieme, c'ef1: de
lesponcer;
l-es poncer, c'eft
'apres qu'elles ont ·été recuites, les éclai.rcir en les
frotant
a
l'eau avec une pierre ponce.
La quatrieme conVne
a.
faire rechaufFer médiú-
-'crement la pieceéclaircie,
&
a
la replonger -dans
l'
eau feconde. Elle fera chaude au degré fuffiÜlI1t ponr
etre plongée, fi I'ébullition qu1elle catrfera dans I'eau,
-en
y
entrant, en
a~compag,né~
d'un peu
d~
brui.t. Le
but de cette quatrleme operatlon
ea
de difpofer la
piece, en luí donnant de petites inégalités infenfibles,
a
j}fendr-e plus fermement les feuilles
d~argent
qui doi-
vent la couvrir.
.
Lorfqu'on veut que l'argentttte foit folide & dura–
ble, on fait fuccéder l'opération dont je vais parler ,
a
celle qui précede. Cette opération quí {era la cin–
-<luieme confiliera
a
hacher
les pieces; c'ea-a-dire,
a
y
pratlquer un nombre prodigieux de traits en tout
féns. Ces t-raits s'appellent des
hachures
j
& ils fe ront
avec le traRchant d'un couteau d'acier, dont la for–
me & la grandeur font proportionnées aux différen–
res parties dd'otlvrage
a
hachero
LesFig.
ll, l2, l4,
de la Planche de l'Argenteur,
repré{entent trois for–
tes de coüteaux a hacher, & la
Figure premiere de la
méme Planche
ea
celle d'une femme qui tient une pie–
ce d'ouvrage de la maín gauche, & qui la hache de
la main droite.
La íixieme opération coníifie a
blettir
les pieces ha–
chées. Pour cet effet on les fait rechauffer , pour nc
plus les laiífer refroidir qti'elles ne foient achevées.
Cette opération s'appelle
bLettir,
parce qtle le degré
de chaleur qu'il convient de donner,
ea
celui qui
change en bleula furface de la piece,
~tÚ
étoitaupara–
vant d'une belle couleur jaune , íi c'etoit du ctúvre.
Mais comme les pieces doívent etre chaudes dans
tout le reae du travail, on ea obligé de les monter
fur des tiges ou fur des chaffis de fer, qtt'on appelle
mandrins.
I1 Y
a des mandrins d'une inlinité de formes
& de grandeurs différentes, felon le befoin & les diE–
féren(es Cortes d'ouvrages qu'il faut
argenter.
S'il s'a–
git, par exemple, d'
argenter
une piece platte, telle
qu'une affiette , on la montera fur le mandrin
a
chaf–
fis ou
a
couliífe, qu'on voit
jig.
¿jo
Si
c'ea
au coIl.–
'traITe un pié de chandelier , ou atltre piece femblable
percée d'un trou ; on y fait palfer une
bro~he
de fer,
terminée par une vis, fUf laquelle broche on me l'ou- ,
vrage par le moyen d'un écrou. Cette broche qui fe
peutmettre dans un étau, qlland il en
ea
befoin, s'ap–
pelle auffi un
mandrin.
Il
n'y a guere de reífemblance
entre la forme de ce mandrin & celle du mandrin pré–
cédent: mais I'ufage étant ab{olument le meme, on
n'a pas fait deux noms, & l'on a eu raifon. On
diftin–
gue feulement cesoutils par ceux des piecesauxqtlel–
les ils doivent fervir; ainíi on dit
mandrin ti aiguierre,
mandrill ti a./fiette, mandrin
a
plal,
mandrin ti ,hande–
iíer,
&c.
Les fetúlles d'argent dont on fe fert ici pour
argen–
ter
"
ont cinq pouces en qtlarré. Quarante-cinq de ces
fellllles pefent un gros: on commence par en appli–
'quer deux
a
la fois fUf les pieces chaudes que l'on
veut
argenter.
Cette opération en la feptieme; elle
confilie proprement
a
argenter,
mais elle s'appelle
d,arger :
on prend les feuilles d'argent de la main gau–
che, avec les pinces qtle l'on voitjig.
l3.
& qu'on ap–
pelle
bruxeLLes
:
on tient de l'autre maln un bruniífoir
d'~cier
repréfenté féparémentjig.
8.
&
9.
Ce bnmif–
:fOlT
s'appelle
bruni/foir ti rayaltr:
l'aélion de
rayaler
c~nfi~e
a
preífer avec cet inílrument les feuilles ap–
phquees, COntre la piece, en les frotant. Cette opé–
ration efi repré{entéefig.
2.
On a des
hruniffoirs
a
ravaler
de différentes formes
~
grandeurs ,
ponr
fenir
ílUX
cWfére.ntes parties des
, ol1vrages. i1s font leS'uns droits, les autres courbes;
mais tous d'un bon acier bien trempé, tres-polis,
& parfaitement alTor¡dis par leurs angles, de manie–
re qu'ils puíífent aUer & venir fur I'ouvrage fans
y
faire des raies : ils font auffi emmanchés de bois; ce
manche de bois ea un bilton cylindrique, de longueur
&
gwífeur convenable , garni d'une frette de cuivre
pade bOtlt, &percé dans toure fa longueur d'un tron
dalls lequel efi cimentée la tige du bruniffoir: la frette
empeche le manche de fendre, ou en contient lespar–
ties quand il e!l: fendu.
S'il arrivoit qtle la piece eih été trop frappée de
'[eu dansquelques endroits, on la
gratttbofferoit:
grat–
teboífer une piece, e'efi en emporter avec un inaru–
ment de léton appellé
gratteboJlé,
une pouffiere noire
qui
s'ea
formée a fa furface : cela fait, on continue
d'appliqtler des fetúlles, ou de charger comme aupa–
-ravant.
II
eil: a propos de favoir qu'on travaille deux pie–
ces
a
la fois , & que tandis que l'une chaufFe , on ope–
re (ur l'autre, foit qtland on
cltarge, Coit
qtland on
imUlit.
On entend, comme on voit, par
clzarger,
la
meme chofe que par
appliqtter.
.
Apres que la piece
ea
chargée de deux feuillesd'ar–
gent, on la fait rechauifer
a
peu pres au meme degré
de chaleur qu'elle avoit auparavant; ptúS on la re–
prend, & on luí applique qtlatre feuilles d'argent
a–
Ja-fois.; ces quatre feuilles deviennent adhérentes en–
tre elles & aux detL"í premieres; & pour égalifer par–
tout cette adhérence, on palfe fur cette feconde ap–
plication ou charge
u~
bruniífoir
¡)
bnlnir. Les
bm–
niffoirs ti brunir
font d'acier ; il
Y
en a de différentes
grandeurs & figures.; ils ne different de ceux
ti ra- .
yaler,
que par la longueur de lem manche.
Voye"
en
deux de différentes formes,jig.
6.
&
:J.
eette premiere brllnilfure ne fe donne point a fond,
COmme celle qui doit terminer I'ouvrage, & qtle nous
expliquerons plus bas. On eontinue de
cltarger
qua–
tre
a
c¡uatre feuilles, ou {¡x
a
fix~
jufqu'a ce q1l'on en
ait mis lesunes fur les autres, jufqu
'a
trente, qtlaran–
te, cinqllante, ,foixante, felon que I'on vellt doonet
a
la piece une argenture plus durable & plus belle.
Lorfque les pieces font autant chargées qtl'on le
veut? on les
brttnit tifond
j
c'efi la derniere opération.
Le travail de l'argenture fe finit avec les bruniífoirs
repréfentésfig·
6.
&
:J.
&
par l'opération
a
laqllelle
on voit
lajig.
3.
occupée: c'efi un ouvrier qui tient
le bruniífoir de la main droite par le mancne; & de
la main gauche , pres du fer, la droite tend
a
élever
le manche, la ga1lche
a
baiífer le fe.r; d'on il arrive
qtle celle-ci fait point d'apptú,
&
que l'autre extré–
mité du bruniffoir
e.a
fortement appuyée contre la
piece.L'ouvrier fait aUer & venir cette extrémité fur
toure I'argenture,
&
I'ouvrage
ea
achevé.
Nous renvoyons
a
l'article
DORURE,
I'argenture
des métaux, {ur bois , fur toile,
&c.
parce qu'elle fe
fdit de la meme maniere qtle leur
~orure.
On defargente en faifant chauffer la piecc argen–
tée,
&
la trempant 'dans l'eau feconde; la faiül.l1c
chauffer, & la trempant derechef, jufqu'a ce que
l'eau ait pris toute I'argenrure; on pratique cette
opération qtland il s'agit de fondre des pieces, ou de
les réargenter ; dans le cas on
il
s'agit de les réargen–
ter, il ne faut pas laiífer fejourner pendant long-tems
la piece dans I'eau feconde, fur la fin fm-tout de
1'0-
pération; cal' l'eau feconde prendroit infailliblement
hlr le corps de la
piece,
&
Y
formeroit des
inégali~
tés quand on la réargenteroit; ce qui donneroit
a
fa
huface un air raboteux
&
défagréable.
ARGENTEUR, f. m. ouvrier dOllt
l'art
ea
d'ap–
pliquer de I'argent en feuilles fur quelques ouvrages
ou en bois ou en fer, ou en d'autres métaux, ou
íi.trle papier. Les
Argenleurs
font
1m
corps alfez,confidé–
rabie
a
Paris. LeuJ5
fiatuts
[ont
de
Ch~rle.s
IX..
ils ont
















