
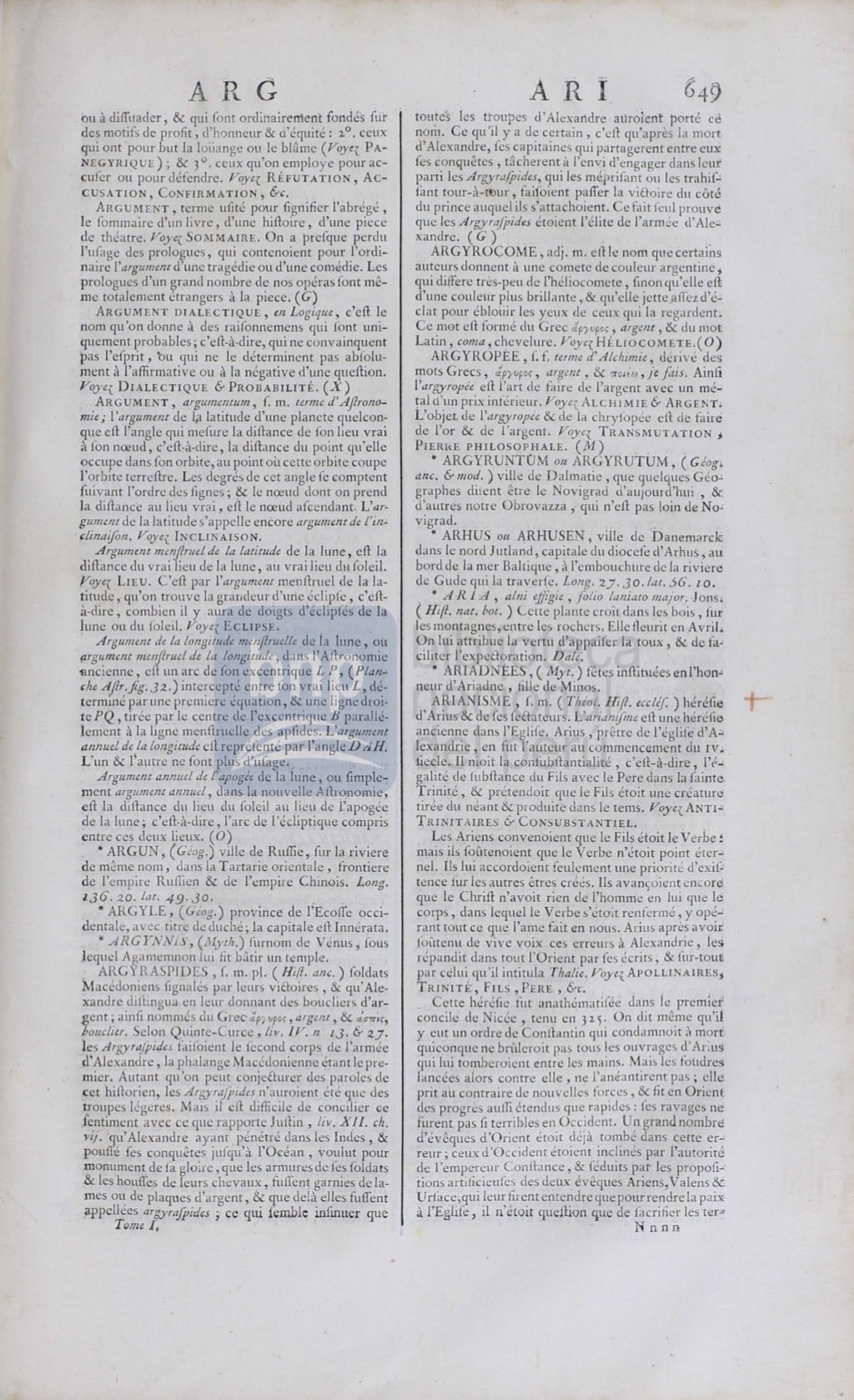
ARe
ou a di/fllader,
&
qui (ont ordinairenlent fondés
(tfr
des motifs de profit, cl'honneur
&
d'équité: 2°. ceux
qlli ont pour but la loiiange ou le bll1me
(Voye{
PA–
NEGYRIQUE) ;
&
3°.
ceux qu'on employe pour ac–
cu(er ou pour défendre.
Voye{
RÉFUTATION , Ac–
CUSATION, CONFIRMATION,
&c.
ARGUMENT, terme ufité pour figrtifier l'abrégé,
le (ommaire d'un livre, d'une hifioire, d'tme piece
de théatre.
Voyt(
50111 MAIRE. On a jn·e[que perdu
l'ulage des prologues, qui contenoient pom l'ordi–
naire
l'argll/llem
d'une tragédie ou d'une eomédie. Les
prologues d'un 9rand nombre de nos opéras (ont me–
me totalement errangers a la piece.
(G)
ARGUMENT DIALECTIQUE,
en Logique,
c;'efi le
nom qu 'on donne a des raifonnemens qui [ont uni–
quement probables; e'efi-a-dire, qui ne eonvainquent
pas l'e{prit, bu qui ne
le
déterminent pas ab{olu–
ment a l'affirmarive ou
a
la négative d'une quefiion.
VC{Ye{
DIALECTIQUE
&
PROBABILITÉ.
(X)
ARGUMENT,
argumenwm,
(.
m.
tenlle d'Aflrollo–
mie; l'argumwt
de
l¡¡
latitude d'une planete quelcon–
que efi l'angle qlli me{me la difianee de fon lieu vrai
a
(on nreud, c'efi-a-dire, la difiance du point clu'elle
occupe dans (on orbite, au point Oll cette orbite coupe
]'orbite terrefue. Les degrés de cer angle (e comptent
fuivant l'ordre des fignes;
1X:
le nreud dont on prend
la difiance au lieu vrai, efi le nreud a(cendant. L'
ar–
gwnelll
de la latitudes'appelle encore
argumemde tillo
~lillaifon.
Vc¡ye{
lNCLINAISON.
Argumem men(lmel de la latitude
de la lune, efi la
difianee du vrai 1ieu de
la
lune, au vrai lieu du (oleil.
Voye{
LIEu. C'efi par
l'argume/lt
menfuuel de la la–
titude, qu'on trouve la grandeur d'urie éclip(e, c'efi–
a-dire , combien il y aura de doigts d'éclipCés de la
lune ou du loleil.
Voye{
ECLIPSE,
Argumellt de la longitude menftmelle
de 1a lune, ou
(lrgument men(lruel de la longimde,
dans
l'
Afironomie
llneienne, eí'f un are de (on excentrique
L
P,
(Plan~
elLe Ajlr.
.fig.
32.)
intercepté entre (on vrai lieu
L,
dé–
termmé par une premiere éqllation,
&
une ligne droi–
te
PQ,
tirée par le centre de l'excentrique
B
paraJlé–
¡ement a la ligne menfiruelle des apfides.
L'argumelll
allnlleL
d~
la longitude
efirepré(enté par l'angleD
¿iH.
L'un
&
l;autre ne (ont plus d'u(age..
Argllmellt allllud de l'apogée
de la lune, ou limple–
iTlent
argllment annllel,
dans la nouvelle Afironomie,
efi la difianee du lieu du (oleil au lieu de I'apogée
de la lune; c'efi-a-dire, I'arc de l'éelipticlue compris
entre ces deux lieux.
(O)
.. ARGUN,
(G¿og.)
ville de Ruffie, (m la riviere
de meme nom, dans la Tartarie orientale, frontiere
de l'empire Ruffien
&
de l'empile Chinois.
Long.
l36. 20.
lato
49.30.
.
" ARGYLE,
(Geog.)
province de l'Eeoífe oeei–
dentale, avec ritre deduché; la capitale efi Innérata.
..
ARGYNNiS, (f,fJ'tIL.)
(urnom de Vénus, (ous
Jequel Agamemnon lui nt batir un temple.
. ARGYR ASPIDE5 ,
f.
m. pI. (
Hi(l. anc.
)
{eldats
Maeédoniens lignalés par leurs viétoires,
&
qu'Ale–
xandre difiingu3 en leurdonnant des boucliers d'ar–
gent; ainíi nomm 's du
Grecctpl'up'~,
argelll,
&
d.q7T;~,
boudier.
Selon Quinte-Curee,
liv.
IV.
n 13.
&
2].
lesArgyr1Pid~s
failoient le lecond corps de I'armée
d'Alexandre, la phalange Macédonienne étant le pre–
mier. Aurant qu'on peut conjeéturer des paroles de
cet hifiorien, les
Argyralpides
n'auroient été que des
troupes légeres. Mais il efi diffieile de concilier ce
lentiment avec ce que rappone Julhn,
tiv. XlI. ch.
vij.
qu'Alexandre ayant p 'nétré dans les Indcs,
&
pOlllfé [es conquetes ju(qll'a l'Océan , voulut pour
monument de la gloire, que les armures de fes (oldats
&
les hOllífes de leurs chevaux , ntífent garnies de la–
mes ou de plaques d'argent,
&
que dela elles nlífent
appellées
argyrafpides
;
ce
qtÚ
iemble
in(u1lLer que
Tome
l.
A R
1
tou~es
les
t~ollpes
d'Alexaridre atlrolent porté ce
nomo Ce qu'd ya de certain, c'efi qu'apres la morE
d'AlexancJ¡·e, {es capitaines qui partagerent entre eux:
(es ".onquetes , racherent.a I'en,:i d:engager dans leuf
parn les
Argyra/jJ/des,
qm les me m(ant ou les trahi(..:
lant rOllr-a-rour , faifoient palfer la viétoire du coté
du prince auquelils s'attaehoient. Cefait (eul prouve
que les
Argyrafpides
éteient l'élite de I'armée d'Ale-
xandre.
(G)
..
ARGYROCOME, adj. m. eíl:le nom quecertains
auteurs donnent
it
une comete de couleur argentine,
'luí differe tres-peu de l'héliocomete, Iinonqu'eIle eíl:
d'une couleur plus brillante,
&
qu'eIle jette aífez d'é–
clat pour ébloiür les yeux de eeux qui la regardent.
Ce m0t efi formé du Gree
ctp"upo~
,
argmt,
&
du mot
Latin,
cOl1la,c~eve!tue.
Voye{HÉLlOCOMETE.(O)
ARGYROPEE,
f.
f.
mme d'Alclzimie,
dérivé des
mors Grecs,
"¡;p"up'~ ,
argem
&
7TOl!'.
,je
fais.
Ainli
I'argyropé.
efi I'art de faire de I'argent avec un mé–
~ald'un
prixinférieur.
Voye{ ALCHIMIE
&
ARGENT.
L'objet de
l'argyropée
&
de
la
chrylopée efi de faire
de I'or
&
de l'argent.
Voye{
TRA SMUTATION ;
PIERI<E PHILOSOPHALE.
(M)
..
.. ARGYRUNTDM
O¡t
ARGYRUTUM,
(GéoO"¡
allc.
&
modo
)
vilIe de Dalmatie , que quelques
Gé~;
graphes di1ent etre
1
Novigrad d'aujourd'hui ,
&
d'autres notre Obrovazza ,-qni n'efi pas !ein de No'
v~m~
.
.. ARHUS
ou
ARHU EN, vilIe de ·Danemarek
dans le nord Jutland, capitale du dioce(e d'Arhus, al!
bord de
la
mer Baltique, a l'embouchlLre de la riviere
de Gude qui la traveríe.
L.ong.
27.
30.lat.
.56.
LO.
. ..
A
R
i
A
,
alni efligie
,
folio laniaco major.
-J
on5.
(
Hifl. nato boto
)
Cene plante crol! dans les bois , (ur
les montagnes, entre les rochers. Elle flemit en Avril.
On lui ,!trribue la verttl d'appai(er la toux,
&
de fa–
ciliter I'expeétoration.
Dale.
" ARIADNÉES,
(Myt.)
retes infiituées enl'hon–
neur d'Ariadne , fille de Minos.
ARIANISME , f. m. (
TMot. Hifl. eceléf
)
héréfie
t–
d'Arius
&
de les (eétateurs.
L'.t"iallifme
efi une héréfie
ancienne
dan~
l'Egli(e. Arius, pretre de l'égli{e d'A.::
lexandrie, en nlt l'auteu!" au commencement dll
IV.
fieele.
fI
nioit la con[ubfiantialité , c'efi-a-dire,
l'~-
galité
de
lübfiance du Fils avec
le
Pere dans
la
[ainte
Trinité,
&
prétendoit que le Fils éto!t une eréature
tirée dll néant
&
produité dans le tems.
Voye{
ANTI–
TRINITAIRES
&
CONSUBSTANTIEL.
Les Ariens convenoient que le Fils étoit le Verbe!
mais
ils
(outenoient que le Verbe n'étoit point éter–
ne!. lis lui accordoient (eulement une priorité d'exif..
tence
(lU
les autres etres eréés. lis
avan~oicnt
encore
que
le
Chrifi n'avoit rien de l'homme en lui que le
corps, dans lequelle Verbe s'éroit renfermé ,y opé–
rant tollt ce que l'ame fait en nous. Ariu apres avoir
(outenu de vive voix ces erreurs
a
Alexandrie, les
répandit dans tout l'Orient par (es éeritS,
&
(ur-touE
par celui qu 'il intitula
T/¿alú. Voye{
ApOLLINAIRE8;
TRINITÉ", FILS , PERE ,
&c.
Cette hérélie fut anathémati{ée dans le premier
concile de Nieée , tenu en
325.
On dit meme qu'il
y
eut un ordre de Confiantin qui cóndamnoit
a
morr
qlliconqlle ne brúleroit pas tous
les
ollvrages d'Arius
qui lui tomberoient entre les mains. Mais les fottdre
lancées alors contre elle, ne I'anéantirent pas ; elle
prit au contraire de nouvelle forces,
&
nt en Orient
des proO"res auffi étendus que rapides: {es ravages ne
furent pas Ii terribles en Oecident. Un grand nombré
d'éveqlles d'Orient étoit déja tombé dans eette er..:
reur; cellX d 'Oecident étoient inclinés par
l'alltorit~
de
1
'emperem Confiance,
&
(édllits pat les propoli..:
tions artificiell(es des deux éveques Ariens,Valens &
Urface,qlli leur firent entendre que pourrendre la paL"l<
a
l'Egli(e,
il
n'étoit queíhon que de lacrifier les ter"
N
nnn
















