
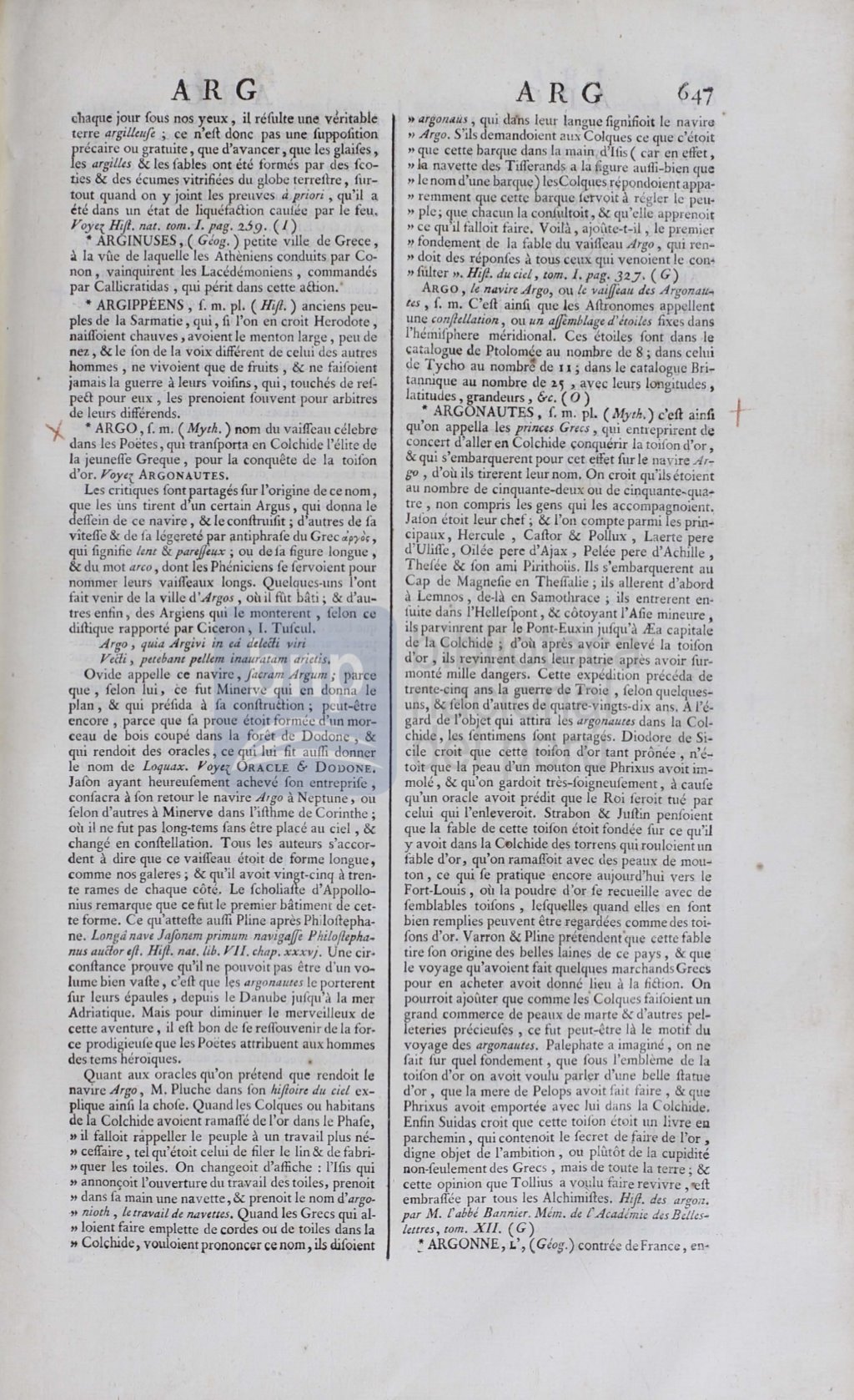
ARG
chaque jour (ous nos yeux,
il
réfulte uno vJritable
terre
argiL/euft
;
ce n'eft. dQne pas une (uppoiition
précaire ou gratuite, que d'avancer ,que les glaifes ,
les
argilles
&
les fables ont été formés par des (co–
ries
&
des écumes vitrifiées du globe terreílre, fm–
tout quand on y joint les preuvcs
ti
Friori
,qu'il
a.
été dans un état de Equéfaaion cauLee par le feu,.
roye\.
Hifi.
nato tomo l. pago
2.59.
(J)
.. ARGINUSES, (
Géog.
)
petite vilLe de Crece,
a
la vUe de laquelle les Atheniens conduits par Co–
non, vainquirent les Lacédémoniens , commandés
par Callicratidas ,
quj
périt dans cette afuon.
.. ARCIPPÉENS ,
f.
m. pI.
(Hifl.
)
aneiens peu–
pIes de la Sarmatie, qui, ii I'on en croit Herodote ,
naiífoient chauves, avoient le menton large , peu de
nez,
&
le fon de la voix différenr de celui des auttes
hommes , ne vivoient que de fruits ,
&
ne faifoient
jamais la guerre
a
leurs voifms, qui, touchés de
reC–
pea pour eux , les prenoient fOllvent pour arbitres
de leurs di/férends.
.. ARCO,
f.
m. (
Myth.
)
nom du vaiífeall célebre
dans les Poetes, qll1 tranCporta en Colchide l'élite de
la jeuneífe Greque, pour la conquete de la toi{on
d'or.
roye\.
ARGONAuTEs.
Les critiques fontpartagés (ur I'origine de ee nom,
que les uns tirent d un certain Argus, qui doona le
deífein de ce navire ,
&
le coníl:miiit ; d'autres de (a
v1teífe & de (a légercté par antiphraCe du Grec
d.P?'~"
qui iignifie
lent
&pare.fleux;
ou deía figure longue,
&
du mot
arco ,
dont les Phéniciens (e fervoient pour
nommer leurs vaiífeaux longs. QlIelques-uns I'ont
fait venir de la ville
d'Argos
,
oh il fUt batí; & d'au–
tres enfin, des Argiens qui le monterenr , (elon ce
difuque rapporté par Cieeron,
I.
Tu(cul.
4rgo, quia Argivi in ea dtleéli viri
reai, petebam pellem inauratam arie/is.
O vide appelle ce narue,
facram Argum;
parce
que, (elon lui, ce fil! Minerve qui en donna le
plan,
&
qui préiida
a
(a confiruaion ; peut-etre
encore , parce que (a proue étoit formée d'un mor–
ceau de bois coupé dans la foret de D odone ,
&
qui rendoit des oracles, ce qui
lui
fit auffi donner
le nom de
L0'luax. floye{
ORACLE
&
D OUONE.
JalOn ayant heureufement achevé fon entrepri(c ,
confacra
a
(on retour le navire
¿ligo
a
Neptune, ou
(elon d'autres
a
Minerve dans I'ifihme de Corinthe ;
ol! il ne fut pas long-tems fans etre placé au cie! ,
&
changé en confiellation. Tous les auteurs s'aceor–
dent
a
dice que ce vaiífeau étoit de forme longuc,
comme nos galeres ;
&
~u'il
avoit vingt-cinq
iI
tren–
te rames de chaque cote. Le fcholiafie d'Appollo–
nius remarque que ce fut le premier batiment de cet–
te forme. Ce qu'attefie auffi Pline apres Philoílepha–
neo
Longdnave laJonem primum navigaJ[e P¡'ilo(lepha–
nus
auaor
ejl.
Hifl.
na/.lib.
VII.
chapo xxxv).
Une cir–
confiance prouve qu'i1 ne pouvoit pas etre d'un vo–
lume bien vafie, c'efi que les
argonaules
le porrerent
{ur lenrs épaules , depuis le Danube ju{qu'a la mer
Adriatique. Mais pOltr diminuer le merveilleux de
cette aventure,
iI
efi bon de fe reífouvenir de la for–
ce prodigieu{e que les Poetes attribuent aux hommes
des tems héroiques.
.
Quant aux oracles qu'on prétend que rendoit le
narue
Argo,
M. Pluche dans fon
/¡ijloire da ciel
ex–
plique ainfi la chofe. Quand les Colques ou habitans
de la Colchide avoient ramaífé de l'or dans le Phafe,
»il falloit ráppeller le peuple
a
un travail plus né–
>1
ceífaire, tel qu'étoit celui de filer le lin& de fabri–
>1
quer les toiles. On changeoit d'affiche : l'lfis qui
"
annon~oit
I'ouverture du tra:vail des toiles, prenoit
" dans fa main une navette,
&
prenoit le nom d'
argo–
"
niot/¡, !elravail de naveues.
Quand les Grecs qui al–
" loient faire emplette de cordes OU de toiles dans la
ti
Cokhide) vouloient prononcer ce nom,
i1s
difoient
ARG
;1
argonflll:,
,
qui da'ns
~eur
iangue fignifioit le navira
II
Argo.
S lIs demandOlent aux Colques ce que c'étoit
"que certe barC¡
l.Iedans la main d'lfis ( car en effet,
'1
la navecte des Tiiferands a la figure auffi-bien que
1>
lenom d'une barc¡ue) lesColques
r~pondoient
appa–
" remment que eette barguc {ervoir
a
régler le peu–
" pIe; que chacun la con,Cultoit,
&
qu'c!le apprenoit
1>
ce qu'il falloit faire. Voilit, ajo(he-t-i1 , le premier
'/ fondc;;ment de la fable du vaiífeau
Argo,
qui ren-
1>
doit des réponfes
a
tous ceux qui venoient le con–
" fúlter
1>.
HiJ!.
du
eie~,
iom.
l.
pago
32.7, (
G)
ARGO,
le
navireArgo,
0 \1
le vaif{eaa des Argonau.,
w,
r.
m. C'efi ainí¡ que ¡es Afironomes appellent
une
con(lellation,
ou
UIJ.
a.lfemblage d'étoiles
fixes dans
l'hémifphere méridional. Ces étoiles font dans le
catalogue de Ptolomée au nombre de 8 ; dans celui
de
~ycho
au nombré de
1
J ;
dans le catalogue Bri–
tal~mque
au nombre de 1.5 '. avec leuts longitudes ,
lamudes , grandeurs,
&c.
(
O )
*
ARGONAUTBS. f. m. pI.
( Mv'th,)
c'cí!: ainÍl
qu'on appella les
princes Grees,
qui entreprirent de
concert d'aller en Colchide conquérir la roifon d'or ,
&
qui s'embarquerent pour cet effet fur le navire
Ar–
go
,
d'oll ils tirerent leur nomoOn croit qu'ils étoient
au nombre de cinquante-deux ou de
cinquante~qua
tre, n?n .compris les
gen~
qui les accompagnoienr..
la{on etolt leur chef;
&
I
011
compte parmi les priu–
cipallx, Hercule , Cafior
&
Pollux, Laerte pere
d'Uliife, Oilée pere d'Ajax, Pe!ée pere d'Achille ,
The(ée
&
fon ami Pirithoiis. Us s'embarquerent au
Cap de Magnefie en Theífalie; i1s allerenr d'abord
a
Lemnos , de-la en Samothrace ; iIs entrerent en–
fuite dans I'Hellefpont,
&
cotoyant l'Afie mineure,
iIs parvinrent par le Pont-Euxin jllfqu'a lEa capitale
de la Colchide ; d'ol! apres avoir enlevé la toifon
d'or , ils revinrent dans leur patrie apres avoir {ur–
monté mille dangers. Cette expédition précéda de
trente-cinq ans la guerre de Troie , (elon quelaues–
uns,
&
felon d'autres de quatre-vingts-dix ans.
A
I'é–
gard de I'objet qui attiTa les
argonaute5
dans la Col–
chide, les fentimens font partagés. D iodore de Si–
cile croit que cette toifon d'or tant pronée , n'é–
toit que la peau d'un mouton que Phrixus avoit im–
molé,
&
qu'on gardoit tres-{oigneu{ement,
~
cau{e
qu'un oracle avoit prédit que le Roi (eroÍ¡ rué par
celui qui I'enleveroit. Strabon
&
Juilin penfoient
que la fable de cene coi(on étoit fondée fur ce qu'il
y avoit dans la CEllchide des torrens qui rouloient un
fable d'or, qu'on ramaífoit avee des peaux de
mou~
ton , ce qui {e pratique encore aujourd'hui vers le
Fort-Louis, OlI la poudre d'or fe recueille avec de
{emblables toifons, le{quelles quand elles en font
bien remplies peuvent etre regardées comme des roi–
fons d'or. Varron
&
Pline prétendentqlle cetre fable
tire {on origine des belles laines de ce pays,
&
que
le voyage qll'avoient fait quelques marchandsGrecs
pOllr en acheter avoit donné lieu
a
la fiaion. On
pourroit ajoflter que comme les Colques faifoient un
grand commerce de peaux de marte
&
d'autres pel–
leteries préeieu{es , ce filt pell!-etre la le motif du
voyage des
argonautes.
Palephare a imaginé, on ne
fait (ur que! fondernent, que fous l'embleme de la
toifon d'or on avoit VOlÚU
parl~r
d'une belle fiaule
d'or, que la mere de Pelops avoit fait faire ,
&
que
Phrixus avoit emportée avec lui dans la Colchide.
Enfin Suidas croit que cette toiion étoit un livre en
parchemin , qui contenOit le fecrer de faire de I'or ,
digne objet de I'ambitioh, ou pllltot de la cupidité
non-feulement des Grecs , mais de toute la terre ;
&
cerre opinion que Tollius a voulu faire revivre,
íl:
embraífée par touS les Alchimifies.
Hijl. des argon.
par M. l'abú' Bannier. Mim. de l'Acadhnie
d~s
Belles–
!emes, tomo
XII. (G)
~
ARGONNE,
L',
(GloS.)
contrée de France, en-
















