
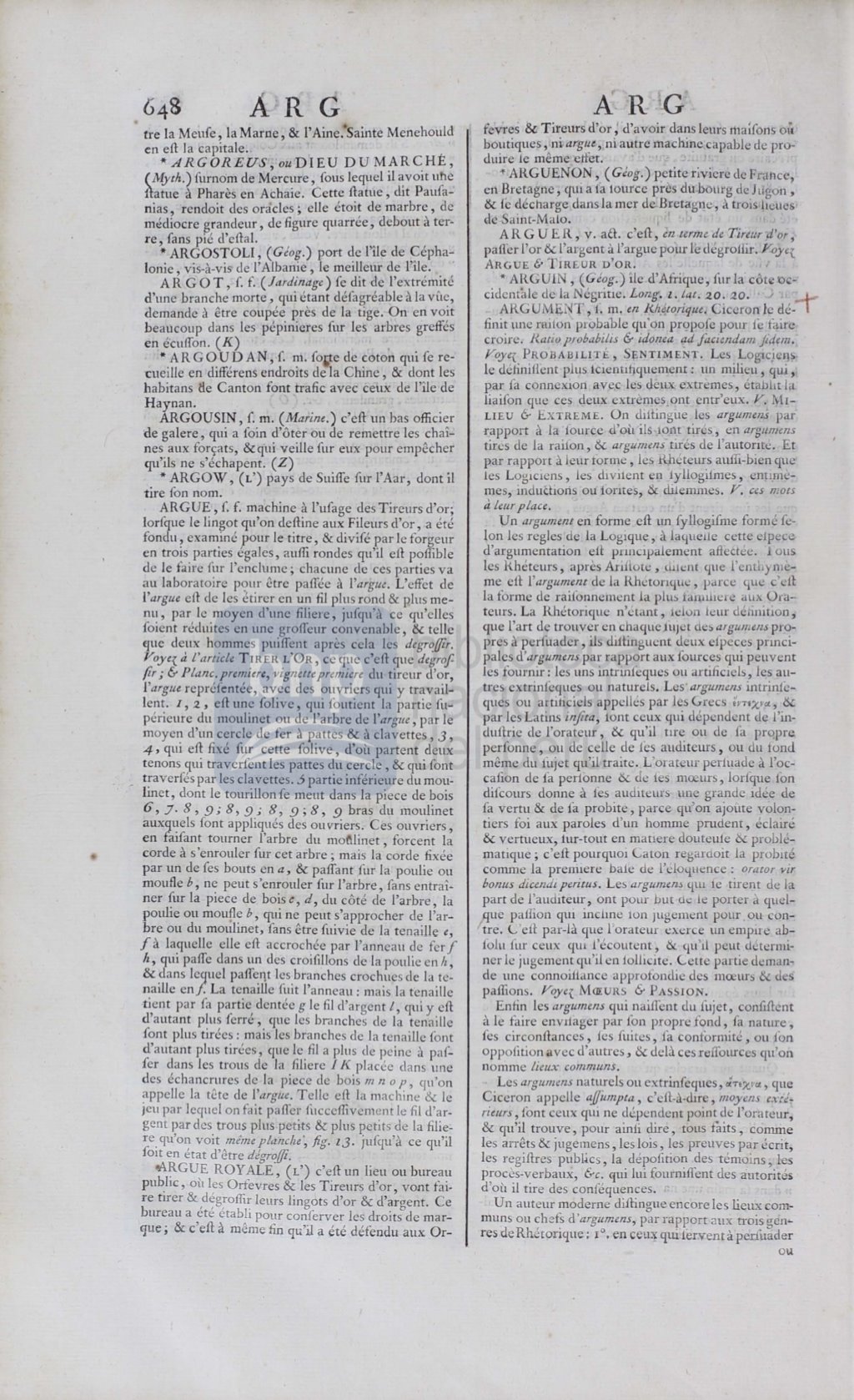
ÁRG
tre la Meufe, la Marne,
&
l'Aine:Sainte Menehollld
en eíl: la capitale.
*
ARGOREUS,
ouDIEU DUMARCHÉ,
(MYlh.)
úunom de Mercme, [ons leque1 il
~voit
lltJe
ftatue
a
Phares en Achaie. Cette íl:atue, dit Paufa–
nias, rendoit des oracles; elle éroit de marbre, de
médiocre grandem, de figure quarree, debout a ter–
re, fans pié d'eíl:al.
*
ARGOSTOLI,
(Giog.)
port de líle de Cépha–
loaie, vis-a-vis de
l'
Albanie, le meilletu de 1'1Ie.
A R G O T , [. f.
(J
ardinage)
[e dit de l'extremité
d'une branche mone, qui etant dé[agreable
a
la vue,
demande a etre coupee pres de la tige. On en voit
beaucoup dans les pépinieres [m les arbres gre/fés
en é'ctúfon.
(K)
*
AR GO UD AN, [. m. [o¡re de coton qui [e re–
'Cueille en di/férens endroits de la Chine,
&
dont les
habitans tie Canton font trafic avec ceux de l'üe de
Haynan.
ARGOUSIN, f. m.
(Marine.)
c'ea un has ofhcier
de galere, qui a [oin d'(¡ter ou de remettre les chal–
nes aux fon;ats, &q'ui veille [ur eux pom empecher
qu'ils ne s'échapent.
(Z)
*
ARGOW, (l') pays de Suilfe [ur l'Aar, dont il
tire ron nomo
ARGU~,
f.
f. machine a l'ufage desTireurs d'or;
lorfqne le I1I1got qu'on deíl:ine aux Fileurs d'or , a éré
fondu, examiné pour le titre,
&
divife par le forgeur
en trois parties égales, auffi rondes qu'il eíl: poffible
de le faire [m l'enclume; chacune de ces parries va
au laboratoire pour etre pa{fee a
I'argue.
L'e/fet de
l'
argue
eíl: de les etirer en un fil plus rond
&
plus me–
nu, par le moyen d'une filiere, jufqu'a ce c¡u'elles
foient reduites en une gro{feur convenable, & telle
fJue deux hommes pui{fent apres cela les
degroJlir.
Voye{
ti
t'articü
TIRER l 'OR, ce que c'eíl: que
degrof
jir;
&
Planc.premiere, vignettepremiere
du tireur d'or,
l'argue
repré[entée, avec des ouvriers qui y travail–
lent.
I,
2.,
eíl: une [olive , qui [outient la partie fu–
périeure du moulinet ou de l'arbre de l'
are7te
par le
moyeI?- d'un cercle de fer
a
pattes &
a
cla~edes
,
3,
4,
qUl eíl: Ii"é
[ur
cette [olive, d'011partent deux
tenons qui traverfent les pattes du cercle , & qui [ont
t!'averfés par les clavettes.
j
partie inférieure du mou–
lmet, dont le tomillon [e meut dans la piece de bois
6, 7· 8, 9; 8,9; 8, 9; 8, 9
bras du moulinet
auxquels font appliqués des ouvriers. Ces ouvriers
en faifant tourner l'arbre du motllinet forcent
l~
corde
a
s'enrOlúer fur cet arbre; mais la'corde tixée
par un de [es bOlltS en
a,
& pa{fant {ur la poulie ou
moufle
b,
ne peut s'enrolúer [ur I'arbre fans entral–
ner [m la piece de bois
e,
d,
du coté
d~
l'arbre , la
pOlilie ou
moufl~
b,
qui ne peut s'approcher de l'ar–
bre ou du moulmet, fans etre [uivie de la tenaille
e,
f
a
la~rllelle
elle eíl: accrochée par l'anneau de fer
f
h,
qtll pa{fe dans un des croifillons de la poulie en
h
& .dans leguel
pa{f~l1t
les.br~nches
croch.ues de
la.te:naille enj: La tenaille (Ult I anneau : malSla fenaIlle
ti,ent par [a parcie,dentée
g
le fil d'argent
l,
qtli
Y
eíl:
d autant plus [erre, que les branches de la tenaiUe
font plus tirées : mais les branches de la tenaille font
d'autant plus tirées, que le til a plus de peine a paf–
fer dans les trous de la filiere
J
K
placée dans une
des échancrures de la piece de bois
m n o
p
qu'on
~ppelle
la tete de
I'argue.
Telle eíl: la
machi~e
& le
¡eu par Jequel on fait parrer lilcceffivement le til d'ar–
gent par des trous plus petits & plus petits de la filie–
re qu'on voit
meme plallche
~
fig. l3.
jufqu'¡\ ce qu'il
fOlt en état d'etre
d,Jgrt1fi.
~~GU,E
ROYALE,
(L')
e'eíl: un lien ou bureau
pllblte, ou les Orfevres & les Tirenrs d'or vont fai–
re tirer
&
,d~groffir
leurs lingots d'or &
d'a~gent.
Ce
bmeau a ete établt pour conferver les droits de mar–
que;
&
e'
ell:
a
meme fin qu'il a été défendu aux Or-
ARG
fevres & Tireurs d'or; d'avoir dans leurs rtIaifons Ol!
boutiques,
ni
argue,
ni autre machine eapable de pro–
duire le meme eJfut.
.. ARGUENON '.
(GJog.)
petite riviere de Frallce,
en Bretagne, qlll a la IOttree pres du bourg de
J
ugon
>
&
le
décllarge dansla mer deBretagl1e,
a
trois ltelles
de Saint-Malo.
ARG
U
ER,
V.
aél:. c'eíl:,
en terme de Tiriur d'or,
palfer l'or & l'argent a l'argue p01U le dégrol!ir.
Yoy'{
ARGUE (/ TJREUR D'OR.
*
ARGUI ,
(Giog.)
tle d'
Afric¡ue,
fuda cÓt€
'O¡;:–
cidentale de la Négriue.
Lonf!.
z.
Lal. 2.0. 2.0.
ARGUMEl T,
r.
m.
en l<hAtori'lue,
Cic ron le dé–
finit lme railon probable qu'on prqpofe pOlll" le faite
croire.
Ratio probabiüs
&
idonea ad faclendam jidem.
Voye~
PROBABILtTÉ, Sl'NTIMENT. Les LOgIcÍe'1s.
le détiniflent plus lciennf¡quemem: un milieu, qw,
par
(,1.
connexion aye.e les <;leltx extremes, étabht la
liaifon que ce; deux extremes.ont entr'eux.
V.
Ml–
LIEU
&
EXTREME. On diltingue les
argumms
par
rappOl1:
a
la louree d'011ils 10nr tirés, en
argumens
tires de la railon , &
argumtlls
nrés de I'autonte. Et
par rappon
a
leur torme, les Rhétems auili-bien que
les Loglclens, les dlvitent en iyllogilmes , enume–
mes, inducbons ou lontes,
&
dli
mmes.
V . ces mOlS
ti
!eur place.
Un
argument
en forme eíl:
ltn
[yllogifine formé [e–
Ion les regles de la Loglque ,
a
laqueHe cette elpece
d'argumentation eÜ punclpalement aftettec. lous
les H.héteurs,
apn~s
Anflote ,
allt:J1[
que l'entllyme–
me ell: l'
argument
de la Rhétonqut:, parce que c'cíl:
la forme de rauonnement la plu. tam111ere
aUA
Ora–
teurs. La Rhéroric¡ue n'étant, tdon leur délinition ,
qlle l'art de trouver en chaquejuJet de;
argumtlls
pro–
pres
a
perfuader,
ils
diilingu nt deux efpeces pnnci–
pales d'
arcumens
par rappon aux fomces qui penvent
Jes fournir: les
l1I1S
intrinieques ou artificlels, les au–
tres extrinjeques ou naturels. Les'
argumtns
intrinfe–
qlles ou artiticiels appell¿s par les Grecs
~V7'x''''
&
par les Lacins
injita,
10nt eeux qui dépendenr de I'in–
dufuie de l'orateur, & qu'il tIre ou de la propre
perfonne, ou de celle de les auditeurs, ou du fond
meme du ti.ljet qu'il traite. L'Olateur peIÍuade
a
l'oe–
caúon de [a perionne
&
de les mreun, lorfque 10n
difeours donne
a
fes audlteurs une grande Idee de
(,1.
vertu
&
de [a probite, parce qu'on ajoute volon–
tiers foi aux paroles d'un homme pmdent, éclairé
& vertuelDC, 1m-tout en mauere dOllteule
&
problé–
matiqne ; c'eíl: pourquOJ Caton regardoit la problté
comme la premlere bale de l'éloy'uo::nce:
orator vir
bOllus dicendi periws.
Le;
argumen,
'itu fe tirent de la
pan de l'aucl.tteur , ont pour but
dI!
le poner
a
quel–
que pafiion
'1m
inclmc ton Jllgement pour ou con–
treo L 'ell par-la que l'orateur eAl.!re 1m emplre ab–
folu [ur ceux qtu l'écoutent,
&
qu'il peut
d
'termi–
ner le jugemem Cfll'il en ¡oHicite. Cette pat1:ie deman–
de une eonnouiance approfondie des mrelU'S & des
paffions.
Voye{
MCEURS
&
PASSION.
Entin les
argumens
qui nailfent du fujet, confiíl:ent
a
le faire envrlager par ron propre fond, fa nature,
[es circoníl:ances, les {uites, fa conformité, ou ion
oppofition avec d'autres, & dela ces reffourccs qu'on
nomme
lieux communs.
Les
argumms
natmels ou extrin[eques,
JnX"",
que
Ciceron appeIle
affi,mpta,
c'eíl:-a-d.tre,
moyens exté–
rieurs,
font eeux qui ne dépendent point de I'orateur,
& qtl'il trouve, pour ainli dire, tous faits, comme
les arrets & jugemens, les lois, les preuves par écrit,
les regifues publ'cs, la
dépofitio~
des temoins, les
proces-verbaux,
&c.
clui lui fourl1J{fcnt des autorites
d'011 il tire des eonféquenccs.
Un auteur moderne diíl:ingue encore les üeux om–
l11uns ou chefs
d'argumens,
par rapporr aux trois
<Ten~
res deRhétorique ;
1°,
en
ceu~
qlÚ lerventa
periil~der
ou
















