
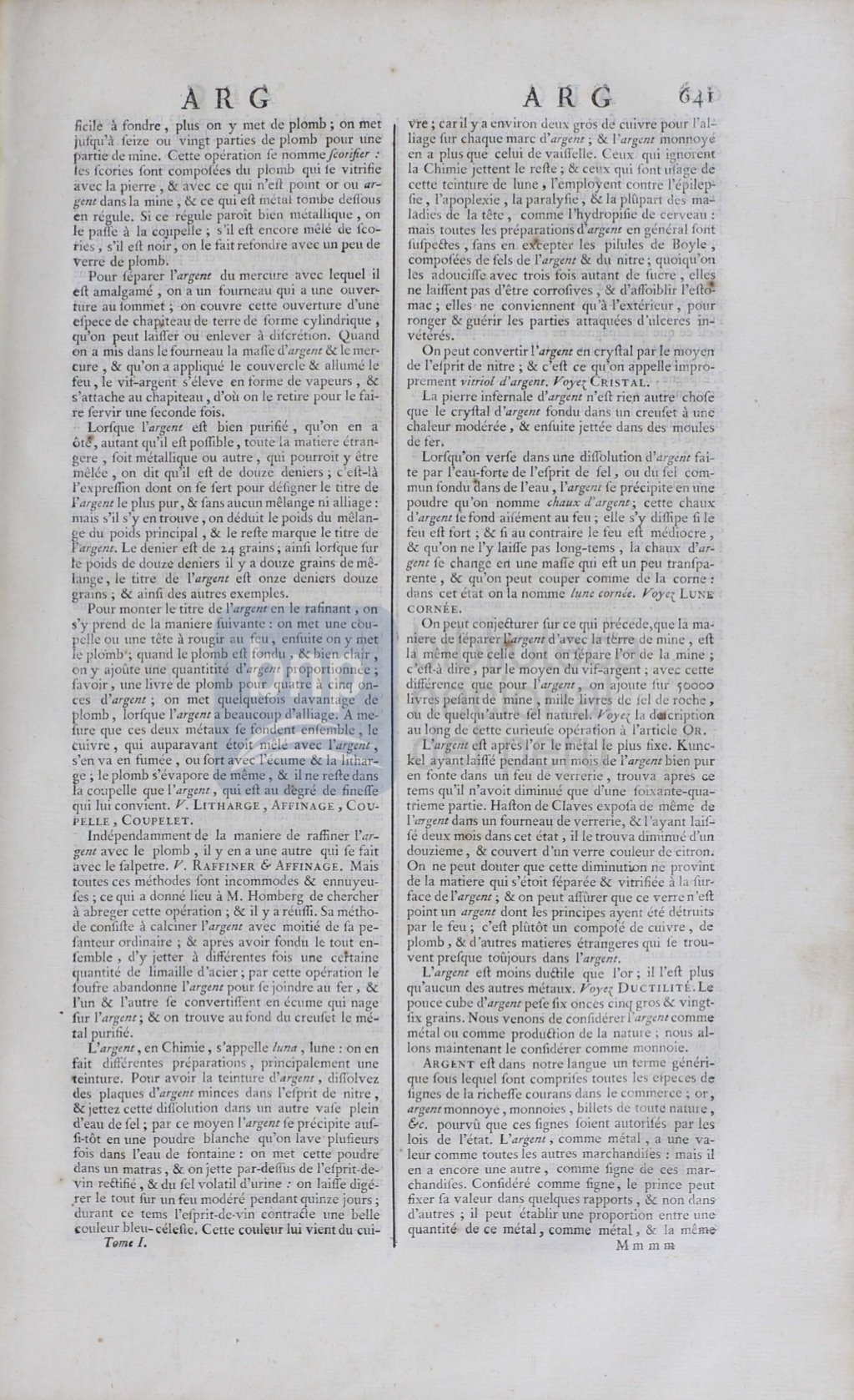
ARe
ficile
a
fondre, plus on y met de plomb ; on met
)\I(qu'a (eize Ol! vingt parties de plomb pour une
f)arrie de mine. Cette opération fe
nommefcorifier :
les (cories font compofées du plomb qui
te
vio-iñe
avec la pierre ,
&
avec ce qui n'el!: pomt or ou.
ar
w
gene
dansla mine,
&
ce qui eíl: métnl tombe del!ous
en
régule.
Si
ce régule
p~roit
bien mét:lI!que, on
le paíre
a
la co ..upelle; s
11
eíl: encore mele de {co–
ries , s:iI eíl: noir, on le fuit refondre avec un pell de
Verre de plomb.
Pour féparer
l'argent
du mercure avec lequel il
eíl: amalgamé, on a un fourneau qui a une ouver–
tme au tomrriet; on couvre cette ouverture d'une
e{pece de chap,iteau de terre de forme cylindrique ,
qu'oll peut laiírer ou enlever a di{crétion. Quand
tm
a mis daos le fourneaula malle
d'argent
&
le mero
cure,
&
qu'on a appliqué le couvercle
&
allumé le
feu, le
viJ:~argent
s'éleve en forme de vapeurs,
&
s'attache au chapitean, d'oil on le retire pour le fai–
re fel'vir lme {econde fois.
Lorfque
l'argent
eíl: bien puriñé, qu'on en a
ot~,
autant qu'il eíl: poírtble, toute la matiere étran"
gere , {oit métallic¡ue ou autre, qui pourroit y etre
melée, on dit c¡n'il eíl: de douze deniers; c'el!:-la
l'expreíIion dont on fe (ert pow' déíigner le titre de
l'
argem
le plus pur,
&
(ans aucun mélange ni alliage :
mais s'il s'y en trouve, on dédui[ le poids du melan–
ge du poids principal,
&
le reíl:e marque le titre de
fnrgent.
Le denier eíl: de
24
grains; ainíi lor{que {ur
le poids de dome deniers il y a douze grains de me–
lange, le tio'e de
l'argent
eíl: ome deniers dome
grains ;
&
ainíi des autres exemples.
Pour monter le citre ele
l'argem
en le rafinant, on
s'y prenel de la maniere {uivante : on met une cou–
pelle ou une tete a rougir au feu, enCuite on y met
le plo'mb; quand le plomb eíl: fondu ,
&
bien clair ,
on y ajoúte une quantitité el'
argent
proportionnée ;
favoir, une livre de plomb pour quatre a cinc¡ on–
ces
d'argent;
on met c¡uelc¡uefois davantage de
plomb, lor{que
l'argent
a beaucoup d'alliage. A me·
rure que ces deux métaux (e fondent en(emble, le
cuivre, qui auparavant étoit melé avec
l'argem,
s'en va en fllmée , ou fort avec l'écume
&
la lithar–
ge ; le plomb s'évapore de meme,
&
il ne reíl:e dans
la
cO~lpelle
que
l'argem,
qui eíl: au degré de fineíre
qui lui convient.
Y.
LITHARGE, AFFINAGE, Cou·
j' ELLE, COUPELET.
lndépel1damrnent de la maniere de raffiner l'
ar–
gent
avec le plomb, iI
Y
en a une autre qui {e fait
avec le {alpetrc.
1/,
RAFFINER
&
AFFINAGE. Mais
toutes ces méthodes {ont incommodes
&
ennuyeu–
fes; ce qui a donné lieu a M. Homberg de chercher
a
abreger cette opération ;
&
il
Y
a réuíIi. Sa métho·
de coníiíl:e
a
calciner l'
argent
avec moitié de (a pe–
fanteur ordinaire ;
&
apres avoir fondu le tout en–
femble, d'y jetter a différentes fois une cehaine
quantité de limaille d'acier; par cette opération le
laufre abandonne l'
argent
pour fe joindre au fer,
&
l'un
&
l'alltre fe convertiírent en écume c¡ui nage
• fur l'
argent;
&
on trouve au fond du creu{et le mé–
tal puriñé.
L'
argent,
en Chimie, s'appeIle
luna,
lune : on en
fait difrcrentes préparations , principalement une
teinture. Ponr avoir la teinture
d'argent,
diírolvez
des plaques
d'argenl
núnces dans l'efpI;t de nitre,
&
jettez cette diírolution dans un autre vafe plein
d'eau de {el; par ce moyen
l'argent
fe précipite au{–
íi·tOt en une poudre blanche qu'on lave pluíieurs
fois dans l'eau de fontaine: on met cette poudre
dans un matras ,
&
on jerte par·de([us de l'
efprit.de–vin re8ilié,
&
du {el volatil d'mine : on laiíre digé.
,rer le tollt [ur un feu modéré pendant quinze jOUTS;
durant ce tems l'e{prit·de,vin contra8e une belle
(Oltleur bleu- céleRe. Cette couleur lui vient du cui-
TrHntI.
ARe
vi'e ; car il y a environ deux grós de cuivre pour I'al–
liage {ur chaque mare
d'argent;
&
l'argent
i-l1onnoy~
en a plus que celui de vaiírelle. Ceux qui ignorent
la Chimie jettent le reite;
&
cel x qui font uíage de
cette teinture de lune, l'e'11ployent contre l'épilep·
íie, l'apoplexie , la paralyíie,
&
la plí'lpart des ma..!
ladies de la tete, comme
1
'hrdropiíie de cerveau :
mais toutes les préparations d
argenl
en général {ont
{ufpefres , fans en exceptel' les pililles de Boyle,
compofées de {els de
I'
argent
&
du nitre
i
quoiqu'on
les adouciíre avec trois fois autant de {uere , elles
ne lailfent pas d'etre corroíives ,
&
d'afr'oiblit l'eíl:o·
mac; elles ne conviennent qu'a l'extérieur, pour
ron~er
&
guérir les parties attaquées d'ulceres in–
véterés.
On peut convertir
l'argent
en cryital par le moycn
de l'e{prit de nitre;
&
c'eíl: ce qu'on appelle impro–
prement
vitriol
d'argent. Voye{
CRISTAL.
La pierre infernale
d'argent
n'eíl: rien autre eho{e
que le cryíl:al
d'argent
fondu dans
\111
creuret
a
unc
chaleUT modérée,
&
enCuite jettée dans des mOules
de fer.
Lor{c¡u'on verfe dans une diílblution
d'argent
fai–
te par l'eau·forte de l'e(prit de {el , ou du {el com·
mun fondu aans de l'eau,
l'argm t
{e précipite en une
poudre qu 'on nomme
chaux d'argent;
cette chaux
d'argent
fefond aifément au feu; elle s'y diilipe íi le
feu eíl: fort ;
&
íi au contraire le feu eíl: médiocre,
&
qu'on ne l'y laiíre pas long-tems , la chaux
d'ar–
genl
{e change ert une maíre qui eíl: un peu tran{pa.
rente,
&
c¡u'on peut couper comme de la corne :
dans cet état on la nomme
[une cornJe. Voye{
LUNI~
CORNÉE.
On peut conjefrurer {ur ce
q¡ú
précede,que
la
ma-
I
niere de ú\parer
¡'argentd'avec
la tb-re de mine, eíl:
la mcme que eelle dont on fépare l'or de la mine;
c'eíl:,¡¡ dire, par le moyen du vif-argent ; avec cette
différence que pour
l'argent,
on ajome
{lIT )"0000
livres pe(ant de mine, mille livres de
fe!
de roche ,
ou de quelqu'autre {el naturel.
Voy e{
la deicription:
au long de eette eurieu{e opération
a
l'article ORo
L'argent
el!: apresl'or le métalle plus tixe. Kunc–
kel ayant laiíle pendant un mois de l'
argent
bien pur
en fonte dans 1m feu de verrerie, trouva apres ce
tems qn'iI n'avoit diminué que d'une {oixante-qua–
trieme partie. H<líl:on de Claves expo{a de mcme de
I'argem
dans un fourneau de verrerie,
&
1
'ayant lai{–
{é deux mois dans cet état, ille tronva diminué d'un
douzieme,
&
couvert d 'un verre couleur de citron.
On ne peut douter que cette diminution ne provint
de la matiere c¡ui s'étoit {éparée
&
vitrifiée
a
la
fia'·
face de l'
argent;
&
on peut a([llrer que ce verre n'eíl:
point un
argent
dont les principes ayent été détruits
par le feu; c'eíl: pllttot un compofé de cuivre , de
plomb,
&
d'autres matieres étrano-eres c¡ui {e trou–
vent pre{c¡ue tOlljours dans
l'arge::t.
L'argent
eíl: moins du8ile c¡ue l'or; ill'eíl: plus
qn'aucun des autres métaux.
V oye{
DUCTILlTÉ. Le
pouce cttbe d'
argent
peCe íix onces cinc¡ gros
&
vingt.
{IX
grains. Nous venons de coníidérer
l'argem
comme
métal ou comme produfrion de la nanue; nous al–
lons maintenant le coníidérer comme monnoie.
ARGE.NTeíl: dans norre langue un terme généri–
c¡ue {ous lequel {ont comprj{es toutes les cfpeces de
íignes de la richeíre courans dans le commerce ;
01' ,
argent
monnoyé , monnores , billets de tome nature ,
&c.
pourvll que ces fignes (oient autorifés par les
lois de l'état.
L'
argent,
comme métal , a une va–
lem comme toutes les autres marchandiÚ':s : mais iI
en a encore une autre, comme figne de ces mar–
chandi{es. Coníidéré comme íigne, le prince peut
lixer {a valeur dans quelques rapports ,
&
non dans'
d'autres ; il peut établir une proportion entre une–
qlHlntité
de
ce métal, comme métal ,
&
la
meJne-
Mm m m
















