
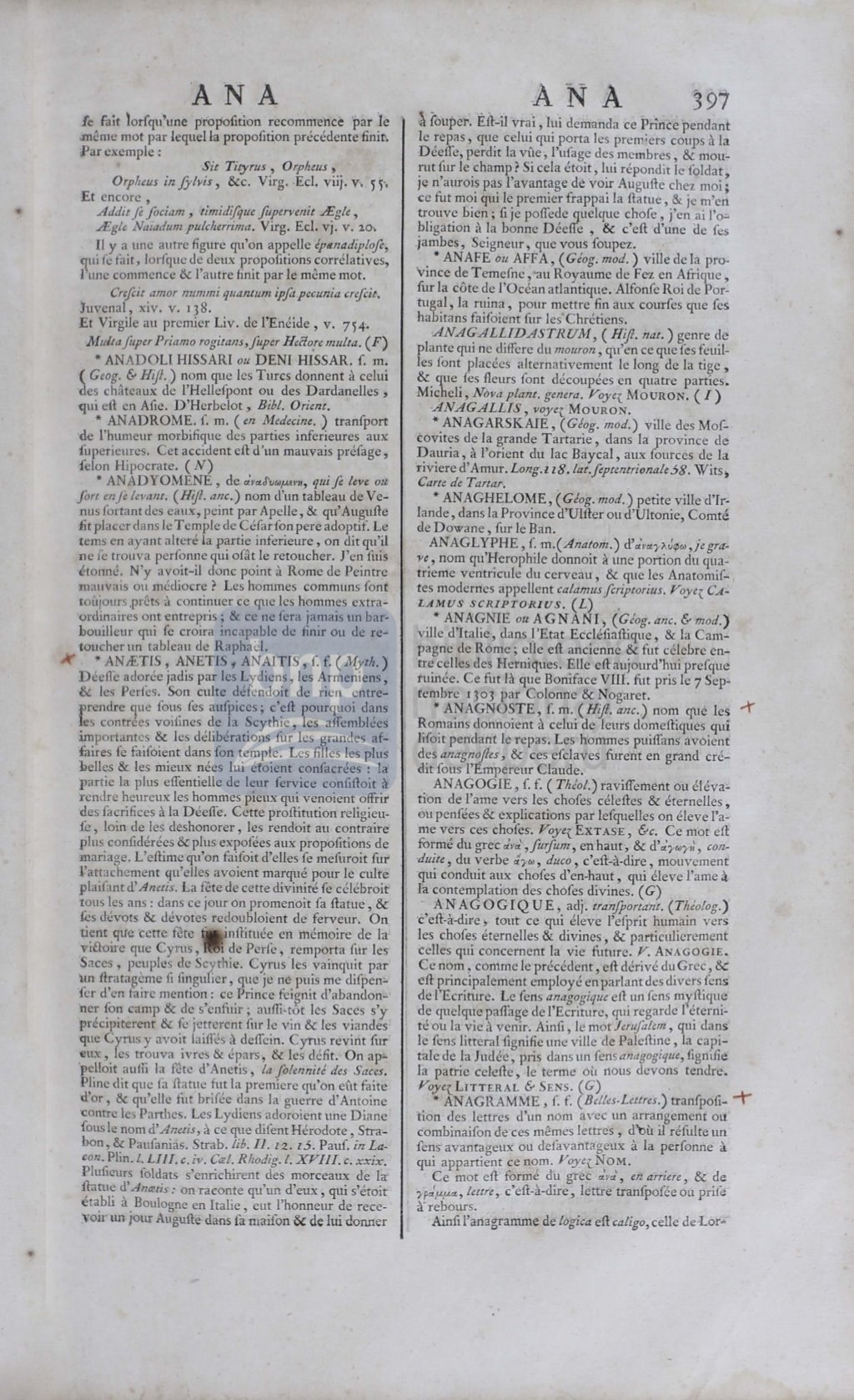
ANA
fe fait lorfqu'une propofition recommence par le
méme mot par lequella propofirion précédente finir.
Par exemple ;
Sil Tityrus, OtplzellS,
Orplteus in .lYlvis,
&c. Virgo Ecl. viij. v,
55'.
Et encore,
Addil fe fociam, timidiji¡ue foperyenit ./Egle ,
../Egle Naiadllfll plllclzerrima.
Virgo Ecl. vj.
V. 20,
Il
Y
a une autre figure qu'on appelle
tp/!lnadiplofe,
~ui
fe fait, lorfc¡ue de deux propolitions corrélatives,
1une commence & I'autre finit par le meme mot.
Crefcit amor nltTllmi quantum ipfa pecunia
crefci~.
Juvenal, xiv.
V.
138.
Et Virgile au premier Liv. de l'Enéide,
V.
754.
MultajitperPriaTllo rogitans,juper Heilo!e multa. (F)
.. ANADOLl HISSARI
ou
DENI HISSAR. f. m.
( Geog.
&
Hifl.
) nom que les Turcs donnent a celui
des chateaux de I'Hellef¡)ont ou des Dardanelles ,
~ui
eft en Alie. D'Herbclot,
Bibl. Oriento
.. ANADROME. f. m. (
en MedecÍne.
) tramport
<le l'humeur morbifique des parties inferieures aux
fupericures. Cet accident eft d 'un mauvais préfage,
(elon Hipocrate.
(N)
.. ANADYOMENE, de
d.va.d"u"
,p.fI'n,
qui flleve
Oll
jort en}t ÜWlnt. (Hifl. allc.)
nom d'un tableau de Ve–
nus (ortant des eaux, peint par Apelle,
&
qu'Augufte
Jit placer dansleTemple de Céfarfon pere adoptif. Le
tems en ayant alteré la partie inferieure, on dit qll'il
ne
lC
trollva perforllle qlli orat le retolleher. J'en fuis
étonné. N'y avoit-il donc point
a
Rome de Peintre
ln:\Uvais ou médiocre? Les hommes eommuns font
touJours .prets
a
connnuer ce que les hommes extra–
ordinaires ont entrepris ;
&
ce ne fera jamais un bar–
houilleur qlli fe croira incapable de finir ou de re–
toucher un tableau de Raphael.
.. AN..ETlS, ANETIS
1
ANAITIS, f. f.
(Myth.)
Déell'e adorée jadis par les Lydiens, les Armeniens,
&
les Pedes. Son culte détendoit de rien entre–
prendre que fous fes aufpices; c'eft pourquoi dans
les contrées voilines de la Scythie, les affemblées
importantes & les délibérations fur les grandes af–
faires fe faifóient dans fon temple. Les filies les plus
l>elles
&
les
mieux nées lui étoient confacrées : la
partie la plus eífentieJle de leur fervice con{illoit
a
remIre heureux les hommcs pien." qui venoient offrir
des {acrifices
a
la Déelle. Cette proftitution religieu–
fe, loin de les deshonorer, les rendoit au contraire
plus confidérécs & plus expofées aux propolitions de
mariage. L'ellime qu'on faifoit d'elles {e mefllroit fur
l'attachement qu'ellcs avoient marqué pour le clúte
plaif:mt d'
Anetis.
La fCte de cette diviniré fe célébroit
tous les ans : dans ce jour on promenoit fa ftatue, &
ks dévots & dévotes redoubloient de ferveur. On
nent que cette fetc
inllituée en mémoire de la
viél:olre que CynIS,
1
de Perfe, remporra
ftu-
les
Saces, peuples ele Seyrhie. Cyrus les vainquit par
'Un
fuatagcme li lingulier, que je ne puis me difpen–
fer d'en faire mention; ce Prince
fei~nit
d'abandon–
ner fon camp & de s'enhür; attffi-tot les Saces s'y
préeipitere-nt & fe jetrerent fur le vin
&
les viandes
que CynlS y avoit laiífés a derrein. CyntS revint fur
cm:, les rrouva i"res
&
épars, & les défit. On ap–
pelloit auHi la tete d'Anetis,
la fllmnité des Saces.
Pline dit que fa ftanle fur la prerniere '1u'on etlt faite
d'or, & qu'elle fllt brifée dans la guerre d'Antoine
contre le Parthe . Les Lydiens adoroient une Diane
fousle nom
d'Anetis,
a
ce que difent Hérodote ,Stra–
bon,
&
Paufaruas.
trab.lib.Il.
i2.
z.5.
Pauf.
in La–
con.
Plin.l.
LI/I.
c.iv.Cad. Rlzodig.l. XYIlI.
C.
xxix.
Plufieurs foldats s'enrichirent des morceaux de la
fu¡m~
d'Ananis:
on raconte qu'un d'eux , qui s'étoit
éta.bli a. Boulogne en Italie eut l'honneur de rece–
"on un
JOur
Augufre daos fa maifon
&
de lui dOnrIer
ANA
397
á
{ouper.
Eíl:-il
vrai , lui demanda ce Prlnce pendant
le repas, que celui qui porta les prem;ers coups a la
Déeffe, perdit la vlle, l'u{age des mcmbres , & mon–
rut fur le champ?
Si
cela étoit, lui répondit le foldat
je n'aurois pas I'avanrage de voir Augufre chez
moi~
'Ce fut moi '1ui
le
premier frappai la ftanlc,
&
je m'en
trollve
bien;
li je poffede quelque cho{e, ¡'en ai 1'0-
bligation
¡\
la bonne Déeífe , & e'eft el'une de [es
jambes, Seigneur \ que vous foupez.
*
ANAFE
ou
AFFA,
(Gtog. modo
) ville de la pro–
'vince de T eme{ne,
<lU
Royaume de Fez en Afrique,
fllr la cote de 1'0céanatlantique. Alfonfe Roi de Por–
tugal,
la
ruina, pour mettre fin allX eourfes que fes
habitans faifoient {ur les Chrétiens.
ANAGALLIDASTRUM, (Hifl. nat.)
genre de
plante 'luí ne differe du
mouron,
qn'en ce que fes feuil–
les {ont placées alternativement le
long
de la tige ,
& que (es flenrs font découpées en 'luatre parties.
Micheli, Nóva planto genera. r'!Ye{
MOURON.
(1)
ANAGALLIS, voye{
MOURON.
*
ANAGARSKAIE,
(G/og. mod.)
ville des Mof–
covites de la grande Tartarie, dans la province de
Dauria,
a
l'orient
du lae Baycal, aux fources de la
riviere d'Amllr.
Long.lz8.lat.flptentrionale.58.
\Vits>
Cara de Tartar.
*
ANAGHELOME,
(G¿og. mod.)
petite ville d'fr–
lande, dans la Province d'Ulfrer ou d'Ultonie, Comté
de Dowane, (ur le Ban.
ANAGLYPHE, f.
m.(Anatom.)
d'
d."I:L')'AJq¡",
,je
gra:–
ve,
nom c¡u'Herophile donnoit a une portion du qua–
trieme ventricule du cerveau, & que les Anatomif–
tes modernes appellent
calamllSJcriptorius. roye{ CA-
LAMUS SCRIPTORIUS.
(L)
.
*
ANAGI\1JE
ou
AGNANI)
(G¿og. allc.
&
mod.)
ville d'Italie, dans 1 'Erat Ecc!éliallique,
&
la Cam–
pagne de Rome ; elle eft ancienne & fut célebre en–
tre eelles des Herniques. Elle eft aujourd'hui prefque
hlinée. Ce nlt
la
que Boniface VIII. nlt pris le 7 Sep–
tembre 1303 par Colonne & Nogaret.
*
ANAGNOSTE,
f.
m.
(Hifl. allc.)
!lom qtle les
..-r
Romains donnoienr
a
celui de leurs domefric¡ues quí
lifoit pendant le repaso Les hornmes puiífans avóient
des
allagnofles>
& ces efc!aves furent en grand cré-
dit {ous l'Empereur Claude.
ANAGOGIE, f. f. (
Thtol.)
raviffement ou éléva–
tion de l'ame vers les chofes céleftes & étetnelles,
ou pen{ées & explications par lefqueIles on éleve l'a–
me vers ces chofes.
Voye{
EXTASE,
&c.
Ce mot eíl:
rormé du
grecd.va',jll1fum,
enhaut, & d'd.')'",')',:,
con–
'd/tite,
dn verbe
J')'""
duco,
c'eft-a-dire, mouvement
qui conduit ame chofes d'en-haut, qui éleve l'ame
a
la contemplation des chOfes divines.
(G)
A N AG O G I
Q
U E, adj.
tranfportant. (TMolog.)
c'eft-a-dire
~
tOllt ce qui éleve l'efprit hllmain vers
les chofes éternelles
&
divines, & partielllÍerement
celles qui concernent la vie future.
.v.
ANAGOGIE.
Ce nom , comme le précédent , eft dérivé du Grec,
&
eíl: principalement employé en parlantdes diversFens
de I'Ecrinlre. Le fens
anagogique
eíl: un fens
mylliqll~
<le quelque paífage de l'Ecriture, qui regarde
l'~term
té ou la vie a venir. Ainfi, le mot
Jerufalem,
qUl dans
le fens litteral-fignifie une ville de Paleíl:0e, la capi–
tale de la Judée, pris dans un
fensanagoglque,
lignlfie
la patrie celefte, le terme Oll nous devons tendre.
roye{LITTERAL
&
SENS.
(G)
.
*
ANAGRAMME, f.
f.
(Beltes.Leltres.)
tranfpofi-
-t"
tion des lettres d'un nom avec un arrangement on
combinaifon de ces memes lettres, d'Ou il réfulte un
í1
ns avantageux ou defavantageux
a
la per{onne
a
qui appartient ce nomoY'!Yet NoM .
Ce mor eft rormé du grec
d.v,,',
en arriere,
& de
')'pdfl-lM'-'
Imre,
c'eft-~-dire,
lettre trallfpofée ou prite
a-rebours.
Ainfi
I'anagramme de
lógica
eft
caligo,
celle de Lór
e
















