
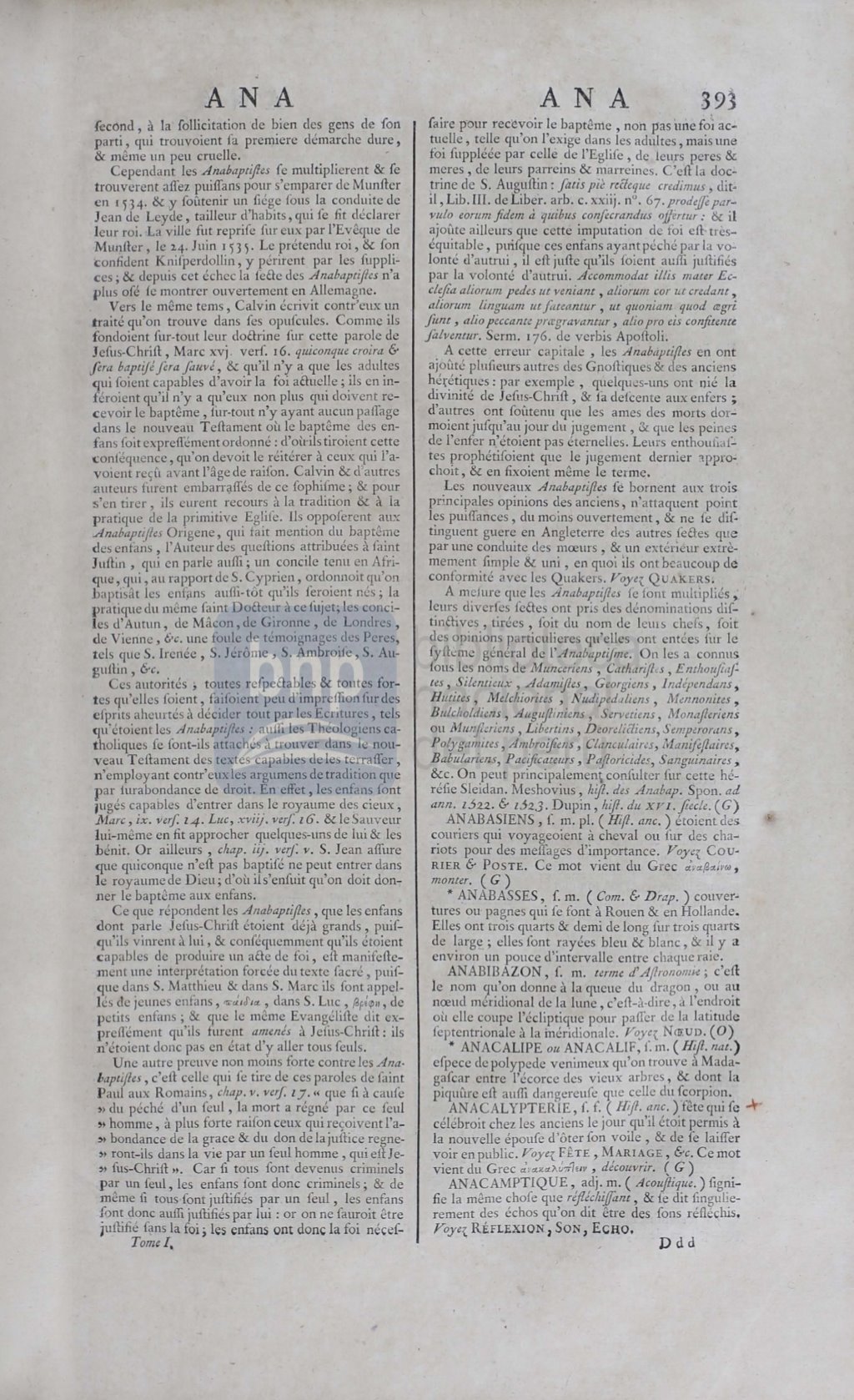
ANA
fecónd,
a
la follicitatlon de bien des gens de fon
parti, qui trouvoient fa premiere démarche dure,
&
meme un peu cruelle.
-
Cependant les
Anabaptifies
fe multiplierent
&
fe
trouverent aífez puiífans pour s'emparer de Muníl:er
en
I
534. & Y foí'ttenir
lUl
fiége fous la eonduite de
Jean de Leyde, tailleur d'habits, 'lui fe nt déclarer
leur roi. La
ville
fut reprife fUT eux par l'Evecjlle de
Muníl:er, le
2.4-
Juin 153
j.
Le prétendu roi, & fon
conndent Knifperdollin, y périrent par les fllppli–
ces;
&
depuis cet échee la [eéle des
Anabaptijles
n'a
plus oré le montrer ouvertement en Allemagne.
Vers le meme tems, Calvin écrivit contr'eux un
traité qu'on trouve dans fes opufcules. Comme i1s
fondoient fur-tout leur doélrine [ur eette parole de
Jefus-Chrííl:, Marc
xvj
verf. 16.
quiconque croira
&
fira baptiféfira Jauvé,
&
qu'il n'y a que les adultes
qui [oient eapables d'avoir la foi aéluclle ; ils en in–
féroient qu'il n'y a 'lll'eux non plus qui doivent re–
cevoir le bapteme, /llr-tout n'y ayant aucun paífage
dans le nouvean Teíl:ament
011
le bapteme des en–
fans [oit expreífémentordonné : d'oll'ils tiroient eette
~onjec¡uence,
c¡u'on devoit le réitérer
a
eeux 'lui l'a–
VOIent
re~fl
avant l'age de raifon. Calvin
&
d'aut:rcs
auteurs furent emban-'<iíTés de ce fophifme ;
&
pour
s'cn tirer, ils eurent recours
a
la tradition
&
a
la
pratique de la primitive Eglife. lis oppo{erent ate'
.dnabapcijles
Origene, qui fait mention du
bapt~me
des enfans , l'Auteur des qucíl:ions attribuées
a
faint
Juíl:in , 'lui en parle auiIi; un concilc tenn en
Afá–
que, qui, an rapportdeS. Cyprien, ordonnoit'lu'on
haptisat les enfpns auiIi-tot c¡u'ils {eroienr nés; la
pratiqlle dll meme {aint Doéleur a ce íi.ljet; les conci–
les d'Autun, de Macon, de Gironne, de Londres,
de Vienne,
&c.
une foule de témoignages des Peres,
tels c¡ue S. Irenée, S. Jérome , S. Ambroife, S. An–
guíl:in,
&e.
es autorités , toutes re{peélables
&
toutes for–
tes c¡u'elles {oient, faifoient pen d'impreiIion
{ur
des
e{prits aheurtés a décider tout par les Ecritures, tels
qu'étoient les
dllabaptijles:
auffi les Théologiens ca–
tholic¡ues fe {ont-i1s attachés
a
trouver dans le nou–
veall Teíl:ament des textes capables de les terraífer ,
n'employant contr'euxles argumens de tradition c¡ue
par /urabondance de droit. En eífet , les enfans {ont
)ugés capabies d'entrer dans le royaume des cieux ,
Mare, ix. ver[.z4- Lile, xviij.ved:
z6.
&leSauveur
lui-meme en lit approeher c¡uelc¡ues-uns de lui
&
les
hénit. Or ailleurs ,
ehap. iY. v"f
V.
S. Jean aífure
que quiconque n'eíl: pas baptifé ne peut entrer dans
le royaumede Dieu; d'oll ils'enfuit qu'on doit don–
ner le bapteme aux enfans.
Ce que répondent les
AI/abaptijles
,
c{ue les enfans
dont parle Je{us-Chriíl: étoient déja grands, pujf–
qu'ils vinrent
a
lui,
&
conféquemment qu'ils étoient
capables de produire un aéle de foi, efr manifel!:e–
ment une interprétation forcée du texte {acré , puif–
que dans S. Matthieu
&
dans S. Mare ils (ont appel–
lés de jeunes enfans,
""J,f,a.
,
dans S. Luc ,
~f'CP'"
de
}Jetits enfans;
&
c¡ue le meme Evangéliíl:e dit ex–
lJreíTément c¡u'ils furent
amel/és
¡\
Je/lls-Chriíl:: ils
n'étoient done pas en état d'y aller tous {euls.
Une autre preuve non moins forte contre les
Ana–
baptijles,
c'eíl: celle qui {e tire de ces paroles de (aint
Paul aux Romains,
elzap. v. ver[. z:J."
que fi
a
cau{e
»
du péché d'un feul , la mort a régné par ce fenl
), homme,
a
plus forte raifon ceux qtÚ rec¡oivent l'a–
~,
bondance de la grace
&
du don de la juíl:ice regne–
), ront-ils dans la vie par un (eul homme , 'lui eH Je–
), (us-Chriíl:". Car fi tous font devenus criminels
par un {eul ,les enfans font done criminels;
&
de
meme
ft
tous font juíl:iliés par un feul, les enfans
font donc auffi juíl:iliés par lui : or on ne fatuoit etre
jUl1.ifié (ans la foi; les enfans ont done la foi
néc~f-
Tomel,
ANA
393
faire p'our rec'evoir le bapterrte , non pas une foi
ac~
nlelle, telle c¡u'on
l'exige
dans les adultes maislms
toi
fuppléée par celle de l'Eglife , de
leur~
peTes
&
meres, de leurs pan-eins
&
malTeines. C'eíl: la doc–
trine de S. Augul!:in :
ftuis pie recleqlle credimus,
dit–
il,Lib.II1. de [¡ber. arb. c.xxiij. nO.
67.prodeffipar–
Ylllo eorrtlll fidelll
ti
q/tibus eonficrandus oflenllr.-
&
il
ajoltte ailleurs que cette implltation de toi eíl:-tres–
équitable, puifque ces enfans ayantpéché par la vo–
lonté d'autrui , il eíl: juíl:e qu'ils foient auffi juíl:iliés
par la volonté d'autrui.
Accomlllodat i[lis mater Ee–
clifia alíorulll pedes lit veniant
,
aliorum cor ut credaflt ,
alíorulll lill[Jualll /lt fiaeantur
,
ut quoniam q/lod a:gri
fitnt, afiopeccanteprregravalltltr, alíopro eis col/foml'
fllventur.
Serm.
' 76.
de verbis Apoíl:oli.
. A ceHe erreur capitale , les
Allabapcijles
en ont
aJoltté plufieurs autres des Glloíl:iques
&
eles anciens
hététiques: par exemple, quelqul.!s-ul1S ont nié la
divinité de Je{us-Chriíl:,
&
111
deícente aux enfers ;
d'autres ont fOlttenu que les ames des morts dor–
moient ju{qu'au jour du jugement ,
&
que les peines
de l'enfer n'étoient pas éternelles. Leurs enthouliaJ:'
tes prophéti{oient que le jugement dernier 'ppro–
choit,
&
en nxoient meme le terme.
Les nouveaux
Anabaptijles
fe bornent allx troís
principales opinions des anciens, n'attac¡uent point
les
puilfances , du moins ouvertement ,
&
ne le dif.
tinguent guere en Angleterre dcs autres
feéle~
que
par une conduite des mceurs ,
&
un extérieur extre–
mement fimple
&
uni , en quol lls ont beaucoup de
conformité avec les Quakers.
Voye{
QUAKERS.
A me/me c¡ue les
Anabaptijf¿s
fe font multipliés ,
leurs dlverfes feaes ont pr's des dénominations dif–
tinélives , tirées , {oit du nom de leUls chefs, (oit
des opinions particulieres qu'elles ont entées lllr le
fyíl:eme général de
I'Anabapcifine.
On les a connus
fous les Iloms de
MUl/eeriens
,
Catharijl.s, Enthoujiaf
us, Silentiellx
,
Adamijles, Georgiells, lndépendans,
Rutites, Mdef¡iorites, Nudiped,diens , Mmno71ites,
Bulcho[diens , Auglljlmiens, Servetiens , Monafluiens
ou
Munflericlls, Libertins , Deoreliaiens, SemperOrtlflS ,
Polygamues, Ambroijiws, Clallwlair.s, Manifif!aires,
Babulariens, Paeijieate/lrs, Pajloricides, Sallguinaires.
&c. On peut
principalemen~
confuIter fuI' cette hé–
réfie Sleidan. Meshovius,
!lijl.
des Allabap.
Spon.
ad
ann.
du.
&
d23.
Dupin ,
hij!. du
XI'l.
jieeü. (G)
ANABASIENS ,
f.
m. pI. (
Rif!. ane.
)
étoient des
couriers qui
voya~eoient
a
cheval ou úlr des cha–
riots pour des mellages d'importance.
Voye{
Cou–
RIER
&
POSTE. Ce mot vient du Grec
d,a.
~rJ.Io,tiJ ,
montero (G)
" ANABASSES,
f.
m. (
Como
&
Drap.
)
couver·
tures ou pagnes c¡ui (e font
a
Rouen
&
en Hollande.
Elles
011t
trois quarts
&
demi de long (ur trois c¡uarts
de large; eHes font rayées bleu
&
blanc ,
&
iI
Y
a
environ un pouce d'intervaHe entre chaque raie.
ANABIBAZON,
f.
m.
terme d'AflronOf/lle;
e'eíl:
le nom
~u'on
donne
a
la c¡ueue du dragon, ou au
ncel1d meridional de la lune , c'eíl:-á-dire,
a
l'endroit
011
elle coupe l'écliptiC¡l1e pour paíTer de la latltude
feptentrionale
a
la inéridionale.
Voye{
NaruD.
(O)
" ANACALIPE
Olt
ANACALIF,
f.
m.
(HijI.
flat. )
efpece de polypede venimeux cIu'on trouve
a
Mada–
ga{car entre I'éeorce des vieux arbres,
&
dont la
piqulLre el!: auffi dangereu(e que celle du {corpion.
ANACALYPTERIE, {. f. (
Hifl· alle.
)
fete
C¡lÚ
{e
~
célébroit chez les anciens le jour c¡u'il étoit permis
a
la nouvelle épou{e d'oterfon voile,
&
de (e laiíI'er
voir en public.
Voy'\'
Ft TE, MARIAGE,
&e.
Ce mot
vient du Grcc
d,a.'-a.~¿'lT1"v
,déeoltvrir. (G)
ANACAMPTIQUE, adj. m. (
Aeoujtique.)
figni-
ne la meme chofe que
réJlécl'ij{aIlt,
&
fe dit fin!?ulie–
rement des éehos qu'on dit etre des fons réfl chis.
Voye\.
RÉFLEXION
1
SON , ECRO.
Dd d
















