
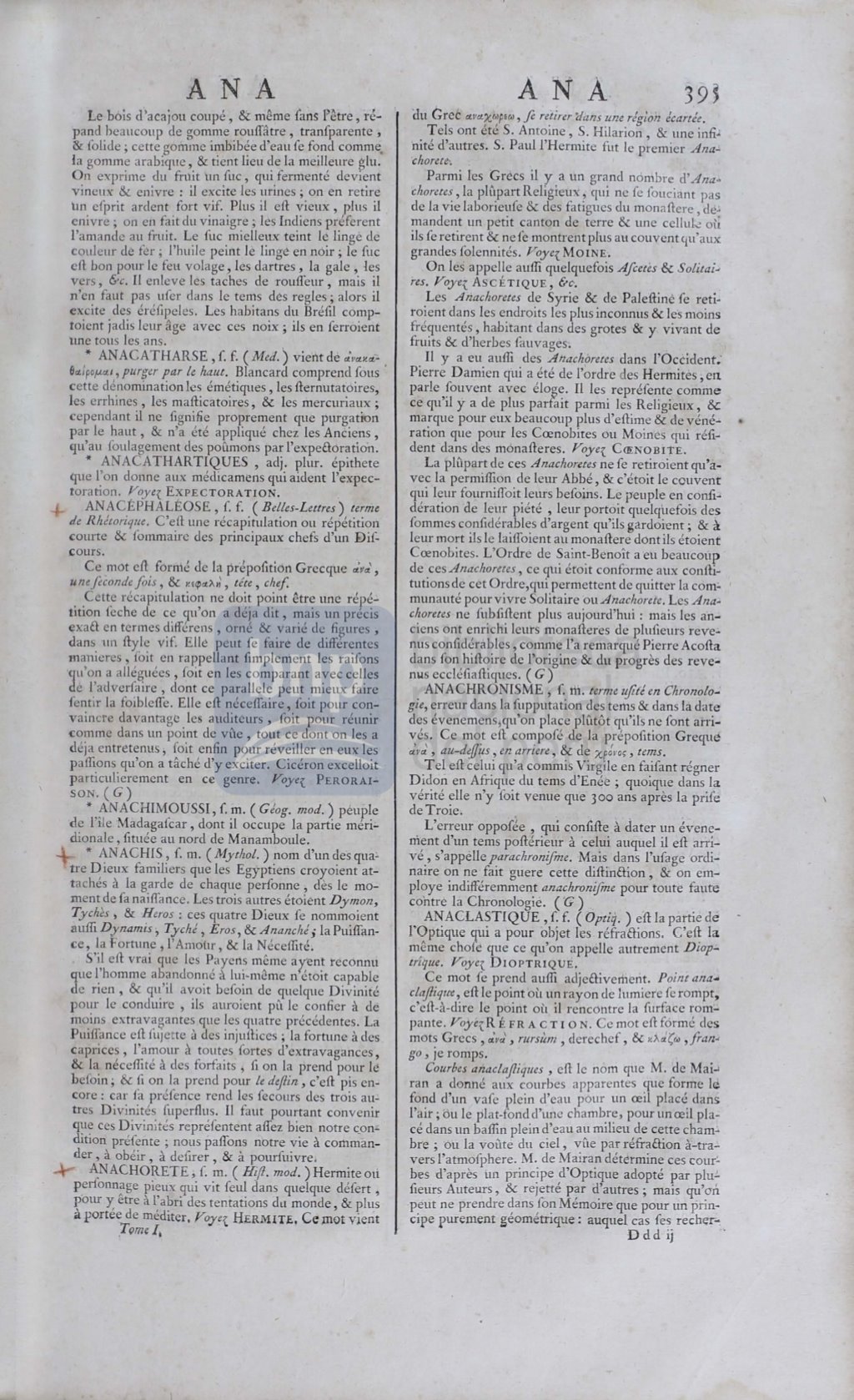
ANA
Le bois d'acajou coupé,
&
m&me (ans
P~tre,
ré–
pand beaucoup de gomme rouífatre, tran(parente,
&
(olide; cette gomme imbibée d'eau
re
fond comme
la gomme arabique ,
&
cient lieu de la meilleure glu.
On exprime du fnlÍt
l1l1
(uc, qui fennenté devient
vineux
&
enivre : iI excite les urines ; on en retire
\.111
erprit ardent fort vif. Plus il ell: vieux , plus il
cnivre; on en fait du vinaigre; les Indiens préferent
l'amande au fruit. Le (uc mielleux teint le linge de
couleur ele fer; I'huile peint le [inge en noir; le (uc
ell: bon pour le feu volage ,
les
dartres, la gale , fes
vers,
&c.
I1 enleve les taches de rouífeur, mais il
n'en faut pas lúer dans [e tems des regles ; alors il
excite des éréíipeles. Les habitans du Bréftl comp–
toient jadis leur age avec ces noix;
ils
en ferroient
tille touS les ans.
.. ANACATHARSE, f.
f.
(Med.)
vier'lt de
dvv.y.a.–
Bv.lpo¡..tcLl,
purger par le !Ulltt.
Blancard comprend (ous .
cette dénornination les émétiques , lesll:emutatóires,
les crrhines , les mafticatoires,
&
Ics mercuriaux ;
cependant il ne íignifie proprement que purgation
par le haut,
&
n'a été appliqué chez les Anciens ,
qu'au (ou[agement des pOllmons par l'expeéloration.
.. ANACATHARTIQUES , adj. p[ur. épithete
que 1'0n donne aux médicamens qui aident l'expec–
toraríon.
Yoye{
EXPECTORATION.
ANACÉPHALÉOSE,
f.
f.
(Belles-Lettres) terme
tle R Mtorique.
C'ell: une récapitulation ou répéticion
com"te
&
fommairc des principaux chefs d'un Dif–
cours.
Ce mot
ea
fOrmé de la prépoíition Grecque
d~<1.' ,
U1/e
flconde ¡ois
,
&
y',<pv."~
,
téle, chef
Cette récapindation ne doit poiht etre une répé–
tition feche de ce 9u'on a déja dit, mais un précis
exaél en termes differens , omé
&
varié de
n~ures
,
dans un fryle vif. Elle peut (e faire de differentes
manieres, foit en rappellant íimplement les raifons
qu'on a alléguées , (oit en [es comparant avec celles
de l'aclver(aire , dont ce parallele peut mieux faire
fentir [a foibleífe. Elle ell: néceífaire, (oit pour con–
vaincre davanragc les auditeurs, (oit pour réunir
comme dans un point de Vlle , tout ce dont on les a
déja entretenus, (oit ennn pour réveiller en eux [es
paffions qu'on a taché d'yexciter. Cicéron excelloit
particulierement en ce genre.
Yoye{
PERORAI–
SON.(G)
.. ANACHIMOUSSI,(. m.
(Géog. mod.)
peup[e
de ['ile Madaga(car, dont i[ occupe la partie méri–
dionale, íimée au nord de Manambou[e.
.. ANACHfS ,
f.
m.
(Mythol.
)
nom eI'un des qua–
tre D ieux familiers que les Egyptiens croyoient at–
tachés a [a garde ele chaque perfonne, eles le mo–
ment de fa naiífance. Les trois autres étoiént
Dymon,
Tyches ,
&
Heros
:
ces quatre Dieux fe nommoient
auffi
Dynamis, Tyché, Eros ,
&
A nancf¡é;
[a Puiífan–
ce, la FornlOe, l'Amoür,
&
la Néceffité.
S'il ell: vrai que les Payens meme ar.ent reconnu
que ['homme abanelonné
a
lui-meme n étoit capab[e
de rien,
&
qu'il avoit be(oin de que[que Divinité
pour le conduire , i[s auroient pll le conner a de
moins
extrava~antes
que les qllatre précédentes. La
Puiífance ell: 1i.IJette
a
des injull:ices ; la forhlOe a des
capl'ices, l'amour a toutes (ortes d'extravagances,
&
[a néceffité
a
des forfaits ,
Ii
on la prend pour le
be(oin;
&
Ii
on
[a
prend pour
le
d.¡tin,
c'ell: pis en–
core: cal' Ül préfence rend les (ecOltrS eles trois au–
tres Divinité (uperflus.
Il
fam pourtant convenir
q~l~
ces
~ivinités
repréfentent a{fez bieh notre C9n–
dltlOn pre(ente ; nous paífons notre vie
a
COrhman–
der ,
a
obéir,
a
dcftrer ,
&
a
pour(uivre.
J\NACHORETE,
f.
m. (
Hifi. modo
)
Hennite on
perlonnage pieux qui vit feul dans quelque dé(ert ,
pOltr
y.
etre
a
l:a~ri
des tentations dll monde,
&
plus
a
portee de medlter.
Voye{
HERMITE.
Ce
mot vient
Tr;m,¡.
ANA
39 S
au Grec
v.vv.X,"'P''''
,
fl
relirer 'dans une région ¡canée.
Te[s ont été S. Antoine, S. Hilarion,
&
une inn.
nité d'autres. S. Paull'Hermite fut le premier
Ana–
chorete-.
Parmi les Grecs il ya un granel nombre
d'Ana–
clzoreees,
la plClpaI"t Religieux, qui ne fe (oueiant pas
de la vie laborieu(e
&
des fatigues du monall:ere , dé!
manelent un petit canton de terre
&
une cellul..e Ol!
ils fe retirent
&
ne
le
montrentp[us au couvent qu'aux
grandes fo[ennités.
Voye{
MOINE.
On
les
appelle auffi quelquefois
Afcms
&
Solitai.
res. Yoye{
ASCÉTIQUE,
&C'.
Les
Anaclzorms
ele Syrie
&
de Pa[efl:ine (e reti·
roient elans les enelroits les plns inconnus
&
les moins
fréquentés, habitant elans des grotes
&
y vivant de
fruits
&
d'herbes (auvages;
Il
y
a eu auffi des
A nach,oreles
elans 1'0ccident;
Pierre D amien qui a été de I'orclre eles Hermites , en
parle fouvent avec éloge.
Il
les repré(ente comme
ce qu'il
y
a de plus parfait parmi les Religieux,
&
marque pour eux beaucoup plus d'ell:ime
&
ele véné–
rarion que pour les Ccenobites ou Moines qui réli–
elent dans eles monall:eres.
Yoye{
C<D:NOBITE.
La plupart ele ces
Anaclwretes
ne (e retiroient qu'a•
vec la permiffion de leur Abbé,
&
c'étoit [e couvent
qui lem fourni/l'oit lenrs be(oins. Le ¡reup[e en COnll–
dération de leur piété , leur portoit que[q\Jefois des
fommes coníielérables d'argent qu'ils gareloient;
&
a
leur mort ils le lai{foient aH monall:ere dont ils étoient
Ccenobites. L'Orclre de Saint-Benolt a eu beaucoup
ele ces
Anachoretes
,
ce qltÍ éroit conforme aux confti–
tutions de cet Orclre,qui permettent de quitter [a com"
rounauté pourvivre So[itaire
ouAnachorete.
Les
Ana–
cllOretes
ne fubíill:ent plus aujourel'hui : mais les an–
ciens ont enrichi leurs monafieres de pluíieurs reV'e–
nus conlielérables, comme ['a remarqué Pierre Aeoll:a
dans (on hill:oire de ['origine
&
elu progres eles reve–
nIJ.5 eccléliall:iques.
(G)
ANACHRONISME,
f.
rli.
terme ujifé en
Chronolo~
gie,
erreur dans la fupputation des tems
&
dans la date
des évenemens,c[u'on place p[utot qll'i[s ne (ont an'i–
vés. Ce mot ell: compo(é ele la prépolition Greque
tiva'
,
au-d1fits, en arriere,
&
ele
XP';VOf ,
tems.
T el
eíl: ce[ui qu'a commis Virgile en fai(ant régner
D idon en Afrique elu teros d'Enée ; quoique dans la
vérité elle n'y
Coit
venue que
300
ans apres la pri(e
de Troie.
L'erreur oppo(ée ,
ql.licon(tll:e
a
dater un évene–
ment eI'un tems poll:érieur a eeluí auquel il ell: arti–
vé, s'appeUe
parachronifme.
Mais elans ['u(age ordi–
naire on ne fait guere cette diftinll:ion,
&
on em–
p[oye inelifféremment
anachronifme
pour toute faute
contré la Chrono[ogié.
( 'G)
ANACLASTIQUE
,f.
f.
(Optil),
)
ell: la partie ele
1'0ptique qui a pour objet les réfraélions. C'ell: la
meme chofe que ce qu'on appelle autrement
D iop–
lríl¡ue. Voye{
DIOPTRIQUE.
Ce mot fe prend auffi adjeB:iverhent.
Poinl ana·
clajliqu:e,
ell: le point ou un rayon ele lumiere fe rompt,
c'eíl:-a-elire le point Otl i[ rencontre la (urface rom–
pante.
Voye{ R
É
FR
ACT I ON. Ce mot ell:fórmé des
mots Grecs,
dva' ,
mrsum,
derechef,
&
x>-.d¡;",
,jran
J
go,
je romps.
Courbes anaclajli'lues
,
en [e nom que M. de Maí...
ran a donné aux courbes apparentes que forme
[e
fond d'un vafe plein d'eau pOlLT un ceil p[ac:é elans
['air ;
OU
le plat-fonel eI'une chambre, pour un cei[ p[a–
cé elans un baffin p[ein eI'eau au milieu de cette cham–
bre ; ou la voute dll ciel, vlle par réfraélion a-tra–
vers l'atmofphere. M. de Mairan détérmine ces
cour~
bes d'apres un príncipe d'Optique adopté par p[uo!.
íieurs Auteurs, & rejetté par d'autres; mais qu'Orl
peut ne prendre dans (on Mémoire que pour un prin–
clpe purement géométrique: auquel cas (es rech<:r-
Ddd ij
















