
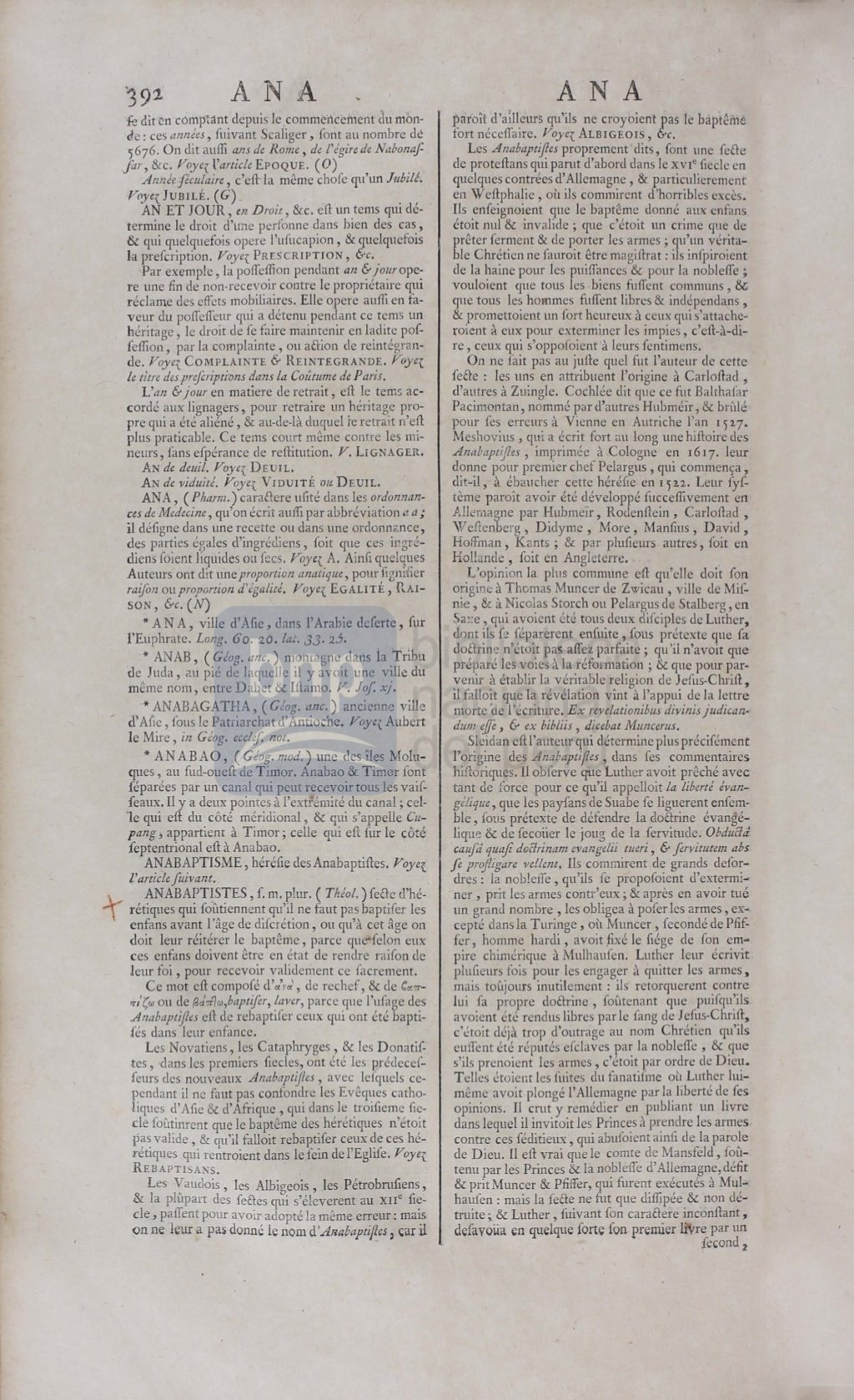
ANA
fe
diren cómptant depuis le commertcemertt du mon–
de : ces
années
,
(uivant Scaliger, (ont au nombre dé
5676. On dit aulIi
ansde Rome, de l'égirede Nabonaf
far ,
&c.
Voye{ l'article
EpOQUE.
(O)
Anne'e féeulairt,
c'efrla meme chofe qu'un
Jubit!.
V(lye{JuBILÉ.(C)
.
. ,
AN ET JOUR,
en Droit,
&c. eíl: un tems qlU de–
termine le droit d'une per(onne dans hien des cas,
&
qui quelc[uefois opere l'u(ucapion , & quelquefois
la
pre(cription.
Voye{
PRES CRIPTION,
6·e.
Par example, la poifeilion pendant
an
&
jourope–
re une fin de non·recevoir contre le propriétaire qui
réelame des efl:cts mobiliaires. Elle opere aulIi en fa–
veur du poifeifeur qui a détenu pendant ce tems un
héritage, le droit de (e faire maintenir en ladite po[–
(elIion, par la complainte, ou aaion de reintégran–
de.
Voye{
COMPLAINTE
&
REINTEGRANDE.
Voye{
le titre des prefcriptrons dms la Coútume deParis.
L'
an
&
jour
en matiere de retrait,
el!:
le tems ac–
cordé aux
Iigna~ers,
pour retraire un héritage pro–
pre qui a été aliené, & au-de-Ia duquel te retrait n'eí1
plus praticable. Ce tems comt meme contre les mi–
nems, (ans e(pérance de refutution.
V.
LIGNAGER.
AN
de deuil. Voye{
DEUIL.
AN
de viduité. Voye{
VmuITÉ
rJlt
DEUIL.
ANA,
e
Phamz.)
caraaere uíité dans les
ordonnan.
ces de Medecine,
qu'on écrit autu par abbréviation"
ti;
il déíigne dans une recette ou dans une ordonnmce,
des parties égales d'ingrédiens, (oit que ces ingré–
diens foient liquides ou (ecs.
Voye{
A. Ainíi quelques
Auteurs ont dit une
proportion anatique,
pour figni{ler
raifon
ou
proportion d'¿galit¿. Voye{
EGALITÉ , P,AI–
SON,
&e.
eN)
" AN A, viHe d'Aíie, dans l'Arabie deferte, [ur
I'Euphrate.
Long.
60.20.
lato
33.
2.7.
" ANAB,
e
Céog. ane.)
mOl1tagrle dans la Tr:bu
de Juda, au pié de laquelle il yavoit une
viii;:
du
meme nom, entre D abet
&
Ifiamo.
V.
Jof.
xj.
"ANABAGATHA,
(Céog. ane.)
ancienne ville
d'Afie, (ous le Patriarchat d'Antioche.
Voye{
Aubert
le Mire,
in Céog. ecclif. noto
" ANABAO,
(Céog. mod.)
une des lIes Molu–
ques, au fud-oueíl: de Timor. Anabao
&
Timor font
féparées par
1m
canal 'lui peut recevoir tous les vai(·
feame.
II
y
a deux pointes a l'extrémité du canal; celo
le c¡ui eíl: du coté méridional,
&
'lui s'appeHe
Cu–
pang;
appartiem a Timol'; ceHe 'luí eft fur le coté
feptentrional eíl: a Anabao.
ANABAPTISME, héréíie des Anabaptiíl:es.
roye{
,'aniclefuivant.
ANABAPTI5TES,
f.
m. pIur. (
Tlu!ol.
)
[eae d'hé·
t
rétiques qui (ofttiennent qu'il ne faut pas bapti(el' les
enfans avant
I
'age de difcrétion, ou qu'a cet age on
doit leur réitérer le bapteme, parce que'felon eux
ces enfans doivent etre en état de rendre l'ai(on de
leur foi , pour recevoir validement ce facrement.
Ce mot eíl: compo(é d'
,,'v,,',
de rechef,
&
de
(;"-7T–
'T/''''
ou de
(Jd7T1tiJ,baptifer, layer,
paree que l'ufage des
Anabaptijles
eíl: de rebaptifer eeux qui ont été bapti–
fés dans leur enfanee.
Les Novatiens, les Cataphryges ,
&
les Donati[·
tes, ·dans les premiers íieeles, ont été les Rrédece[–
feurs des nouveaux
Anabaptijles
,
avec lef'luels ce–
pendant il ne faut pas eonfondre les Eveques catho·
liques d'Afie
&
cl'Afrique, qui dans le troiíieme íie–
ele fotl1:inrent que le bapteme des hérétiques n'étoit
pas valide , & Clu'il falloit rebaptifer ceux de ces hé–
rétic¡nes 'lui
re~troient
dans le [ein de l'Eglife.
Yoye{
R EBAPTISANS.
Les Vaudois , les Albigeois, les Pétrobmíiens,
&
la pli'lpalt des fea es c¡ni s'élcverent au
XII"
íie–
ele , paifent ponr avoir adopté la meme erreur : mais
on
ne leur a pa$ donné le nom
d'Aru
{vaptift.es)
,ar
il
ANA
pat'olt
d'aiIleur~
qu'ils ne croyoient pas le baptefne
fort néceifaire.
Voye{
ALBIGEOIS,
&e.
Les
Anabaptijles
proprement dits, [ont une [eae
de proteíl:ans 'lui pamt d'abord dans le
XVI"
fieele en
quelques contrées d'Allemagne , & particulierement
en \Veíl:phalie, oil ils commirent d'horribles exceSo
Ils en[eignoient que le
bapt~me
donné aux enfuns
étoit
mu
&
invalide; que c'étoit un crime que de
preter ferment & de porter les armes; qu'un vérita–
ble Chrétien ne fauroit etre magiíl:rat : ils infpiroient
de la haine pour les puiífances
&
pour la nobleife ;
vouloient que tous les biens fuifent communs,
&
que tous les hommes fuifent libres & indépendans ,
& promettoient un [ort heureux a ceux qui s'attache–
rotent a eux pour exterminer les impies, c'eíl:-a-di–
re, ceux qui s'oppofoienta leurs femimens.
On ne (ait pas au jufie quel fut l'auteur de cette
feél:e : les uns en attribllent l'origine
a
Carloíl:ad ,
d'autres a Zuingle. Cochlée dit que ce fut Balthaiar
PacinlOntan, nommé par d'autres Hubméir,
&
brulé
pour fes erreurs
a
Vienne en Autriche Pan
'527.
Meshovius , qui a écrit fort au long une hiíl:oire des
Anabaptijles,
imprimée
a
Cologne en 1617. leur
donne pour premier chef Pelargus , qui commenc;a,
dit-il, a éballcher cette héré{¡e en
1
522-.
Lenr fye.
teme parolt avoir été développé (uccelIivement en
Allemagne par Hubmelr, Rodenflein, Carlofiad ,
\Veíl:enberg, Didyme, More, Maníius, David,
Hoffinan, Kants ; & par pluíieurs alitres, (oit en
Hollande , (oit en Angleterre.
L'opinion la plus commune eíl: qu'elle doit (on
origine a Thomas Muncer de Zwicau , viJle de Mi(–
nie ,
&
a
Nieolas 5torch ou Pelargus de Stalberg, en
Sal:e , qtú avoient été tous deux difciples de Luther,
dont ils
f~
féparerent enCuite, fons prétexte que fa
dofuine n'étoit pas aifez parfaite; qu 'il n'avoit qtle
préparé les voies
a
la réformation ;
&
que pour par–
venir
a
établir la vérilable religion de Je[us-Chrií1,
il falloit que la révélation vlnt
¡\
l'appui de la lettre
morte 'de I'écriture.
Ex reye!ationihus divinis judican.
dum
iffe,
&
ex bibliis, dieebat Muneems.
5leidan eíl:l'auteur qui détermine plus précifément
l'origine des
Anabaptifies
,
dans [es commentaires
hiíl:oriques. Il ob(erve que Lutber avoit preché avec
tant de force pour ce qu'il appelloit
la liberté tvan–
gélique,
que les payfans de Suabe fe liguerent enfem·
ble, (ous prétexte ele défendre la dofuine évangé–
lique
&
de fecoiier le joug de la (ervitude.
ObduRií
caufa quaft doRrinam eyangelii merí,
&
flrvitutem abs
fe
projligare 1'e/lent.
Ils commirent de grands defor–
dres: la noblelTe, qu'ils (e propofoient
d'extermi~
ner, prit les armes contr'eux ;
&
apres en avoir tué
un grand nombre, les obligea
11.
po(er les armes,
ex....
cepte dans la Turinge ,
011
Muncer , fecondé de Pfif·
fer, homme Im'di, avoit .fixé le íiége de (on
em~
pire chimériqtle a Mulhau[en. Luther leur écrivit
pluiieurs fois pour les engager
a
quitter les almes,
mais toCljollrs inlltllement : ils retorqtlerent cono'e
lui (a propre dofuine, COlltenant que puifqu:ils
avoient été rendus libres par le fang de
J
e(us-Chriíl:,
c'étoit déja trop d'olltrage au nom Chrétien qu'ils
eufient été réputés efclaves par la nobleife,
&
que
s'ils prenoient les armes, c'étoit par ordre de Diel.l.
Telles étoient les (uites dll fanati(me
011
Luther lm–
meme avoit plongé l'Allemagne par la liberté de (es
opinions.
Il
cmt
y
remedier en publiant un livre
dans lequel il invitoit les Princes
a
prenclre les amles
contre ces féditieux, qtú abu(oientainíi de la parole
de Dieu.
Il
eíl: vrai que le comte de Mansfeld, foft–
tenu par les Princes
&
la nobleife d'Allemagne,dé6t
&
pritMuncer
&
Pfi/fer, qui furent exécutés
a
Mul–
haufen : mais la feae ne fut que dilIipée
&
non dé–
truite;.
&
Luther , fi.Iivant (on caraaere inconíl:ant,
defayoüa en qtlelque forte fon premier
J.iirre
par un
fccond
t
















