
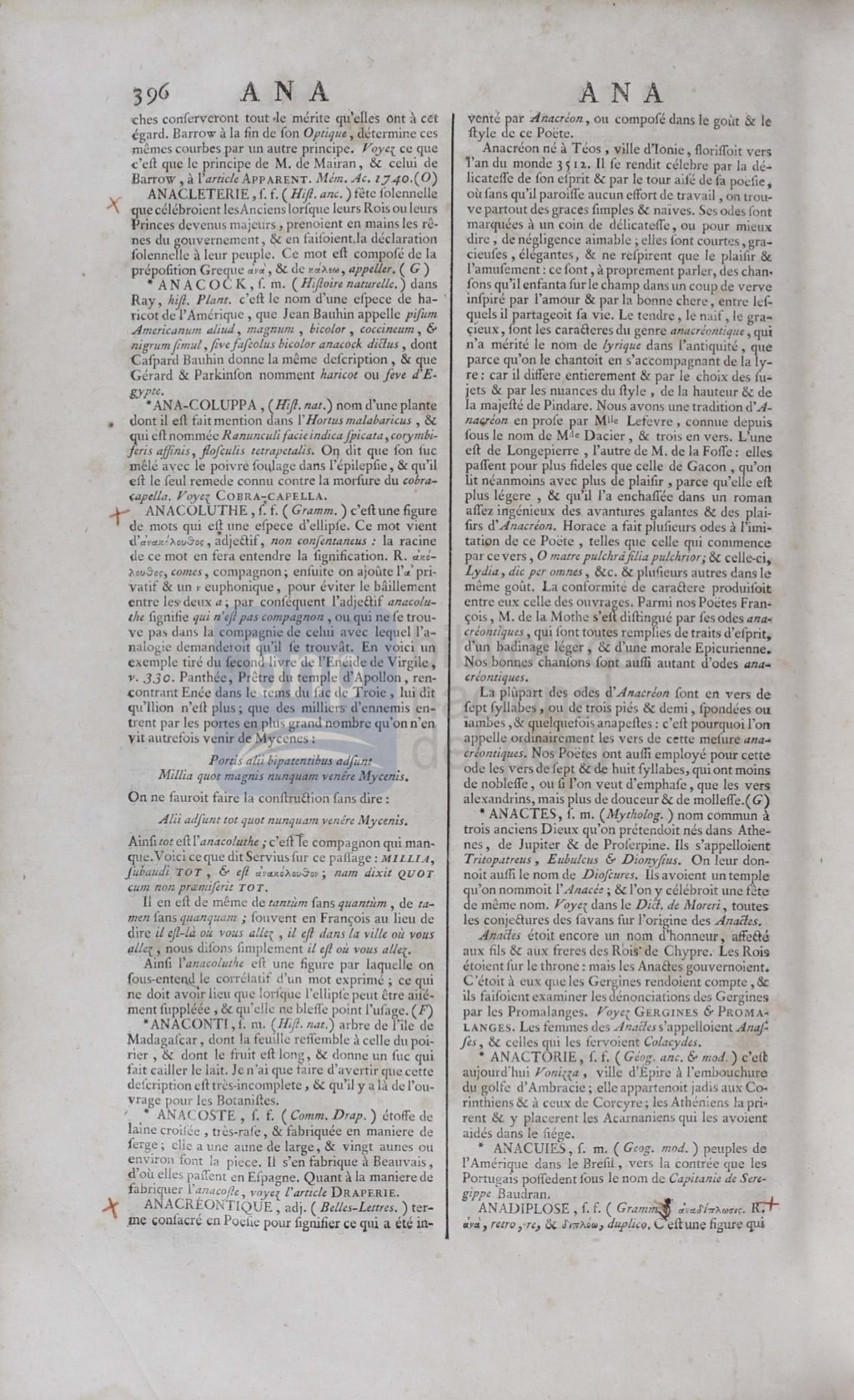
ANA
'Ches conferveront tout .Ie mérite qu'enes ont 11 cet
égard. Barrow 11 la fin de fon
Oplique,
détermine ces
memes courbes par
1111
autre principe.
Voye{
ce que
c'eil que le principe de M. de Mairan,
&
celui de
Barrow,
a
l'articleApPARENT. Mim. Ae. l:J40.(O)
ANACLETERIE,
f.
f. (
Hiji. ane.
)
mte (olennelle
que eélébroient lesAnciens lorfque leurs ROIs ou leurs
Princes devenus majeurs , prenoient en mains les re–
nes du gouvernement ,
&
en
faifoient.ladéclaration
folennelle 11 lem peuple. Ce mot eil compofé de la
prépofition Greque
,J.,a',
&
de •dA,'" ,
appeller.
(
G)
" A N A C O C K, f. m.
(Hijloire naturelle.)
dans
Ray,
hijl.
Pl~":t.
c'eft le nom d'une efpece de .ha- .
ricot de l'Amenque , que Jean Bauhm appelle
pijiun
Amerieanllm alilld, magnUnL
,
bicolor, eoccineum,
&
nígrllnLfmul ,Ji"efafiolus bicolor anacock diaus
,
dont
Cafpard Bauhin donne la meme defcription,
&
que
Gérard
&
Parkinfon nomment
haricot
ou
five d'E–
$Ypte.
"ANA-COLUPPA,
(¡rifl.
nat.)
nom d'une plante
• dont il eft fait mention dans l'
HortusmalabariClls
,
&
qui eftnommée
RamtnC/lli facieindiea'/picata, corymbi–
¡eris afftnis, flofculis tetrapetalis.
Ol)
dit que fon fuc
melé 'avec le poivre fOluage dans l'épilepfie,
&
qll'il
eille feuI remede connll contre la morfure du
cobra–
capella. I/oye{
COBRA~CAPELLA.
t"
ANACOLUTHE, f. f.
(Gramm.
)
c'eilllne figure
de mots qui eQ: une efpece d'ellipfe. Ce mot vient
d";"cL":AO";70~,
adjeaif,
non confintaneus
:
la racine
de ce mot en fera entendre la fignification. R.
d?¿–
lIoU;70~,
comes,
ccmpagnon; enfiJite on ajorlte 1',,'
pri–
vatif
&
un , euphonique, pour éviter le b1iillement
entre les- deux
a
;
par conféquent l'adjeaif
anacolu–
tite
fignifie
'luí n'eftpas eompagnon
,
ou qui ne fe trou–
ve
pa~
dans la compagnie de celui avec lequel l'a–
nalogie demandeJOit qu'il fe trouvat. En voici un
exemple tiré du fecond livre de l'Enéide de Virgile,
y.
330.
Panthée, Pretre du temple d'Apollon, ren–
.contrant Enée dans le tems dll fac de Troie, lui dit
qu'I1ion n'eil plus; que des milliers d'ennemis en–
trent par les portes en plus grand nombre qn'onn'en
yit autrefois venir de Mycenes:
Portís alii bipatentibUj adfunt
Millia qUOl magnis mlllquam venEre Myeeni,s.
On ne fauroit faire la conftruaion fans dire :
Alii adfitnt tOl quoc nUIlf}/lam venere lvJycenis_
Ainfi
tOl
eft l'
anacoluthe
;
c'eff1e compagnon
ql.liman–
que.Voici ceque ditServiusfur ce paífage:
M ILLIA,
j übaudi
TOT,
&
1/
d'<LY.¿AOU;701·;
lZam dixit
QUOT
CUIIl
lZon prrEnzifiril
TOT.
Il en eft de meme de
canlllm
fans
'luantum
,
de
la–
men
fans
qllan'luam
;
fOllvent en Franc;ois au lieu de
dire
il cjl-la ou vous alle{
,
il
eft dans la yi!le ou YOUS
f!lle{,
nous difons fimplement
il
ejl
ou vous al/er...
Ainfi
l'anacolullte
eíl: une figure par laquelle on
fous-enten(le cOl1'élatif d'un mot exprimé ; ce qui
ne doit aVOlr lieu que 100{que l'ellipte peut erre aifé–
ment fuppléée ,
&
qu'elle ne bleife point l'ufage.
(F)
"ANACONTI,
f.
m.
(Hifl·
llat.)
arbre de l'11e de
MadagaíCar, dont la feuille reifemble
a
celle du poi–
rier , & dont le fruit eft long,
&
donne un fuc qui
fait cailler le lait. Je n'ai que faire d'avertir que cerre
defcription eft tres-incomplete ,
&
qu'il
y a la de 1'on–
vrage pour les Botanifies.
, ." ANACOSTE,
f.
f.
(Comm. Drap.)
étoffe de
lall1e croilce , tI es-rafe ,
&
fabriquée en maniere de
ferg~;
elle a une aune de large,
&
vingt aunes ou
envlron font la piece. Il s'en fabrique
a
BeauvaÍs ,
d'oü elles p,aífent en Efpagne. Quant
a
la maniere de
fabnquer 1
anac0(l_, voye{
l'
amele
DRAPERIE.
~
ANACRÉONTrQUE, adj.
(Belles-Lettres.
)
ter-
me confacré en Poefle pour fignifier ce qni a été
in-
ANA
venté par
~nacnfoll,
Ou compofé dans le gOtlt
&
le
fryle de ce Poete.
Anacréon né
a
T éos , ville d'Ionie, floriifoit vers
1'an du monde
3512.. Il
fe rendit célebre par la dé–
licateífe de fon efprit
&
par le tour aile de fa poefie
011
fans qu'il paroiífe aucun effort de travail , on
lrou~
ve partout des¡vaces fimples
&
nalves. Ses odes font
marquées 11 un coin de délicatelfe, ou pour mienx
dire , de
né~ligence
aimable ; elles font courtes , gra–
cieufes , élegantes
J
& ne refpirent que le plaifir &
l'amu{ement: ce font,
a
proprement parler, des chan.
fons qu'il enfanta (ur le champ da!l.sun coup de verve
infpiré par l'amOur
&
par la bonne chere, entre lef–
q~lels
il
partageoit fa vie. Le temlre, le naif, le gra–
cleux, font les caraaeres du genre
anacréontiquo ,
qui
n'a mérité le nom de
lyri'luo
.dans l'antiquité, que
parce qu'on le chantoit en s'accompagnant de la ly–
re: car il differe entierement
&
par le choix des fu–
jets
&
par les nuances du ilyle, de la hauteur
&
de
la majefté de Pindare. Nons avons une tradition
d'A–
nac,réon
en profe par
Mil.
Lefcvre, connue depuis
fous le nom de Mde Dacier,
&
trois en versoL'une
efi de Longepierre , l'autre de M. de la Foife: elles
paifent pour plus fideles que celle de Gacon , qu'on
lit néanmoins avec plus de plaifir , parce qu'elle eft
plus légere ,
&
qu'il l'a enchaífée dans un roman
aifez ingénieux des avantnres galantes
&
des plai–
fus
d'Anaerion.
Horace a fait plufieurs odes
a
l'imi–
tatipn de ce Poete , telles que celle qui commence
par cevers, O
/Ilatre pulclzráfiliapulchrior;
&
celle-ci.
Lydia, die per omnes,
&c.
&
plufteurs autres dans le
meme goút. La conforrnite de caraaere produifoit
entre eux celle des
ouvra~es.
Parmi nos POetes Fran–
c;ois, M. de la Mothe s'e1t diftingué par fes odes
ana–
créontiques,
qui lant toutes remplies de traits d'efprit,
c!'tm badinage léger,
&
d'une morale Epicurienne.
Nos bonnes chan{ons font auUi autant d'odes
ana..
criontiques.
La plflpart des odes
d'Anaéréon
font en vers de
fept fyUabes , ou de trois piés
&
demi , fpondées
GU
iambes
,&
quelquefois anapefies: c'eil pourquoi l'on
appelle ordinairement les vers de cerre meúue
ana~
créomiques.
Nos POletes ont auffi employé pOlU cette
ode les vers de fept
&
de
huit fyllabes, qui ontmoins
de nobleífe, ou fi l'on veut d'emphafe, que les vers
alexandrins, mais plus de douceur
&
de molleife.(
G)
"ANACTES,
e
m.
(MYlholog.)
nom cornmun
a
trois anciens Dieux qu'on prétendoit nés dans Athe–
nes , de Jupiter
&
de Proterpine. Ils s'appelloient
Tricopatreus, Eltbulms
&
D ionyJiUj.
On lelu don–
noit auffi le nom de
Diofcures.
Ils avoient un temple
qu'on nommoit
l'Allacée ;
&
I'on y célébroit une ü:te
de meme nomo
I/oye{
dans le
Dia. de Moreri,
toutes
les conjeaures des favans [tU l'origine des
Anac1es.
Anaaes
étoit encore un nom d'honneur, affeaé
aux fils
&
aux freres des Re is' de Chypre. Les Roi9
étoient fur le throne : mais les Anaaes gouvernoient.
C 'étoit
a
eux que les Gergines rendoient compte
,&
ils faifoient examiner lesdénonciations des Gergines
par les Promalanges.
!/oye{
GERGINES
&
PROMA–
LANGES. Les femmes des
Anaaes
s'appelloient
Ana):
fes,
&
celles c¡ui les {ervoient
Colacydes.
" ANACTORIE, f. f.
(G¿og , flnc.
&
mod. )
c'eft
aujourd'hui
Voni{{a ,
ville d'Epire
a
l'embouchure
du golfe d'Ambracie; elle appartenoit jadis aux Ca–
rinthiens
&
a
ceux de Corcyre; les Ath¡\niens
ht
pri
o
renr
&
y placerent les Acarnaniens c¡ui les avoient
aidés dans le fiége.
" ANACUIES, f. m.
(Geog.
mr¡d.)
peuples de
l'
Amérique dans le Brefa, vers la contTée que les
Portugais po{[edent fous le nom de
Capicanic de
Sm-
gíppe
Baudran.
'--L.
ANADIPLOSE, f. f. (
Gral1l11::1
;'<LJ'f71'A"'ITJ~.
R.'
dy,,',
r"fo,
r~)
&
d'J7iA¿rN,
duplic(),
e
dl:une figure qui
















